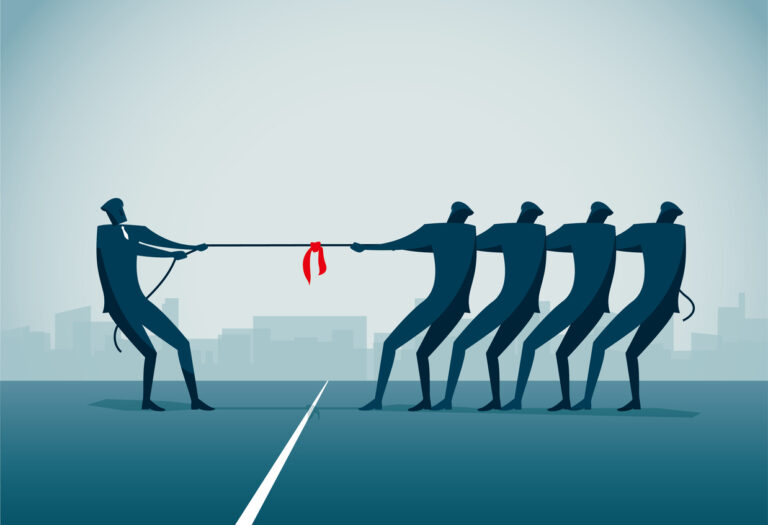(English version available here)
La proposition du Québec d’interdire la prière publique dépasse le cadre de la laïcité, modèle de neutralité religieuse de la province. Elle touche au langage même de la religion. Dans une société profondément marquée par la foi, la littératie religieuse, c’est-à-dire la capacité à comprendre les faits, symboles et traditions religieuses, demeure essentielle pour comprendre notre patrimoine, apaiser les tensions actuelles et renforcer la cohésion sociale.
Le Québec est une société unique, façonnée par son héritage catholique et ses rapports complexes à la religion, à l’immigration, à la langue et à l’intégration. Sa laïcité s’est affirmée pendant la Révolution tranquille, puis s’est traduite par des lois comme le projet de loi 21, qui interdit aux enseignants, policiers, juges et procureurs de porter des signes religieux.
Le défi consiste à trouver un équilibre entre la neutralité de l’État et la diversité grandissante de la population. Malgré la sécularisation, la littératie religieuse reste une clé pour mieux comprendre le Québec et favoriser la cohésion sociale.
Abordée sous l’angle de la foi, de la culture ou de la réflexion intellectuelle, la littératie religieuse renforce le caractère distinctif du Québec. Elle favorise l’inclusion et le dialogue. Québec et Ottawa gagneraient à l’intégrer dans les programmes scolaires et les initiatives publiques, afin d’aider les citoyens à naviguer dans la diversité avec empathie et lucidité.
Qu’est-ce que la littératie religieuse ?
La littératie religieuse regroupe les connaissances, les repères et les compétences nécessaires pour comprendre les visions religieuses, spirituelles et laïques du monde, au-delà des croyances individuelles. En tant qu’outil civique, elle encourage une approche ouverte et intellectuelle des différentes traditions. Elle renforce ainsi la cohésion sociale dans un Québec souvent traversé par des débats corsés sur le rôle de la religion dans la vie publique.
Les traditions religieuses, spirituelles et laïques influencent nos valeurs, nos cultures et nos choix moraux. Ces cadres façonnent aussi les décisions politiques et les mouvements sociaux. L’Église catholique, par exemple, a longtemps contrôlé l’éducation et les soins de santé au Québec, jusqu’aux réformes de la Révolution tranquille.
Aujourd’hui encore, la littératie religieuse aide à comprendre comment ces traditions continuent d’influencer les débats sur les accommodements religieux ou sur l’application de la laïcité.
Dans son livre Value(s): Building a Better World for All, le premier ministre du Canada, Mark Carney, évoque une image du pape François, qui comparait le marché moderne à la grappa, un alcool fort distillé à partir des restes du raisin, qui dépouille l’être humain de toute son humanité. Le pape invitait à « ramener le marché vers l’humain » en restaurant la richesse et la diversité des valeurs.
Cette image illustre la persistance de la pensée religieuse dans nos visions de la justice, de la solidarité et de la vie économique. Elle rappelle aussi comment le catholicisme a inspiré les mouvements syndicaux et coopératifs du Québec, comme le Mouvement Desjardins.
De son côté, le parcours du vice-président américain J.D. Vance, passé de l’athéisme au catholicisme, montre que la foi continue d’orienter les convictions politiques et économiques, même aujourd’hui.
Une littératie religieuse pour tous
La littératie religieuse ne concerne pas que les théologiens, les chercheurs ou les décideurs. Elle touche tous les citoyens, qu’ils soient croyants, spirituels ou laïcs, car elle façonne notre compréhension de l’identité, de la culture et du sens. Chaque groupe l’aborde à sa manière, reflet de la diversité québécoise.
Pour les pratiquants assidus, vivre sa foi quotidiennement, c’est apprécier le rythme, écouter les mots et goûter l’intimité de chaque verset. Un catholique francophone, par exemple, peut ressentir un lien plus profond avec sa tradition en récitant le Je vous salue Marie dans sa forme classique, ancrée dans le patrimoine linguistique du Québec. Entendre la prononciation d’un nom de prophète dans sa langue d’origine, plutôt que dans une version francisée, peut aussi raviver ce lien.
Pour les croyants « culturels », qui s’identifient au catholicisme sans le pratiquer – c’est le cas de nombreux Québécois –, la littératie religieuse permet de mieux comprendre leur héritage. Elle permet de savoir que certaines communautés orthodoxes célèbrent Noël le 7 janvier, ou de situer les débats sur les symboles religieux et les prières à l’école dans leur contexte historique.
Cette compréhension nourrit à la fois la connaissance de soi et le respect des autres traditions, qu’elles soient catholiques, sikhes ou hindoues.
La littératie religieuse est aussi pour les laïques. Les individus laïques ne s’identifient pas forcément à une tradition religieuse, mais leur environnement social et culturel reste souvent marqué par l’histoire religieuse. Les Québécois laïques, qui représentent la majorité de la population, sont influencés par ces cadres religieux : la structure du week-end, héritée du sabbat chrétien, ou les jours fériés comme Noël et Pâques reflètent le legs catholique du Québec.
La laïcité québécoise, née du rejet du pouvoir clérical pendant la Révolution tranquille, ne signifie pas l’absence de croyance, mais un équilibre entre neutralité et héritage. La littératie religieuse aide les laïcs à comprendre cette nuance et à participer aux débats sur les signes religieux avec empathie et discernement.
Pourquoi est-ce important ?
Dans un monde de plus en plus polarisé, la littératie religieuse devient indispensable. Près de trois pays sur dix connaissent des tensions religieuses importantes, et plus de 84 % de la population mondiale s’identifie à une religion. Même au Québec, où la laïcité occupe une place centrale, la religion continue d’influencer les valeurs et les politiques publiques.
Comme l’a souligné la Commission Bouchard-Taylor, « L’ignorance des traditions religieuses favorise les malentendus et les tensions sociales ».
La littératie religieuse aide les croyants à approfondir leur foi, les pratiquants culturels à comprendre leur héritage, et les laïcs à dialoguer dans une société pluraliste.
Langue et identité : il est trop facile de diaboliser le Québec
Alors que la province accueille des immigrants de plus en plus diversifiés (musulmans, sikhs, bouddhistes et autres), cette connaissance devient un outil de cohésion. Elle déconstruit les stéréotypes et encourage un dialogue constructif sur les accommodements religieux.
En comprenant les fondements des différentes traditions, les Québécois peuvent combler les fossés qui séparent un Montréal plus cosmopolite et des régions plus homogènes.
Intégrer la littératie religieuse à l’école et dans les programmes publics, c’est donner à tous les citoyens, jeunes et adultes, les moyens de vivre la diversité avec empathie, respect et intelligence.