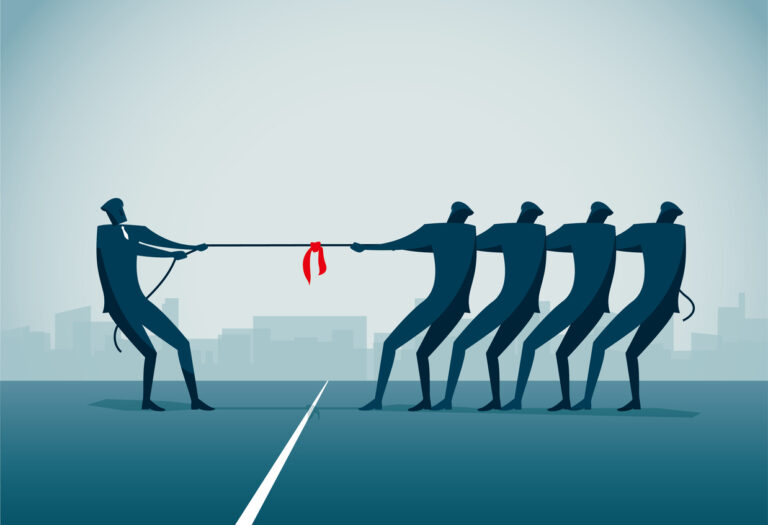(English version available here)
Des incendies monstres ravagent de vastes étendues de forêt, obligeant des communautés entières à fuir. Une épaisse fumée recouvre les centres urbains à des centaines de kilomètres à la ronde. Ce triste scénario estival est devenu la nouvelle normalité au Canada.
Cependant, même si les changements climatiques favorisent des feux de forêt de plus en plus fréquents et intenses, les gouvernements ont les moyens de limiter les dégâts, de protéger des vies et le gagne-pain de milliers de personnes en misant sur des actions ciblées et préventives.
Cela implique de renforcer les politiques qui régissent les sites et les modalités de construction, d’investir dans de meilleures stratégies d’aménagement du territoire et de gestion des combustibles forestiers, d’appuyer le leadership et le savoir autochtone en matière de gestion responsable des forêts, d’accroître les capacités de protection et d’intervention contre les incendies et d’accélérer la réduction des émissions de GES.
Les solutions existent et sont à portée de main, mais elles exigent que les gouvernements agissent avec diligence, coordination et détermination.
De lourdes pertes financières
Les feux de forêt gagnent en ampleur et laissent des traces durables dans les communautés, d’un océan à l’autre. En 2023, la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée au Canada, le feu s’est propagé sur une superficie totale de plus de six fois supérieure à la moyenne annuelle. Cette année est en voie de devenir la deuxième pire saison.
Les prévisions pour le reste de l’été ne sont guère plus encourageantes. Les conditions météorologiques extrêmes propices aux incendies pourraient persister, voire s’aggraver, dans de nombreuses régions du pays.
Les conséquences sont sérieuses : évacuations, perte de maisons et d’infrastructures, coûts élevés des opérations de lutte contre les incendies et pertes de vies humaines.
Plus de 230 000 personnes ont été évacuées au cours de la saison 2023. La même année, les dommages causés par les feux de forêt ont atteint près d’un milliard de dollars en coûts d’assurance, la Colombie-Britannique enregistrant les coûts les plus élevés de son histoire.
En 2024, l’incendie de Jasper, en Alberta, a été l’un des plus coûteux de l’histoire du Canada, avec des dommages d’une valeur dépassant 1,2 milliard de dollars. Il n’a été surpassé que par l’incendie de Fort McMurray, en 2016, qui a causé des pertes d’environ 4 milliards de dollars et près de 11 milliards de dollars en coûts directs et indirects.

L’Est du Canada n’est pas épargné
Les changements climatiques augmentent de plusieurs façons les risques de feux de forêt. Les éclairs, plus nombreux, déclenchent davantage d’incendies. La fonte précoce des neiges, les températures plus chaudes et plus sèches, ainsi que l’infestation de parasites créent des conditions idéales pour la propagation des feux de forêt. Le nombre d’incendies majeurs et les superficies totales brûlées ont considérablement augmenté depuis le milieu du XXe siècle.
Le réchauffement climatique modifie également la répartition géographique de ces feux. Si l’ouest du Canada a été jadis plus touché, la menace est désormais présente à la grandeur du pays. Les changements climatiques ont plus que doublé les risques de conditions extrêmes propices aux incendies dans l’est du Canada depuis 2023. D’ici la fin du siècle, le nombre de jours où les feux se propagent activement pourrait doubler ou tripler dans la région.
Canada : pourquoi le leadership environnemental est aussi une stratégie économique gagnante
Politique climatique : il faut maintenant viser l’adaptation et la résilience
La Loi sur les mesures d’urgence doit être adaptée à la crise climatique
Ce changement prend déjà les communautés au dépourvu. Lorsque la Nouvelle-Écosse a été confrontée au plus grand feu de forêt de son histoire en 2023, les pompiers de Halifax, formés surtout pour les incendies de bâtiments, n’étaient pas équipés pour lutter contre ce type de feu. L’incendie de Red Lake 12, toujours non maîtrisé, est l’un des plus importants jamais enregistrés en Ontario. La province manque de pompiers forestiers et d’avions-citernes.
Une mauvaise gestion du territoire en cause
Les risques auxquels le Canada est confronté aujourd’hui ne sont pas seulement liés aux changements climatiques. Ils découlent également des choix effectués par les gouvernements successifs concernant l’emplacement des infrastructures et la gestion du territoire.
Les communautés ont continué à s’étendre dans les zones périurbaines, où le développement côtoie la végétation naturelle, malgré le risque connu de feux de forêt. Ces zones sont particulièrement exposées et les incendies peuvent s’y propager vers les régions peuplées. Environ 12 % de la population canadienne réside aujourd’hui dans ces zones.

Une analyse récente de l’Institut climatique du Canada montre que les pertes financières liées aux feux de forêt pourraient doubler d’ici 2030 si les objectifs fédéraux en matière de logement sont atteints, conformément aux modèles de développement actuels. La Colombie-Britannique subirait des pertes financières considérables, tout comme le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, l’Ontario et le Québec.
La politique de lutte contre les incendies a également joué un rôle. Les efforts déployés par le passé pour lutter contre les feux de forêt ont entraîné une accumulation excessive de végétation qui, autrement, aurait été brûlée lors d’incendies de moindre intensité. Au fil du temps, cette flore envahissante a alimenté des incendies plus violents et incontrôlables. Des recherches montrent que le risque est particulièrement élevé à proximité des communautés situées dans la forêt boréale, où la lutte contre les incendies a été la plus intense.
Les peuples autochtones utilisent depuis longtemps le brûlage contrôlé pour protéger leurs communautés et améliorer les écosystèmes. Cependant, les gouvernements coloniaux ont interdit cette pratique, aggravant ainsi le problème.

Cinq actions à prendre dès maintenant
Le Canada doit passer d’une attitude réactive à une attitude proactive pour réduire le risque de feux de forêt. En bref, il faut repenser la construction les infrastructures, la gestion des forêts et les méthodes d’intervention d’urgence. Voici cinq mesures que les gouvernements peuvent prendre dès maintenant, sachant qu’aucune stratégie ne peut à elle seule résoudre le problème.
- Cesser d’encourager la construction dans les zones à risque. Les provinces et les territoires devraient établir des politiques visant à orienter le développement du logement et des infrastructures, ainsi que le financement public. Le gouvernement fédéral devrait veiller à ce que le financement du logement et des infrastructures soit dirigé vers les zones à faible risque. Les gouvernements doivent également investir dans la cartographie des risques d’incendie de forêt, qui est incomplète ou inexistante dans la plupart des régions du Canada, afin d’éclairer la prise de décision.
- Rendre les nouveaux aménagements résistants aux incendies. Des programmes, tels que FireSmart Canada ou des organisations comme la SOPFEU, au Québec, offrent des conseils pour aider les communautés à réduire les risques en utilisant des matériaux inflammables ou en conservant un espace suffisant autour des habitations. Il s’agit cependant de programmes volontaires. Les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient intégrer ces principes dans les codes du bâtiment et les politiques d’aménagement du territoire. Cela permettrait non seulement de protéger les maisons individuelles, mais aussi de réduire le risque de propagation des incendies dans les communautés.
- Mieux gérer les forêts et réduire ses combustibles (bois, broussailles, lichen) qui alimentent les feux. Les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral devraient intensifier la gestion des combustibles forestiers afin de réduire la végétation inflammable dans les forêts situées à proximité des collectivités. Les techniques de gestion des combustibles qui peuvent réduire l’intensité des feux de forêt comprennent l’éclaircie sélective, qui consiste à enlever de manière ciblée certains arbres et broussailles, et le brûlage dirigé, soit un feu planifié effectué dans des conditions météorologiques précises. Les gouvernements devraient également appuyer l’utilisation des connaissances traditionnelles autochtones pour la gestion des incendies, notamment par le brûlage traditionnel.
- Renforcer la capacité de lutte contre les incendies. L’aggravation des saisons de feux de forêt au Canada met les ressources disponibles pour lutter contre les incendies à rude épreuve. Les communautés isolées et autochtones sont particulièrement exposées, mais elles ont souvent moins de moyens pour réagir. Les gouvernements devraient augmenter le financement destiné à la lutte contre les feux de forêt et aux interventions d’urgence, et améliorer la coordination pour gérer plusieurs incendies simultanés. Une indemnisation et un soutien adéquats contribueraient également à retenir les pompiers forestiers qualifiés.
- Réduire la pollution par le carbone pour éviter tout risque d’emballement. Plus le Canada réduira rapidement ses émissions de gaz à effet de serre, plus nous pourrons éviter des dommages. Limiter le réchauffement climatique à deux degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels peut prévenir les effets les plus catastrophiques.
Les gouvernements, à tous les paliers, doivent se poser la question : faut-il conserver le statu quo, au risque de voir la saison des incendies s’aggraver ou prendre des mesures audacieuses pour réduire les risques, protéger les populations et garantir que les ressources publiques soient dépensées à bon escient? Le choix est clair.