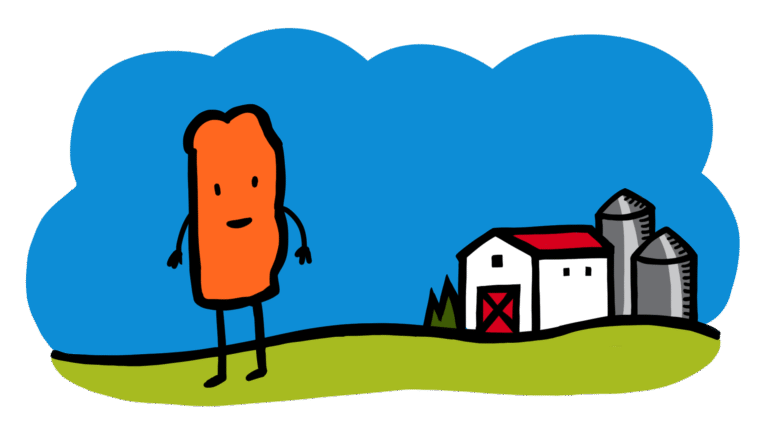Lorsqu’on parle d’universalité en politiques sociales, on pense souvent aux programmes financés par l’impôt et accessibles à tous, comme la santé ou l’éducation. Pourtant, le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) bouscule cette vision.
Financé exclusivement par les cotisations des travailleurs et employeurs, il couvre aujourd’hui la quasi-totalité des naissances au Québec, démontrant qu’un programme contributif peut atteindre une accessibilité quasi universelle. Ce succès invite à repenser la manière de concevoir et de financer d’autres programmes sociaux.
Du point de vue des usagers, l’universalité d’un programme dépend moins de son mode de financement que de son accessibilité. Des analyses internationales, notamment dans le domaine de la santé, utilisent un seuil implicite de couverture autour de 90 % pour parler d’universalité de fait.
C’est précisément ce que permet le RQAP, qui couvre environ 91 % des naissances au Québec sans un sou du gouvernement. C’est bien plus que la proportion de Québécois qui ont un médecin de famille (73 %) et celle des enfants de moins de 5 ans qui fréquentent un service de garde (64 %).
On se retrouve donc avec ce paradoxe : le RQAP, bien qu’il repose sur un financement contributif, est plus universellement accessible que certains services — comme les services de garde à la petite enfance — pourtant financés par l’impôt.
Un programme contributif et accessible à (presque) tous
Le RQAP est un régime d’assurance publique, pas une politique fiscale. Il est financé exclusivement à partir de contributions versées au Fonds d’assurance parentale par les employeurs, les personnes salariées et les travailleurs et travailleuses autonomes. Aucune somme du Fonds ne provient du budget du Québec.
Et pourtant, le régime couvre presque toutes les naissances au Québec. Pourquoi ? Parce que le programme rejoint l’immense majorité des personnes actives économiquement, et que ses critères d’admissibilité sont clairs et facilement accessibles : il suffit d’avoir gagné au moins 2 000 $ au cours de l’année précédente.
Le RQAP fonctionne selon une logique d’assurance assumée, où l’ensemble des travailleurs et travailleuses cotisent au Fonds, dont ceux et celles qui deviennent parents et qui ont droit à des prestations. Et parce que la quasi-totalité des futurs parents exerce une activité rémunérée, le régime rejoint une vaste majorité des familles québécoises.
Des prestations plus généreuses que partout ailleurs
Jusqu’en 2006, les prestations parentales étaient versées partout au Canada par l’entremise du programme fédéral d’assurance-emploi. L’instauration du RQAP cette même année a marqué un tournant : le Québec a négocié un retrait partiel du régime fédéral, ce qui signifie que la part des cotisations liée aux prestations parentales n’est plus perçue par Ottawa. Ce rabais de cotisation réduit toujours le coût net du RQAP pour les contribuables québécois.
Par exemple, un travailleur québécois gagnant 50 000 $ annuellement paie environ 82 $ de plus qu’un travailleur au même salaire ailleurs au Canada, en raison de la différence entre les cotisations à l’assurance-emploi et au RQAP. À 100 000 $, l’écart grimpe à 267 $. Mais ce que le programme offre en retour est considérable, car les parents québécois reçoivent des prestations nettement plus généreuses que partout ailleurs au Canada.
Au Québec, le taux de remplacement du revenu pendant la période de congé payé peut atteindre jusqu’à 75 % (régime particulier) ou 70 % (régime de base), selon la durée du congé choisi. Pour les parents à faible revenu, le remplacement du revenu peut atteindre 100 %. Ailleurs au Canada, les prestations parentales, qui sont encore versées par l’assurance-emploi, offrent entre 33 % et 55 % du revenu d’emploi. En 2025, un nouveau parent dont le revenu atteint le maximum assurable au Québec peut recevoir jusqu’à 1413 $ par semaine, contre 695 $ ailleurs au Canada. Cela s’explique aussi par le fait que le revenu maximal assurable au RQAP est beaucoup plus élevé qu’ailleurs au Canada (98 000 $ au lieu de 65 700 $ en 2025).
Un modèle de gouvernance tripartite
Une autre force du RQAP réside dans sa gouvernance. Le régime est administré par un conseil tripartite réunissant des représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. La présence des parties qui le financent renforce son autonomie d’action. Les administrateurs doivent concilier, de manière objective, les besoins des prestataires et la capacité de payer des cotisants, à l’abri des aléas qui affectent souvent les programmes financés par les crédits budgétaires. Le régime est géré selon une logique assurantielle, appuyée par des projections actuarielles, et prévoit des ajustements réguliers, mais prévisibles, des taux de cotisation.
Salaire minimum : jusqu’où peut-on aller sans freiner l’économie?
Le régime fiscal doit servir les citoyens. Ne l’oublions pas.
Résultat : le programme s’ajuste au marché du travail, il maintient un équilibre financier durable, et il n’accumule ni superflus ni déficits chroniques. Pendant la pandémie, le RQAP a démontré sa capacité d’adaptation en offrant des prestations minimales de 500 $ par semaine pendant une certaine période, afin de s’aligner sur la mesure fédérale qui garantissait un montant équivalent aux nouveaux parents.
Une double logique de soutien
Dans plusieurs pays nordiques, comme la Suède ou l’Islande, les congés parentaux sont financés par des régimes mixtes. Une partie des revenus est remplacée grâce à la rémunération offerte dans le cadre du congé parental, et une prestation minimale financée par les budgets gouvernementaux est versée aux personnes qui n’ont pas de revenu (étudiants, parents au foyer, etc.). Le montant des prestations universelles pour ces personnes est toutefois très faible.
Le Québec a fait un autre choix. Le RQAP n’offre aucune prestation aux parents sans revenu admissibles. Le filet de sécurité minimal repose plutôt sur les allocations familiales, financées par les revenus généraux de l’État. Le programme « Allocation famille » offre des prestations universelles, dont le montant varie en fonction du revenu familial, du nombre d’enfants et de la situation conjugale. Ces prestations ne remplacent pas un revenu de travail, mais elles constituent un soutien offert à tous les parents, y compris ceux exclus du régime, dès l’avènement de la naissance ou l’adoption. À ce soutien s’ajoute l’Allocation canadienne pour enfants, un programme fédéral non imposable, mais dont le montant est modulé en fonction du revenu familial.
Le modèle québécois repose ainsi sur une double logique de soutien : d’une part, des prestations dont le montant dépend des revenus d’emploi antérieurs ; d’autre part, des mesures fiscales financées par l’impôt, accessibles à toutes les familles, y compris celles sans revenu d’emploi assurable. Le Québec n’a pas opté pour un régime mixte comme les pays nordiques, mais le résultat demeure le même, c’est-à-dire que toutes les familles bénéficient d’un certain soutien public à la suite de l’arrivée d’un enfant, mais parfois selon des modalités différentes.
Une inspiration pour d’autres politiques ?
Le RQAP fonctionne. Il est efficace, généreux, bien administré et il fait l’envie des nouveaux parents à l’extérieur du Québec. Et pourtant, il attire peu l’attention médiatique ou politique, surtout en comparaison aux services de garde à la petite enfance, sans doute parce qu’il ne fait pas face aux mêmes défis relatifs à l’accessibilité. Le RQAP doit tout de même être reconnu pour ce qu’il est : une belle réussite collective qui apporte un soutien à la vaste majorité des familles, sans dépendre de l’État, et qui est au cœur du modèle québécois de soutien aux familles.
Ce succès démontre qu’un programme contributif peut atteindre une forme d’universalité de fait, tout en assurant une gestion financière rigoureuse et une réponse agile aux besoins des parents. Cette combinaison de critères d’admissibilité clairs, de gouvernance tripartite et de prestations généreuses, mais bien ciblées constitue un modèle dont pourraient s’inspirer d’autres politiques sociales, qu’il s’agisse du soutien aux proches aidants, de l’assurance invalidité ou de régimes destinés aux travailleurs autonomes.
Alors que plusieurs programmes publics sont confrontés à des enjeux de pérennité, d’équité ou d’accessibilité, le RQAP mérite d’être étudié non seulement comme une réussite québécoise, mais aussi comme une piste de réflexion pour repenser certaines politiques sociales au Canada.