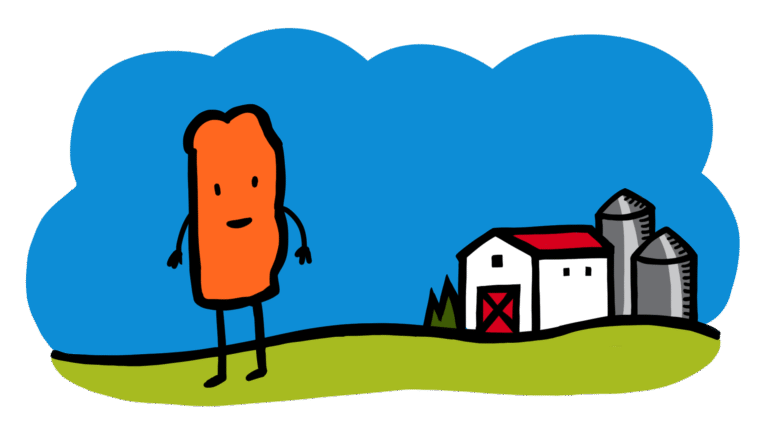(English version available here)
Le plan ambitieux du premier ministre Mark Carney visant à accélérer la réalisation de grands projets représente une occasion unique de façonner l’avenir du pays. Qu’il s’agisse de minéraux essentiels, de transport d’électricité, de pipelines ou de réseaux d’énergie propre, ces projets promettent de transformer en profondeur le paysage économique du Canada.
Mais il manque un élément crucial à cette vision : s’assurer que les communautés où ces projets seront réalisés disposent de la main-d’œuvre qualifiée nécessaire.
Un développement stratégique des compétences, aligné sur ces mégaprojets, permettrait de renforcer la résilience de ces communautés, qui font face aux perturbations potentielles liées à la transition énergétique mondiale, aux droits de douane imposés par le président Trump et aux autres menaces qui planent sur le Canada.
Pour y parvenir, les gouvernements devraient prendre trois mesures : offrir des programmes de perfectionnement des compétences souples, favorisant des initiatives de formation locales alignées sur les plans de développement économique des communautés; miser sur les organismes communautaires du Réseau de développement des collectivités du Canada, financés par le gouvernement fédéral, afin d’améliorer la coordination entre la planification du développement économique et le développement des compétences; créer des partenariats pour combler les pénuries locales de main-d’œuvre avant même le début des grands projets.
Identifier les besoins les plus urgents
Le projet « Transformations communautaires » de l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) a recensé 68 collectivités canadiennes qui sont à risque de subir des pertes d’emploi en raison des efforts de réduction des émissions de GES à l’échelle mondiale. Dix-neuf d’entre elles sont également exposées aux droits de douane imposés de manière sporadique par Donald Trump, compte tenu de leur dépendance aux exportations vers les États-Unis.
Sur les 150 projets géolocalisés dans le répertoire des grands projets de Ressources naturelles Canada, 50 sont situés dans des communautés à risque en raison de la transition vers la carboneutralité.
Or, pendant que le gouvernement fédéral s’engage à réduire à deux ans les délais d’approbation pour les projets d’intérêt national, de nombreuses collectivités rurales et isolées ne disposent ni des infrastructures ni des investissements nécessaires pour en bénéficier.
Le Cap-Breton : Quand une région charbonnière se tourne vers les énergies renouvelables
Comment Carney peut réconcilier le Canada grâce aux politiques publiques : 4 priorités stratégiques
Nos recherches montrent que ces communautés sont souvent éloignées, moins peuplées et peu diversifiées sur le plan économique. Elles comptent également une proportion plus élevée de travailleurs autochtones, actifs à la fois dans les secteurs vulnérables et dans d’autres domaines.
Ces réalités compliquent le recrutement de main-d’œuvre qualifiée dans ces communautés. Les obstacles à la formation et à l’éducation y sont plus fréquents, et l’absence de possibilités d’emploi locales pousse les travailleurs à migrer. Ce phénomène accentue les tensions sociales et économiques, alors que ces régions doivent affronter d’importantes transformations.
Une action concertée s’impose
Relever ces défis nécessitera une approche tout aussi audacieuse et coordonnée que celle envisagée par Carney pour accélérer les grands projets.
Ces projets offrent en effet une occasion favorable pour le Canada d’agir de manière proactive. Prenons l’exemple du projet Wind West, en Nouvelle-Écosse, qui prévoit l’installation d’éoliennes en mer pour alimenter plus du quart des besoins en électricité du Canada.
Un investissement d’une telle ampleur pourrait revitaliser les communautés côtières et agirait comme catalyseur du développement régional. Mais ces retombées ne seront possibles que si les travailleurs locaux disposent des compétences nécessaires à l’installation, la maintenance et la fabrication d’éoliennes en mer.
Le Cap-Breton, l’une des régions étudiées par l’IRPP, en est un bon exemple. Cette région pourrait grandement bénéficier du projet Wind West, mais seulement si la formation de la main-d’œuvre locale est intégrée dès la phase de planification.
Or, plusieurs communautés du Cap-Breton se remettent encore difficilement des fermetures des industries traditionnelles du charbon, de l’acier et de la pêche. Le taux de chômage dans cette région y est parmi les plus élevés au pays et la pauvreté infantile persiste. Pourtant, les connaissances et savoir-faire issus de ces secteurs traditionnels permettraient de répondre aux besoins techniques nécessaires au développement éolien en mer.
L’avenir pourrait être prometteur
Le secteur manufacturier du Cap-Breton, par exemple, pourrait renaître grâce à la fabrication et à l’assemblage des composantes de ces éoliennes. Les travailleurs maritimes, habitués aux conditions océaniques, pourraient se requalifier dans les activités d’installation et de maintenance.
Ces compétences locales sont des atouts clés pour créer un pôle éolien dynamique au large des côtes et ainsi attirer d’autres investissements dans la région, comme la construction d’un port en eau profonde ou d’un centre logistique avec à la clé des centaines d’emplois.
L’exemple du Danemark démontre qu’un alignement stratégique entre les compétences existantes et les besoins d’une industrie émergente peut être un facteur décisif de succès dans le développement d’un secteur.
Les gouvernements doivent donc faire davantage pour garantir que les communautés plus fragilisées puissent bénéficier pleinement de la vague de projets à venir. Cela signifie de créer des parcours de requalification accessibles, de lier les stratégies de développement économique et de main-d’œuvre et de faciliter les partenariats entre les établissements d’enseignement, employeurs et autres acteurs locaux.
Dans notre plus récente note d’orientation, nous recommandons trois leviers pour adopter une approche efficace et coordonnée du développement local des compétences dans les communautés à risque.
Les compétences sont un service essentiel
Tout d’abord, les gouvernements doivent financer des programmes de formation qui répondent aux enjeux spécifiques des communautés concernées, que ce soit l’installation d’infrastructures d’énergies renouvelables, le traitement de minéraux essentiels, la fabrication de pointe, etc.
Au lieu de limiter le financement à des secteurs ou à des profils de candidats prédéterminés, il faut permettre aux partenaires locaux (employeurs, syndicats, collèges, organismes communautaires) de proposer des solutions innovantes et alignées sur les priorités économiques régionales.
Ensuite, il faut mobiliser les organismes d’aide au développement des collectivités. Déjà présents dans plusieurs régions vulnérables, ces organismes financés par le gouvernement fédéral et ancrés localement sont bien placés pour arrimer développement économique et développement des compétences.
Plusieurs d’entre eux ont déjà des relations avec les gouvernements et des employeurs locaux. Ce sont des bases qui pourraient servir pour d’autres programmes. Avec des mandats et des ressources élargis, ces organismes pourraient jouer un rôle central pour coordonner les formations nécessaires au développement économique.
Enfin, lorsque des projets d’envergure sont mis en œuvre, tous les paliers de gouvernements devraient faciliter la création de partenariats entre entreprises locales, syndicats, établissements d’enseignement et autres acteurs clés. L’objectif : combler les écarts de compétences avant le début des travaux de construction et non après l’apparition de pénuries de main-d’œuvre qualifiée.
La conjoncture actuelle offre des occasions sans précédent aux communautés canadiennes. Alors que le gouvernement s’apprête à lancer une série de grands projets, il devrait intégrer le développement des compétences dès leur phase d’approbation. Chaque projet de mine, d’énergie ou de transport d’électricité devrait être accompagné d’un engagement à développer les compétences locales.
Le moment est venu de considérer les compétences comme une infrastructure essentielle, tout aussi importante que les routes, les ports et les lignes électriques qui façonneront l’avenir économique du Canada.