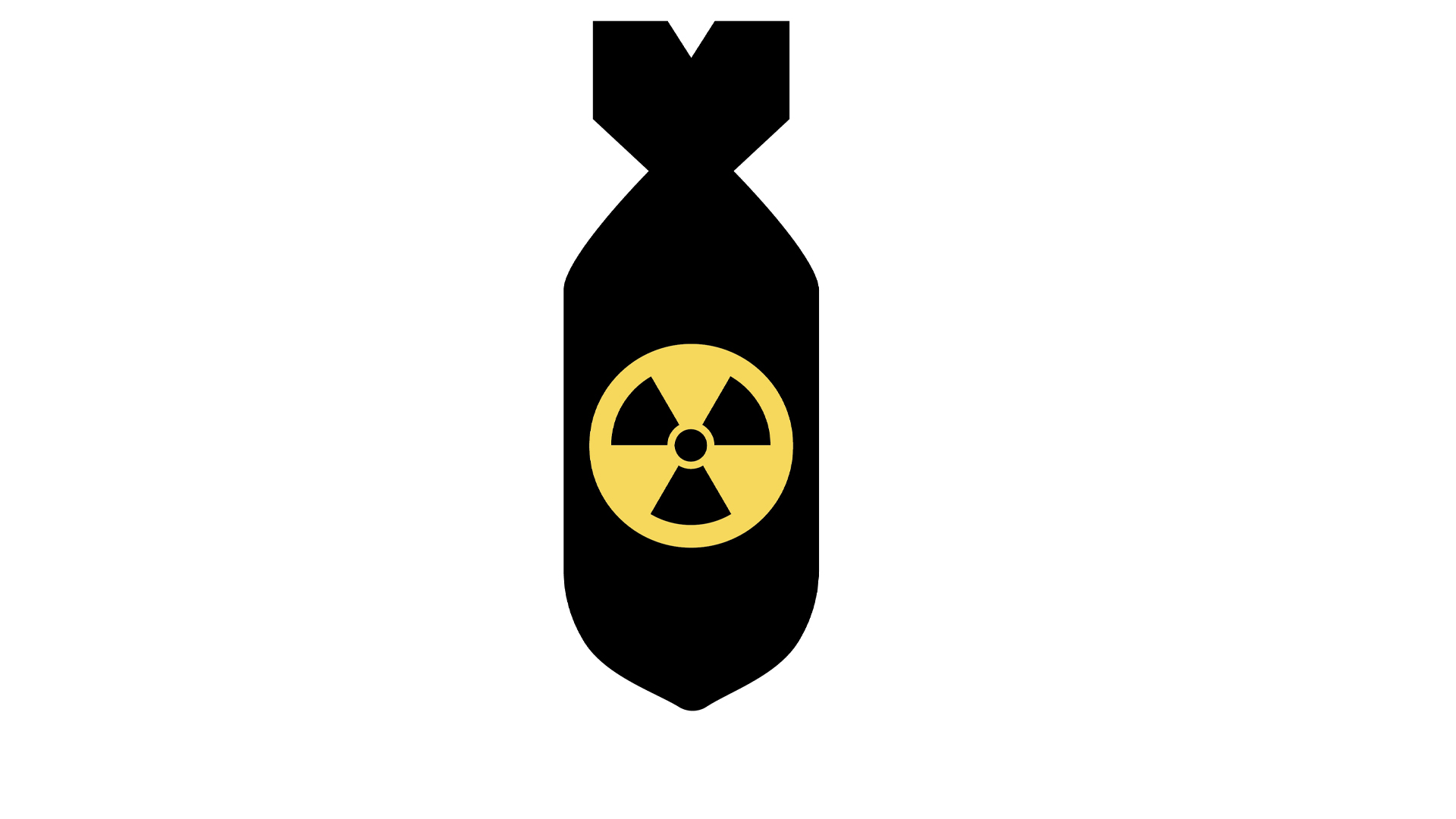Depuis la publication du rapport Parent, la place de l’éducation au Québec s’est considérable- ment accrue. Au niveau universitaire, notre population s’est scolarisée plus rapidement que n’importe quelle autre en Amérique du Nord. Certains ont mé‚me parlé d’un « miracle québécois ». Les progré€s de la scolarisation et du développement universitaire au Québec sont des réussites spectacu- laires qui doivent é‚tre saluées. Il ne nous est cependant pas loisible d’en rester laÌ€. Des défis majeurs se présen- tent aÌ€ nous, des défis qui interpellent nos universités de manié€re critique aÌ€ la fois dans leur roÌ‚le universel et dans leur roÌ‚le de véhicule privilégié du développement du Québec.
Au premier chef, et sans reprendre le débat présocratique, il est clair que notre réalité empirique est en évolu- tion rapide. Il suffit de prendre pour exemple les nouveaux défis épidé- miologiques, les avatars des questions de sécurité nationale, l’impact des phénomé€nes naturels et climatiques extré‚mes, les bouleversements de l’échiquier politique, les problé€mes d’éthique que soulé€vent les progré€s scientifiques, les enjeux énergétiques, l’impact de la Chine et de l’Inde dans le commerce international, etc. Autant de questions qui requié€rent le développe- ment par la recherche de connaissances nouvelles, autant de questions qui requié€rent la formation de citoyens de mieux en mieux équipés pour y répon- dre, autant de questions qui justifient cette affirmation déjaÌ€ galvaudée selon laquelle la société qui se profile sera de plus en plus celle du savoir, autant de questions qui imposent aux universités d’évoluer pour é‚tre pertinentes.
Le deuxié€me défi a aÌ€ voir avec le déclin démographique qui confronte le Québec, au milieu de tous ces enjeux liés aÌ€ la mondialisation. Notre population vieillit. Dé€s 2012, la proportion de la po- pulation active va commencer aÌ€ dimi- nuer, tandis que des pays comme l’Inde et la Chine disposeront d’un bassin quasi illimité de main-d’œuvre qualifiée.
Dans ce contexte, notre atout prin- cipal est celui de la qualité. Il nous faut optimiser le développement de notre capital humain. L’innovation est la voie de l’avenir pour le Québec. Il nous faut augmenter l’accé€s et la participation aÌ€ nos programmes universitaires et offrir ce qu’il y a de mieux en enseignement supérieur. LaÌ€ encore, nos universités sont interpellées de manié€re critique. Mais, alors mé‚me qu’elles s’efforcent de relever ces défis, elles sont soumises aÌ€ une tension qu’on pourrait qualifier de schizophrénique en raison de l’état pitoyable de leurs finances ”” un état d’autant plus grave au Québec.
Il y a trois semaines, deux documents sont venus souligner la gravité de la situation. L’un est le manifeste « Pour un Québec lucide », l’autre est le « Rapport sur l’accé€s aÌ€ l’éducation » qui avait été commandé dans la foulée du Forum des générations aÌ€ un comité présidé par Michel Gervais.
Les deux documents font état du roÌ‚le vital de l’éducation pour l’avenir du Québec, soulignent la situation pré- caire de nos universités et réclament de toute urgence la tenue d’échanges sur le financement universitaire. En mé‚me temps, le rapport Gervais rappelle que en 1966, nous étions 41 p. 100 au Québec aÌ€ placer l’éducation en té‚te des priorités que devrait avoir notre gou- vernement, alors que aujourd’hui, nous ne sommes plus que 5 p. 100. Ces chiffres sont préoccupants, compte tenu de l’effort collectif qu’il nous fau- dra faire pour redresser la situation.
Pour se démarquer, nos universités doivent pouvoir tabler sur la qualité. Elles doivent également garantir l’ac- cé€s aux études, offrir la meilleure for- mation possible et é‚tre une source distinctive d’idées et de découvertes. Souvenons-nous qu’il s’agit laÌ€ de nos meilleurs atouts dans un contexte mar- qué par le déclin démographique et la mondialisation. Pour se prévaloir de tels atouts, il nous faut cependant dis- poser de ressources suffisantes. Et nous sommes tré€s loin de les avoir.
Sur ce point, rappelons que l’on a unanimement reconnu, il y a deux ans, lors de la Commission parlementaire sur le financement des universités, que le réseau universitaire québécois souf- frait d’un sous-financement relatif, par rapport au reste du Canada, de 375 mil- lions de dollars par année.
Depuis, la situation s’est détériorée. Sur la recommandation de l’ancien pre- mier ministre Bob Rae, le gouvernement ontarien de Dalton McGuinty annonçait au printemps dernier des investisse- ments de 8 milliards de dollars étalés sur cinq ans dans l’enseignement supérieur et la recherche. En Alberta, le gouverne- ment Klein vient de consentir une aug- mentation de plus de 30 p. 100 échelonnée sur trois ans au budget de l’enseignement supérieur.
Pour les universités québécoises, le sous-financement a des répercussions sur tous les aspects de la vie académique, et en particulier sur la taille des classes. L’Université de Montréal affiche actuellement un ratio de 22 étudiants par professeur, contre une moyenne de 19 au sein des grandes universités de recherche du reste du pays. Pour offrir le mé‚me taux d’encadrement que ses homologues canadiennes, l’Université de Montréal devrait embaucher 200 pro- fesseurs dé€s aujourd’hui. CouÌ‚t de l’opération : 20 millions de dollars.
En fait, les universités québécoises ne se sont jamais remises des coupes budgétaires qu’elles ont subies au milieu des années 90. Ces compressions se sont traduites par l’abolition de centaines de postes de professeur ”” en gros, l’équiva- lent du corps professoral de l’UQAM au grand complet. Certes, elles ont depuis regarni leurs rangs, notamment graÌ‚ce au réinvestissement consenti par le gou- vernement du Québec entre 2000 et 2002, mais le nombre de professeurs reste aujourd’hui inférieur aÌ€ ce qu’il était en 1994, tandis que le nombre d’étu- diants, lui, a augmenté.
Au-delaÌ€ des problé€mes de sous- financement particuliers aux uni- versités québécoises, il faut aussi réaliser que les universités canadiennes prises dans leur ensemble ne sont pas concur- rentielles par rapport aÌ€ celles des autres pays et des EÌtats-Unis en particulier. L’Association des universités et collé€ges du Canada estime que, entre 1980 et aujourd’hui, le financement gouverne- mental par étudiant du systé€me univer- sitaire public a augmenté de 25 p. 100 aux EÌtats-Unis pendant qu’il chutait de 20 p. 100 au Canada. En 2004, les revenus par étudiant des universités américaines du réseau public dépas- saient de 5 000 $ ceux des universités canadiennes ”” de 8 000 $ si l’on tient compte des droits de scolarité.
On doit s’occuper de cette ques- tion de manié€re urgente. Par le truche- ment du Conseil de la Fédération, les premiers ministres se sont entendus pour placer l’éducation postsecondaire au sommet de leurs priorités et ont prévu la tenue en janvier d’un forum sur la question coprésidé par MM. Charest et McGuinty.
Au cours des dernié€res années, le gouvernement fédéral a mis sur pied des programmes qui ont stimulé grandement la recherche universitaire canadienne, des programmes tels le programme des frais indirects de la recherche, la Fondation canadienne pour l’innovation et les Chaires de recherche du Canada. La stratégie d’in- novation est d’une telle importance pour le Canada que le temps est venu, je pense, de mettre sur pied aÌ€ l’échelle canadienne un plan ambitieux et inté- gré sur l’éducation postsecondaire.
Ce plan devrait comprendre des élé- ments de soutien direct et indirect aux universités. Il devrait consolider les programmes existants d’aide aÌ€ la recherche de manié€re aÌ€ accroiÌ‚tre les retombées des travaux de nos chercheurs et augmenter aÌ€ un niveau concurrentiel l’aide aux étu- diants des cycles supérieurs. Ce plan devrait aussi é‚tre assorti de transferts afin de subvenir aux opérations générales des universités et d’accroiÌ‚tre leur capacité d’accueil et d’encadrement au premier cycle.
Reste que, pour le Québec, il est impérieux de mettre sur pied, comme le réclament le manifeste Bouchard et le rapport Gervais et comme l’annonce le ministre de l’EÌducation Jean-Marc Fournier, une table pour examiner et résoudre sans tarder la question du sous-financement relatif des univer- sités québécoises.
Adoptons une approche qui pri- vilégie l’ouverture et la raison. Regardons les faits, appuyons-nous sur nos valeurs et trouvons des solutions.