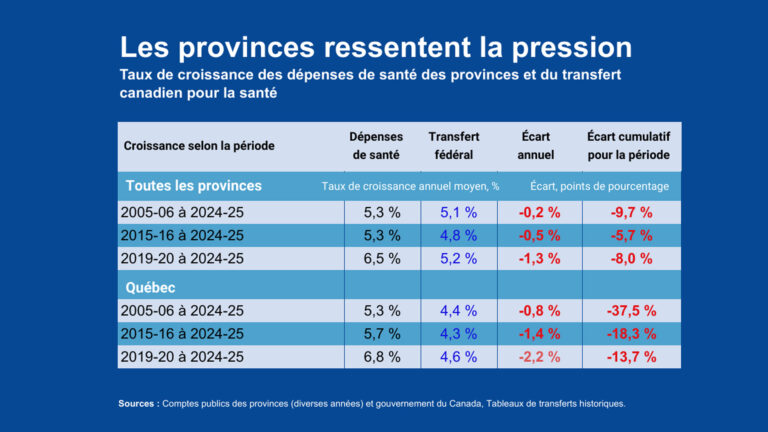(English version available here)
Quelques semaines avant de mourir d’un cancer du sein, mon épouse Suzanne a écrit des lettres posthumes à nos enfants, Alex et Sophia, qui avaient alors 18 et 14 ans. Ce fut un effort immense, alors qu’elle était au stade avancé de sa maladie.
Près de cinq ans plus tard, le jour de son 19e anniversaire, j’ai accompagné notre fille qui se faisait tatouer pour la première fois. Un moment chargé d’émotions. Sur son avant-bras, elle a fait inscrire, textuellement, les derniers mots de la lettre de sa mère : « Câlins. Tellement de câlins, Sophia. »
Le deuil peut parfois contenir une forme de beauté, voire de la poésie. Car ce n’est pas un trouble psychologique, mais une réponse naturelle à une perte profonde. Mais le deuil n’est pas bénin pour autant. Dans ses premières phases, il se manifeste par des symptômes, comme l’insomnie et la fatigue, des montagnes russes émotionnelles et cette impression d’entendre la voix de l’être cher ou même de sentir sa présence.
« [Le deuil] affectait ma respiration et me causait des douleurs à la poitrine. J’ai cru que j’allais mourir de chagrin ! Ça a été un choc pour mon corps », a déjà raconté un répondant à un sondage de l’Alliance canadienne pour le deuil (ACD), que je copréside.
« Le deuil peut arriver par vagues », a dit un autre. « On peut aller mieux, puis un souvenir surgit et tout revient. Le deuil, ce n’est pas quelque chose qu’on surmonte. C’est quelque chose avec quoi on apprend à vivre et qu’on intègre à notre quotidien. »
Avec le temps, et grâce à la compassion et à la compréhension des autres (et envers soi-même), plusieurs d’entre nous arrivent à rebondir. Après des années difficiles, nous poursuivons notre chemin. Même si Alex et Sophia porteront toujours le deuil de leur mère dans leur cœur, ils ont repris leur trajectoire de vie, et moi aussi.
Mais les chercheurs dans ce domaine le constatent : beaucoup de personnes ont du mal à rebondir. Pour un bon nombre d’entre elles, le deuil persiste plus longtemps que la moyenne. Non seulement la souffrance perdure, mais les symptômes, tant physiques que psychologiques, refusent de se laisser apprivoiser. C’est en partie parce que peu de gens savent à quoi s’attendre lorsqu’ils vivent une perte profonde, ce qui rend la tâche de s’aider soi-même ou d’aider les autres plus difficile.
Pour une minorité non négligeable, le deuil peut entraîner une dépression ou de l’anxiété clinique, une consommation problématique de substances, voire une maladie mentale. Un deuil prolongé ou inextricable peut affecter le travail, la productivité et la stabilité des relations. Cela engendre des coûts financiers pour les familles, les employeurs, ainsi que les services de santé et sociaux.

Et pourtant, parce que le deuil est considéré comme une réaction normale à une perte importante, et non comme une maladie mentale, il est souvent exclu, à tort, des politiques en santé mentale. S’adapter sainement au deuil fait pourtant de toute évidence partie d’une bonne santé mentale.
Pour atteindre cet objectif, l’ACD recommande cinq mesures concrètes, tirées d’un projet de deux ans financé par Santé Canada sur la littératie du deuil. Ces recommandations incluent des campagnes de sensibilisation, une approche de soutien axée sur la santé publique, l’amélioration de la formation des professionnels et bénévoles offrant des services d’accompagnement du deuil, une meilleure compréhension du deuil par la collecte de données et le financement de la recherche, ainsi que la création d’un centre canadien du deuil pour coordonner les politiques dans ce domaine.
Améliorer les services aux endeuillés
Dans le cadre de son projet, l’ACD a sondé près de 4 000 Canadiens et consulté 300 experts et professionnels. Nous avons aussi organisé des symposiums sur le deuil chez les enfants et les jeunes avec l’aide de nos partenaires et lancé un site Web rempli de ressources pour les personnes endeuillées ou leurs proches aidants.
Aujourd’hui, les services liés au deuil sont au mieux fragmentaires. Les nombreux professionnels, qu’ils soient médecins, infirmières, intervenants d’urgence, travailleurs sociaux ou même spécialistes en santé mentale, n’ont que peu ou pas de formation pour accompagner les personnes endeuillées. Et les services existants concernent plus souvent les patients en fin de vie.
« Une fois le patient décédé, les proches sont laissés à eux-mêmes par le système, sans aucun suivi », nous a confié un répondant durant nos consultations.
Contrairement à l’Australie, l’Irlande ou le Royaume-Uni, le Canada ne dispose d’aucune structure pour répondre aux impacts du deuil sur la société. Il n’existe aucune approche nationale concertée ni réseau solide à cet égard.
Nous n’avons aucune politique publique pour venir en aide aux proches des victimes de catastrophes, comme l’accident d’autobus de Humboldt, la tuerie de masse en Nouvelle-Écosse ou les feux de forêt annuels qui causent des pertes importantes. Il en va de même pour la crise du fentanyl ou les sépultures anonymes dans les pensionnats autochtones. La société n’a pas ce qu’il faut pour offrir une réponse coordonnée aux deuils provoqués par ces tragédies.
Dans le sondage de l’ACD, seulement la moitié des répondants ont dit se sentir bien soutenus dans leur deuil. Neuf sur dix ont dit trouver utile qu’on leur parle de leur perte. Pourtant, la gêne, la peur ou les inhibitions sociales poussent souvent les proches à éviter le sujet, croyant à tort rendre service à la personne endeuillée.
Leçons tirées de la COVID-19
C’est au début de la pandémie, en 2020, que nous avons fondé l’ACD. Nous étions un petit groupe de proche-aidants réunis par l’entremise du Portail canadien en soins palliatifs.
Nous anticipions une pandémie parallèle de deuil. Non seulement parce que des milliers de personnes allaient mourir, mais aussi parce que les circonstances exceptionnelles de l’époque privaient les proches endeuillés des rituels habituels, comme la possibilité d’être au chevet du mourant, de tenir des funérailles et de pouvoir se consoler dans les bras de leurs proches.
Nous avions aussi pressenti que la pandémie allait provoquer d’autres formes de deuil comme des pertes d’emploi et de revenu, la perte de liens sociaux ou d’un animal de compagnie. Ces événements pouvaient parfois être vécus très difficilement en raison de l’isolement imposé par les mesures sanitaires.
L’ACD a rapidement obtenu l’appui de 170 organisations, dont l’Association médicale canadienne, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et l’Association canadienne de psychiatrie, ainsi que des dizaines d’autres associations professionnelles et organismes de services préoccupés par l’absence de soutien au deuil.
À la suite de notre projet de deux ans, nous avons publié notre plan d’action pour les prochaines étapes, qui propose une stratégie pour améliorer la littératie en matière de deuil et les services à cet égard au Canada.
Au fil de nos recherches, nous avons été frappés par le retard du Canada par rapport à des pays comparables. Le Royaume-Uni, l’Australie et l’Irlande ont tous adopté une approche de santé publique en matière de deuil, souvent illustrée par le « modèle pyramidal irlandais ».
La majorité des personnes (Niveau 1) arrivent à vivre leur deuil avec le soutien de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues de travail et de leur communauté. Nous pouvons les aider grâce à l’éducation du public, en mobilisant des ressources relativement modestes.
Un plus petit nombre de personnes (Niveau 2) peuvent bénéficier d’un soutien plus structuré, comme les groupes de soutien au deuil, souvent animés par des bénévoles. Nous pouvons améliorer l’accessibilité de ces groupes et renforcer la formation des bénévoles qui les animent.
Un groupe encore plus restreint (Niveau 3) aura besoin de services spécialisés en accompagnement du deuil ou en santé mentale, offerts par des professionnels spécialement formés.
Le groupe le plus réduit (Niveau 4) est celui qui présente les besoins les plus complexes. Il est composé de personnes vivant un deuil compliqué et nécessitant l’aide de psychiatres ou d’autres thérapeutes spécialisés. Nous ne disposons pas de données précises au Canada, mais, dans d’autres pays, on estime que ce groupe représente environ 15 % des personnes endeuillées.
Notre plan stratégique propose cinq recommandations pour faire évoluer le Canada vers un modèle de santé publique en matière de soutien au deuil, semblable à ceux mis en place dans d’autres pays.
La première consiste à encourager des campagnes et programmes de sensibilisation communautaires pour accroître la compréhension publique du deuil. L’idée est d’aider les gens à s’aider eux-mêmes.

La deuxième est d’élaborer une stratégie fédérale visant à développer les services de soutien qu’implique une approche de santé publique. Cette stratégie devrait être conçue en collaboration avec des professionnels et des organismes spécialisés en deuil, les autres paliers de gouvernement, ainsi que les communautés autochtones et racisées. Elle devrait recenser les approches prometteuses pouvant être reproduites à grande échelle et inclure du financement destiné d’abord aux populations plus vulnérables.
La troisième est d’améliorer la formation des professionnels et des bénévoles qui accompagnent les personnes endeuillées. Cela comprend la mise en place d’une formation standardisée pour les bénévoles, de même que des programmes le développement de compétences reconnues pour les professionnels. Elle permettrait également de renforcer le réseau national sur le deuil mis sur pied par l’ACD.
Une quatrième recommandation est de fournir les données nécessaires à l’élaboration de politiques et de programmes, qui font défaut au Canada, mais existent dans d’autres pays. Cela signifie recueillir des données à l’échelle nationale, créer un réseau de recherche sur le deuil et consacrer des fonds à la recherche dans ce domaine.
Enfin, notre dernière recommandation est de créer un Centre canadien pour le deuil, qui coordonnerait ces initiatives. Il s’inspirerait du modèle australien Grief Australia, une organisation très efficace mise en place il y a une trentaine d’années à faible coût. Ce nouveau centre canadien appuierait le développement de politiques aux différents paliers de gouvernement ainsi que dans le secteur privé.
Il offrirait aux décideurs canadiens une capacité dont disposent déjà leurs homologues ailleurs, mais qui nous manque ici : celle de réagir rapidement en période de crise. Par exemple, Grief Australia a pu intervenir rapidement pendant la pandémie de COVID-19, comme elle l’avait fait lors de crises précédentes, quand les gouvernements ont reconnu le besoin d’agir.
Un investissement dans le capital humain
Le deuil n’est pas un enjeu partisan. Nous vivons le deuil parce que nous sommes humains.
À la dernière assemblée parlementaire, tous les partis ont appuyé un projet de loi présenté par le député conservateur Matt Jeneroux. Celui-ci propose de réformer le Code canadien du travail pour y inclure dix jours de congé payés aux membres de la famille d’une personne décédée.
Lors de la campagne électorale d’avril, le premier ministre Mark Carney a promis d’investir dans les hôpitaux, les cliniques et les ressources en santé mentale. Ces infrastructures doivent inclure des mesures pour accompagner le deuil. Car au-delà du soulagement de la souffrance de nos proches, amis et voisins, c’est un investissement dans notre capital humain.
Les personnes qui vivent leur deuil de manière saine sont plus susceptibles d’être heureuses dans leur vie familiale, plus productives au travail, et de générer moins de coûts pour nos systèmes de santé et de services sociaux. Cela contribuera à bâtir un Canada plus fort.