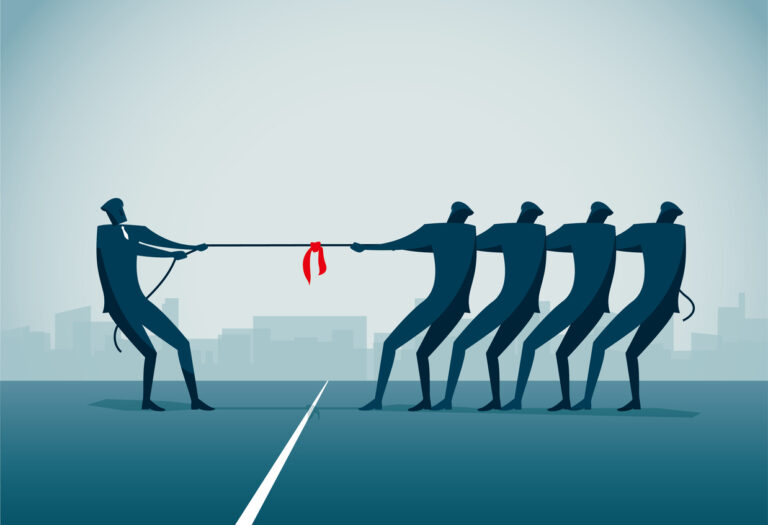(English version available here)
La majorité de Canadiens hors Québec ne perçoivent plus le bilinguisme comme un idéal à défendre. Selon un sondage réalisé plus tôt cette année, seulement 35 % d’entre eux ont une perception positive du bilinguisme officiel. Un pourcentage semblable estime que le bilinguisme est au cœur de l’identité canadienne. Encore plus inquiétant est le constat que seulement 19 % des répondants pensent qu’il est très important (et 24 % qu’il est plutôt important) que le Canada reste un pays officiellement bilingue.
Cette perception négative n’est pas surprenante. Le modèle canadien du bilinguisme est de plus en plus éloigné de la réalité. La défense du bilinguisme canadien serait mieux servie si elle était formulée en termes plus proches du modèle suisse, garantissant des espaces sécuritaires pour les deux langues du pays. La bonne nouvelle est que le Canada évolue de facto dans cette direction, même s’il n’est pas politiquement acceptable de le dire aussi ouvertement.
Le bilinguisme officiel a ses limites
Le bilinguisme officiel ne peut pas arrêter le déclin du français hors Québec, et on ne doit pas lui demander de le faire.
La vision du bilinguisme de Pierre Elliott Trudeau, incarnée par la Loi sur les langues officielles de 1969, répondait aux attentes de l’époque. Le message, notamment aux Québécois menaçant de faire sécession, était clair : tout le Canada vous appartient, et votre droit d’utiliser le français et d’instruire vos enfants dans cette langue est désormais protégé sur l’ensemble du territoire. La loi marquait une rupture audacieuse avec le passé, espérant réparer le triste héritage d’un siècle de lois anti-francophones dans le ROC.
Et ça a fonctionné. Le référendum de 1980 sur l’indépendance du Québec fut largement rejeté. Le Canada devait désormais être une nation bilingue (et être perçue comme telle), le bilinguisme une valeur canadienne fondamentale, les deux langues ayant désormais des droits égaux A mari usque ad mare.
Nous savons aujourd’hui que cette noble vision du bilinguisme n’a pas réussi à freiner le déclin du français, notamment hors Québec. Mais ce n’était pas l’intention initiale de la loi.
Les données sont bien connues. Selon le recensement de 2021, le français n’est plus la langue maternelle que de 3,2 % des Canadiens hors Québec. Pour la langue parlée à la maison, ce pourcentage tombe à 1,9 %. Cela nous dit qu’environ 40 % des francophones dans le ROC ne parlent plus leur langue à la maison, et donc que le déclin se poursuivra.
La modification de la Loi sur les langues officielles (C-13), adoptée en mai 2023, reconnaît ouvertement le déséquilibre croissant entre les deux langues officielles du Canada. Comme je l’ai noté précédemment, la nouvelle loi dit ce qu’il faut. Elle affirme sans ambages que le français, et non pas l’anglais, est la langue menacée, nécessitant protection. C-13 intègre formellement la Charte de la langue française du Québec (la loi 101), qui fait du français la langue officielle de la province, ce qui constitue sans doute la rupture la plus audacieuse et la plus controversée avec l’orthodoxie de l’ère Trudeau. Enfin, elle fait un pas timide vers la territorialisation des droits linguistiques en introduisant la notion de régions à forte présence francophone hors Québec (ou RFPF), à l’intérieur desquelles le droit de travailler en français dans les entreprises sous compétence fédérale doit être protégé.
Dans un autre article, j’avais fait des propositions pour renforcer le projet de loi C-13 – si l’objectif était bien de freiner le déclin du français à l’extérieur du Québec. Je reconnais avoir été naïf. Simplement, l’ADN de la loi de 1969, axé sur l’égalité des droits, l’empêche C-13 d’aller plus loin dans la protection du français. Je doute qu’un gouvernement fédéral, aussi bien intentionné soit-il, puisse aujourd’hui faire plus.
Les politiques fédérales peuvent chercher à mieux protéger le droit de travailler (ou d’être servi) en français, mais elles ne peuvent pas imposer le français sur le lieu de travail, comme le fait la loi 101 du Québec : cela reviendrait à priver les Canadiens de leur droit, égal, de travailler en anglais. Mais même dans l’hypothèse inconcevable où la législation fédérale arriverait à imposer le français dans les RFPF, les entreprises de compétence fédérale ne représentent qu’une petite fraction de l’emploi local hors d’Ottawa.
Le résultat se devine d’avance. Le Québec restera francophone à 80 % (plus ou moins), soutenu par la législation provinciale, tandis que le français disparaîtra progressivement, sauf exception, ailleurs au pays.
La consolidation linguistique est un phénomène naturel
Dans des pays comme la Suisse, la Belgique et la Finlande, les droits linguistiques – par exemple en matière d’éducation – sont liés au territoire afin, précisément, d’éviter des confrontations linguistiques où la langue la plus forte finit par assimiler la plus faible. L’objectif est le maintien d’« espaces sécuritaires » pour les communautés linguistiques du pays, le bilinguisme étant essentiellement limité aux symboles de l’État et aux relations avec le gouvernement national.
Le déclin de la langue la plus faible est une simple question d’arithmétique. À l’exception notable des communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick où les francophones représentent souvent 80 % ou plus de la population, les francophones hors Québec sont en train de perdre leur langue presque partout.
Le mariage est souvent le vecteur de l’assimilation par l’intermédiaire de la langue parlée à la maison, alors transmise à la génération suivante. La probabilité de trouver un conjoint de même langue maternelle (dans ce cas-ci le français) est essentiellement fonction du poids des locuteurs de cette langue dans la population locale, probabilité qui diminue à mesure que son poids baisse. À cela s’ajoute la faible probabilité que le (ou la) conjoint(e) parle effectivement la même langue. Hors du Québec, seulement 7,4 % des anglophones comprennent le français, contre 85 % des francophones qui parlent l’anglais. Il est facile de deviner qui l’emporte lorsque les deux se rencontrent.
Le français survivra sans doute dans les bastions acadiens et des îlots linguistiques comme Hearst, dans le nord de l’Ontario. Mais il s’agit souvent de communautés périphériques en déclin, ce qui explique en partie pourquoi le français y survit. Dans aucun des grands centres urbains hors Québec les francophones n’ont pu éviter l’assimilation, y compris dans des centres comptant une importante population francophone comme Sudbury et Ottawa. Même à Moncton, centre culturel de l’Acadie et seule ville hors Québec avec une grande université francophone, un tiers des francophones n’utilisent plus leur langue à la maison.
Favoriser l’immigration francophone – sans doute la mesure politique la plus puissante du gouvernement fédéral – peut donner un coup de pouce temporaire et bienvenu aux communautés francophones locales, mais ne changera pas les forces sous-jacentes à l’assimilation. Les immigrants finissent par adopter le comportement des natifs.
L’essor de l’anglais, nouveau moteur de la séparation linguistique
La cohabitation entre les deux langues officielles du pays serait plus simple si l’une des deux n’était pas l’anglais. La montée en puissance de l’anglais comme langue mondiale, dopée par l’arrivée d’internet, a eu pour effet d’accélérer le clivage linguistique. À l’extérieur du Québec, elle amplifie l’attrait de l’anglais; tandis qu’au Québec, elle conduit le gouvernement à renforcer la protection du français, la loi 96 en étant l’exemple le plus récent.
Cela nous mène à un paradoxe de la dynamique linguistique canadienne. Plus l’anglais monte, plus le Québec se sentira justifié de renforcer les restrictions sur l’emploi de la langue de Shakespeare. Imaginez si – Oh malheur! – le recensement de 2026 devait montrer que le français recule toujours au Québec. On entend déjà les appels à de nouvelles restrictions.
D’autre part, plus l’anglais monte, plus les tribunaux seront enclins à regarder d’un œil bienveillant les lois linguistiques québécoises, sans même parler du recours à la clause dérogatoire. Le résultat prévisible : une province où le français est de plus en plus protégé par la loi, et le reste du Canada, à l’exception (espérons-le) du Nouveau-Brunswick, de facto unilingue anglais.
La séparation linguistique est bonne pour l’unité nationale
Le paradoxe ultime est que la séparation linguistique est le meilleur antidote à la séparation politique. Pourquoi faire sécession si le Canada promet au Québec la sécurité linguistique et culturelle?
La plupart des Québécois, j’estime, voient aujourd’hui la quasi-disparition du français dans le reste du Canada comme un fait, regrettable bien entendu, mais qui n’a que peu d’incidence sur leur attachement – ou leur non-attachement – au Canada. Ce qui compte est la défense du français au Québec. Le sentiment de communauté de destin avec les francophones du ROC est en train de disparaître, l’abandon de l’identité commune « Canadien-français » au profit de « Québécois » étant la dernière étape de cette évolution somme toute inévitable.
À l’ouest de l’Outaouais, la majorité des Canadiens perçoivent aujourd’hui le renforcement législatif du français au Québec avec indifférence. L’opposition la plus vive au recours du Québec à la clause dérogatoire pour la loi 96 et aussi à l’inclusion de la loi 101 dans la nouvelle Loi sur les langues officielles est venue des porte-paroles de la minorité anglophone du Québec, et non du ROC.
Cependant, l’abandon total du modèle canadien de bilinguisme qui privilégie les droits individuels n’est ni possible ni souhaitable. Nous ne pouvons pas faire abstraction de l’histoire de peuplement du Canada qui, contrairement à l’Europe, a fait en sorte que des communautés linguistiques minoritaires sont réparties sur l’ensemble du territoire. Les diverses associations et institutions des communautés minoritaires, en partie financées par le gouvernement fédéral, enfants de la loi originale de 1969, méritent d’être soutenues. Elles continueront, comme il se doit, à défendre les droits linguistiques des communautés minoritaires.
Le défi pour un futur Canada bilingue est de savoir où mettre l’accent dans le discours public. Pourquoi ne pas dire ouvertement que l’objectif premier n’est pas de rendre tout le Canada bilingue (par exemple, de « forcer » les Albertains à apprendre le français), mais de s’assurer que chacune des deux grandes communautés linguistiques de la fédération canadienne dispose d’espaces sécuritaires pour croître et s’épanouir?
Je vois le Canada évoluer vers un modèle hybride qui, à l’instar de la Confédération suisse, reconnaîtrait la prérogative des membres constituants de donner la primauté à une langue (l’italien dans le canton du Tessin, par exemple), mais qui conserverait également des éléments d’un modèle fondé sur les droits individuels, en garantissant notamment aux minorités linguistiques l’accès à l’éducation dans leur langue
Dans ce modèle, le Nouveau-Brunswick pourrait peut-être envisager donner la primauté au français dans les municipalités où les Acadiens sont nettement majoritaires. Mais là, je rêve sans doute.