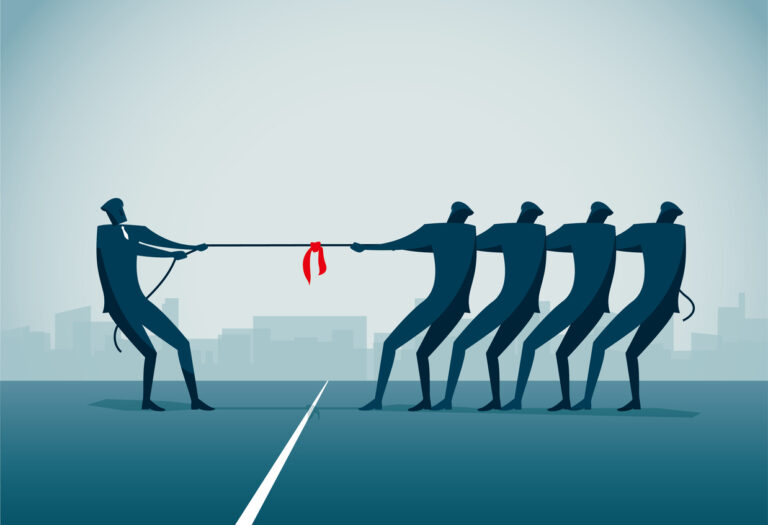Depuis le début de son mandat, l’administration Trump s’attaque aux processus démocratiques et judiciaires sur plusieurs fronts. L’une de ses initiatives les plus récentes vise à réduire les consultations publiques et à permettre aux agences américaines de retirer des règlements sans aviser ni consulter les parties concernées.
L’objectif de Trump est clair : alléger le corpus réglementaire. Cette initiative reflète l’approche réductionniste de la Maison-Blanche en matière de gouvernance, où l’efficacité (exprimée du point de vue de la réduction des coûts) prime souvent sur la transparence et la participation.
Une tendance des deux côtés de la frontière
Des deux côtés de la frontière, l’attrait de l’allégement réglementaire est bien réel, notamment pour stimuler la croissance économique et les investissements. Personne ne souhaite noyer les petites et moyennes entreprises sous la paperasse, retarder la construction de logements en multipliant les permis ou freiner l’innovation en interdisant l’adoption de nouvelles technologies.
C’est dans cet esprit que le gouvernement canadien a mis en place des directives pour contenir l’expansion de son corpus réglementaire et travaille activement à réduire l’impact des règlements sur les citoyens et les entreprises. Les travaux du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires sur la modernisation de la réglementation illustrent cet effort. De plus, depuis 2012, la règle canadienne du « un pour un » incite les ministères à abroger un règlement existant pour chaque nouveau règlement adopté.
Cependant, notre cadre réglementaire, comme celui des États-Unis, n’est pas né du jour au lendemain. Si certaines règles sont devenues obsolètes ou inutilement contraignantes, la grande majorité a été adoptée pour répondre à des besoins précis : orienter les comportements, corriger les défaillances du marché ou protéger la population contre des risques.
Les consultations publiques jouent un rôle essentiel
Par exemple, la légalisation du cannabis à des fins récréatives, en 2018, a nécessité l’établissement d’un cadre réglementaire complet, encadrant la production, la distribution et la consommation de cette substance nouvellement autorisée. De même, la tragédie de Lac-Mégantic a conduit à la mise en place de nouvelles règles concernant le transport des matières dangereuses. Un cadre réglementaire clair et solide peut même stimuler l’innovation en orientant les investissements vers des technologies plus sûres, plus efficaces ou plus durables.
Toutefois, réguler l’activité humaine reste une tâche complexe. Les impacts d’un règlement sont multiples et rarement anticipés dans leur totalité. D’une part, bien que les régulateurs soient des spécialistes, ils disposent de moins d’information actualisée que les acteurs qu’ils régulent, notamment sur les dernières innovations et pratiques du secteur; d’autre part, les outils d’analyse dont ils disposent ne capturent pas tous les effets des règles ou ne permettent pas de différencier leurs impacts selon les groupes affectés.
C’est pourquoi, au-delà des analyses internes, les régulateurs s’appuient sur des consultations publiques et répétées. Ces consultations jouent un rôle essentiel en ouvrant un canal d’information entre l’administration et ses parties prenantes, leur permettant de signaler des effets inattendus, des incohérences ou des obstacles potentiels.
Un outil pour contrebalancer le pouvoir
Au Canada, chaque nouveau règlement, amendement ou retrait doit faire l’objet de consultations publiques ouvertes, particulièrement lorsque les modifications peuvent avoir un impact important sur l’économie ou la sécurité des citoyens. Ces consultations, menées par les ministères et les agences du gouvernement du Canada, donnent accès aux régulateurs à des informations autrement inaccessibles à l’État, améliorant ainsi la pertinence, la réactivité et la légitimité des règlements.
Elles permettent aussi d’intégrer les préoccupations des parties prenantes dès l’élaboration, évitant ainsi l’adoption de règles vouées à être contestées ou à échouer lors de leur mise en œuvre.
Quand Ottawa utilise la Loi sur les langues officielles pour refuser l’accès à l’information
Trump, ou la démocratie contre elle-même
Comment éviter le syndrome du « pas dans ma cour » et construire plus de logements abordables
Les recherches ont démontré, dans le contexte canadien, que ces consultations permettent à des groupes normalement éloignés du pouvoir de s’exprimer et d’influencer significativement la nature des règlements. Elles contribuent, entre autres, à contrebalancer l’influence des acteurs industriels et à remettre en question le statu quo réglementaire.
Ces résultats s’inscrivent dans une perspective plus large, où les théories contemporaines de la gouvernance reconnaissent l’importance d’intégrer les voix de la société civile et des experts dans les décisions réglementaires. Ces approches remettent en cause le monopole traditionnel de l’administration publique sur la production et la sélection de l’information, et justifient l’ouverture des processus décisionnels à des acteurs externes.
Des enjeux qui ont des impacts concrets
Supprimer ou limiter ces consultations ouvertes, comme le fait l’administration américaine, entraînerait donc des répercussions directes sur la qualité des règles, la transparence des processus et la reddition de comptes. Ce serait aussi fragiliser un équilibre démocratique durement acquis.
Historiquement, les consultations publiques ont évolué en réponse aux critiques sur l’opacité des processus réglementaires, sa nature arbitraire, et l’exclusion des voix marginalisées. Réduire cet espace de dialogue, c’est risquer un retour vers une gouvernance plus technocratique, où les décisions sont prises derrière des portes closes, sans la contribution de ceux qui vivent au quotidien leurs effets.
Pour les Canadiens, l’enjeu est concret. Les quelque 3 880 règlements fédéraux en vigueur touchent presque tous les aspects de nos vies : de la longueur des cordes de yo-yo aux seuils d’émissions de gaz à effet de serre des véhicules utilitaires sport, en passant par les critères de commercialisation des OGM.
Réduire l’espace de dialogue autour de ces règles, c’est affaiblir notre capacité collective à les façonner, à les questionner et à les adapter. À l’heure où la confiance envers les institutions publiques est fragile, préserver ces mécanismes participatifs est plus important que jamais. Au lieu de chercher à les éliminer, nous devrions au contraire chercher à les améliorer.
Le Canada, qui a longtemps été un pionnier en matière de consultations publiques, ne doit pas sacrifier cet outil démocratique et stratégique, indispensable à l’élaboration de politiques publiques plus efficaces.