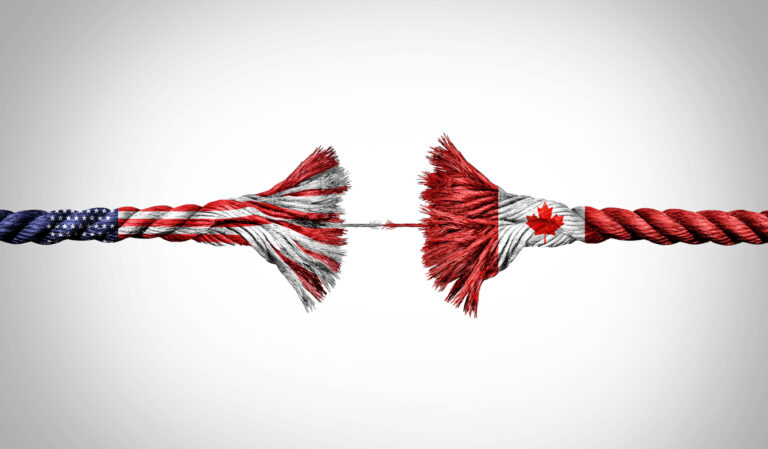Cet article est le premier d’une série en deux volets sur l’efficacité énergétique, un levier essentiel pour atteindre les objectifs climatiques du Québec. Le second texte présente les outils concrets nécessaires pour y parvenir.
L’électrification du mode de vie des Québécois exercera d’importantes pressions sur le réseau électrique d’ici 2050. Et, contrairement à ce que bien des gens croient, la décarbonation des ménages, des entreprises et des institutions exigera trois fois plus d’électricité que la venue d’entreprises qui cherchent à verdir leur activité en s’établissant au Québec. Ces pressions proviendront surtout de l’électrification des bâtiments.
À l’Institut du Québec (IDQ), nous avons réalisé une étude estimant l’impact des ambitions environnementales du Québec grâce à un simulateur développé par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal.
Concrètement, nous avons testé deux scénarios possibles pour voir comment la demande d’électricité pourrait évoluer dans les secteurs du bâtiment et du transport. Le premier scénario correspond aux cibles du Plan pour une économie verte 2030, et le second vise l’atteinte de la carboneutralité en 2050. Dans les deux cas, nous avons comparé la hausse de la demande par rapport à 2021, en portant une attention particulière aux pointes hivernales, qui représentent le véritable défi pour le réseau.
Un réseau sous pression
Au Québec, la notion de rareté relative de l’électricité est encore nouvelle dans les esprits. Depuis deux générations, son histoire énergétique a été celle d’un surplus de production, créant une perception d’abondance. Or, la situation a changé : tant en énergie qu’en puissance, les infrastructures actuelles ne suffiront bientôt plus à combler une demande propulsée par la nouvelle phase d’électrification.
Hydro-Québec, face à ce changement de paradigme, a formulé un plan d’action à l’horizon de 2035. Et du côté gouvernemental, le réexamen de la filière de production de l’électricité a mené à la création d’une Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives.
Le Plan d’action 2035 annonce qu’Hydro-Québec aura besoin d’ajouter 60 térawattheures (TWh) à son parc de production. Selon notre analyse des données, seul le quart de cette augmentation, soit 15 TWh, servira à nourrir une nouvelle demande issue de la croissance économique. Le reste, 45 TWh, correspond aux besoins pour décarboner l’économie conformément aux cibles climatiques.
Décarbonation et répartition de la demande
Si l’on décompose cette demande additionnelle visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles, un peu moins de la moitié (21 TWh) servira à électrifier les procédés industriels. Mais plus de la moitié (24 TWh) sera consacrée à l’électrification des transports et, surtout, au chauffage des bâtiments.
Ce point est crucial : encore aujourd’hui, près de la moitié (45 %) de l’énergie consommée pour le chauffage des bâtiments résidentiels et commerciaux au Québec provient de sources émettrices de CO2.
Pour mieux cerner où concentrer les efforts d’efficacité énergétique, les simulations de l’IDQ distinguent nettement l’impact de l’électrification des transports de celui des bâtiments.
Paradoxes de l’électrification
Les résultats révèlent quelques paradoxes intéressants. Ainsi, l’électrification des véhicules réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES), à hauteur de 22 % d’ici 2050. Toutefois, l’impact sur le réseau électrique sera nettement moindre, entraînant une hausse de la demande de puissance électrique de seulement 6 %.
Pourquoi ? D’abord, parce que les moteurs électriques sont nettement plus efficients que les moteurs à combustion, lesquels dégagent les trois quarts de leur énergie en chaleur plutôt que puissance motrice. De plus, la flexibilité de la recharge des batteries permet de la programmer en dehors des heures de pointe du réseau électrique.
Toutefois, l’électrification du chauffage des bâtiments exercera sur le réseau électrique une pression inverse et beaucoup plus considérable. Parce qu’il est difficile de reporter les besoins de chauffage en dehors des périodes froides, son électrification entraînera une forte hausse de la demande en puissance lors des pointes hivernales (+32 % en 2050), alors que l’effet sur la réduction des GES sera nettement plus modeste (-9 % en 2050).
C’est l’inflexibilité de cette demande de pointe, concentrée durant les quelques jours les plus froids de l’année, qui contraint Hydro-Québec à planifier des investissements massifs dans de nouvelles capacités de production. Les modélisations indiquent donc que l’électrification du secteur des bâtiments sollicitera cinq fois plus de puissance additionnelle que les transports
Objectif : efficacité énergétique
Pour répondre à cette hausse de la demande, Hydro-Québec a fixé un objectif ambitieux : dégager 21 TWh grâce à l’efficacité énergétique d’ici 2035. Cela équivaut à la consommation annuelle d’environ 1,2 million de ménages québécois, ou à trois fois la production du complexe hydroélectrique de la Romaine.
Pour y parvenir, la société d’État devra réaliser des gains annuels récurrents de 1,6 TWh, soit plus du double de sa performance des dernières années, à hauteur de 0,7 TWh. L’effort à fournir est donc considérable et sans précédent.
Notre analyse fait ressortir deux constats. D’abord, la priorité en matière d’électrification de l’économie devrait être d’améliorer rapidement l’efficacité énergétique des bâtiments, tandis que la priorité pour la réduction des GES doit cibler l’électrification des véhicules.
Un levier indispensable
Actuellement,Hydro-Québec se place sur la trajectoire d’efficacité énergétique la plus ambitieuse de son histoire et prévoit y investir 10 milliards d’ici 2035. Si elle n’y parvient pas, les investissements nécessaires pour augmenter la production seront encore plus importants que les 90 à 110 milliards estimés actuellement.
L’efficacité énergétique n’est donc pas une option parmi d’autres : elle sera plutôt le levier indispensable permettant au Québec d’atteindre simultanément ses ambitions économiques et environnementales.
Jamais auparavant le cadre réglementaire et les mesures en place n’ont permis de réaliser des économies d’énergie aussi importantes. Le Québec a fait des avancées notables depuis 2024, mais, comme le démontre notre étude (lire la partie 2), il devra lever de nombreuses barrières comportementales, financières, politiques et institutionnelles s’il veut atteindre ses cibles.