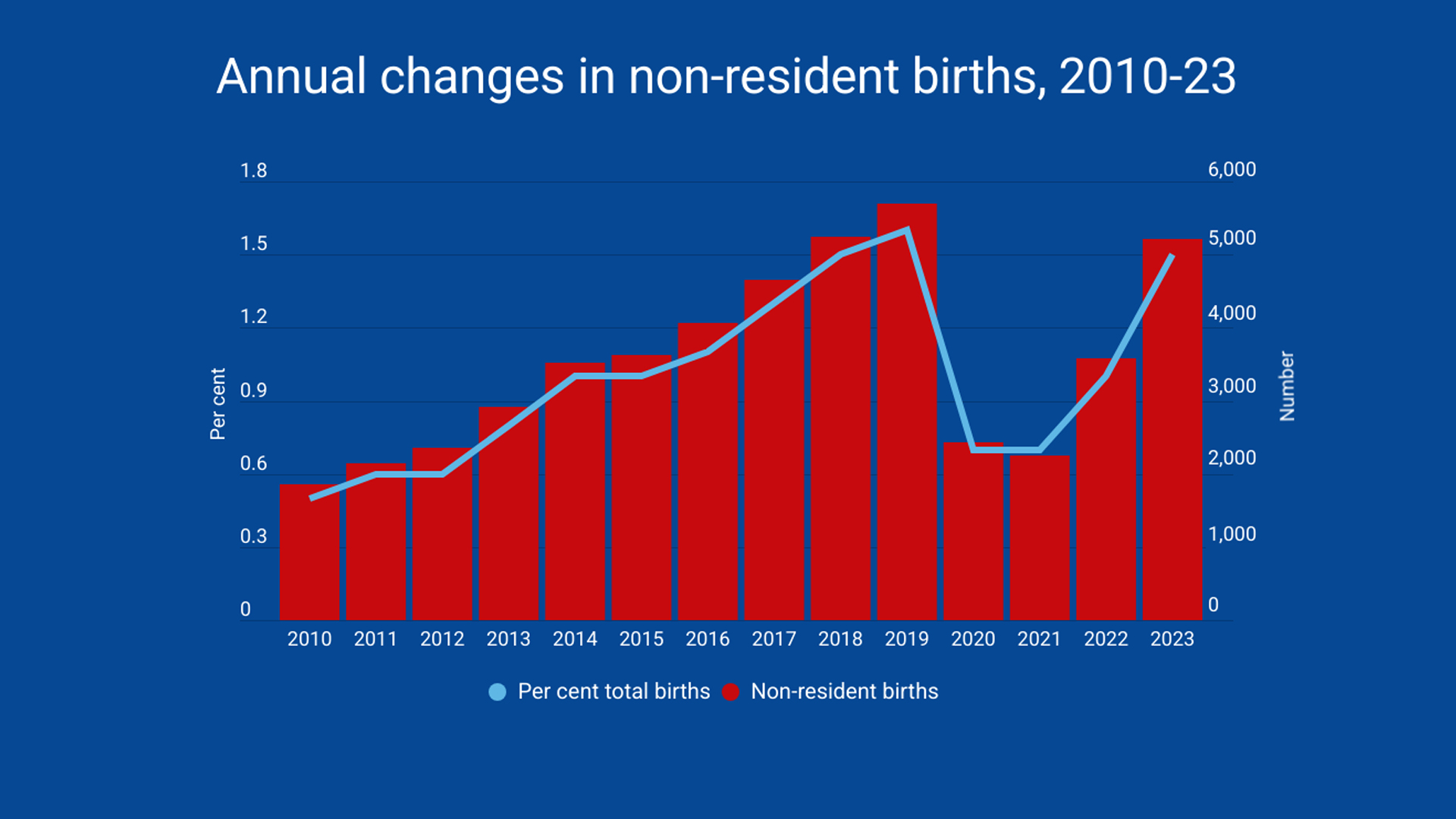Il y aura un avant et un après. Le monde ne sera plus le même après la pandémie de COVID-19. C’est sans doute vrai. Mais dans quel sens changerons-nous collectivement dans les années qui vont suivre ?
Mal en point économiquement, plus endettés que jamais et craintifs face aux risques de la mondialisation, nous pourrions connaître de dures années d’austérité et de repli sur soi, avec possiblement un creusage du sillon populiste qui mine déjà nos démocraties. En Hongrie, par exemple, la pandémie a été l’occasion pour le gouvernement Orbán de compléter son virage autoritaire. Ou, au contraire, nous pourrions apprendre de l’épreuve pour retisser nos solidarités, adopter des modes de vie plus durables et refonder sur de meilleures bases une nécessaire coopération entre les nations.
Austérité sévère ou solidarité renforcée ? Personne ne connaît la réponse. La trajectoire que nous prendrons dépendra d’une multitude de décisions et de gestes que nous poserons collectivement pendant et au sortir de la crise actuelle. Tout est possible.
Mais cette incertitude ne nous empêche pas de réfléchir et d’espérer. Nous savons des choses, en effet, à propos de grandes catastrophes internationales qui causent des milliers de morts et laissent des sociétés en ruine ou lourdement endettées. Les deux guerres mondiales ont été de cet ordre. C’est d’ailleurs à la guerre que les élus de tous les pays font référence pour mobiliser les citoyens contre le coronavirus. « La plus grande bataille de notre vie », a dit François Legault, dont nos enfants parleront encore dans 50 ans.
Or les grandes guerres changent durablement les sociétés, souvent pour les rendre plus solidaires. Richard Titmuss, pionnier de l’étude des politiques sociales, a été l’un des premiers à souligner, dès 1958, l’importance de la Seconde Guerre mondiale pour l’émergence de l’État-providence britannique. Comme le notent les politologues allemands Herbert Obinger et Carina Schmitt (2019), plusieurs facteurs concourent à faire des guerres et de leurs suites une occasion de renforcer la protection sociale : explosion des besoins, obligations envers les soldats et les citoyens qui ont fait des sacrifices, renforcement des capacités institutionnelles, hausse des revenus étatiques.
Un élément en particulier ressort, bien mis en évidence dans une étude désormais classique des politologues John Dryzek et Robert Goodin (1986) : le changement dans l’évaluation des risques encourus par chaque citoyen.
Pour comprendre la situation, il faut faire un peu de philosophie politique. Dryzek et Goodin posent d’abord que l’État-providence constitue un instrument de justice sociale, et que la justice sociale est principalement une affaire d’impartialité. L’État-providence se développera donc si les citoyens veulent accroître la justice sociale, vue comme une forme d’impartialité.
Pour concevoir une telle possibilité, le philosophe John Rawls (1971) avait évoqué un scénario fictif où chaque participant devait déterminer les paramètres de la redistribution derrière un « voile d’ignorance », sans savoir quelle serait sa propre position. La configuration la plus juste serait alors celle que les individus choisiraient avant de connaître leur propre situation sociale. C’est un peu comme la règle que se donnent deux enfants qui doivent partager un morceau de gâteau : tu coupes, je choisis.
Dans la réalité cependant, notent Dryzek et Goodin, les citoyens connaissent leur situation sociale et savent s’ils sont fortunés ou pas, s’ils vivent avec un handicap, ou s’ils sont en situation minoritaire. Le voile d’ignorance est loin d’être opaque. Conséquemment, le contexte le plus favorable à l’impartialité est celui qui engendre le plus d’incertitude sur le sort de chacun. C’est justement ce qui arrive pendant une guerre.
À Londres, pendant la Seconde Guerre mondiale, personne n’était vraiment à l’abri d’un bombardement, même si les plus riches avaient davantage de chances de se réfugier à la campagne. Tous faisant face à de grands risques, l’idée de mettre en commun les ressources et la protection sociale s’est imposée comme principe fondamental. Dès 1942, dans son rapport sur les assurances sociales, l’économiste libéral William Beveridge a mis en avant le principe de l’universalité comme socle de l’État-providence à construire.
Dans leur analyse comparative des deux grandes guerres, Obinger et Schmitt montrent que plus l’expérience de la guerre a été douloureuse dans un pays, plus la solidarité sociale a été renforcée dans les années suivantes.
En situation de grande incertitude, comme pendant une guerre ou à l’occasion d’une pandémie inédite, la demande pour un partage plus équitable de tous les risques devient particulièrement forte.
Dans un livre paru en 2016, le politologue Philipp Rehm généralise brillamment cet argument en montrant comment la distribution des risques dans une société façonne les choix sociaux. Dans une situation inégalitaire, où les grands risques concernent surtout les plus pauvres, la majorité a plus tendance à être indifférente et à prôner le chacun pour soi. C’est la situation qui prévaut largement dans les pays riches depuis quelques décennies. En revanche, si des risques nouveaux touchent une majorité de la population, pendant une longue dépression par exemple, le contexte sera plus favorable à la protection sociale. Enfin, en situation de grande incertitude, comme pendant une guerre ou à l’occasion d’une pandémie inédite, la demande pour un partage plus équitable de tous les risques devient particulièrement forte.
La pandémie actuelle menace tous les citoyens, directement ou indirectement. Ses effets sont loin d’être équitablement répartis. Pendant que certains maintiennent leurs revenus et font du télétravail bien à l’abri, d’autres perdent leur emploi ou courent davantage de risques, souvent dans des conditions difficiles et pour de petits salaires. Le risque d’être touché par le coronavirus est tout de même général, et il nous fait prendre conscience de l’importance des mécanismes collectifs de protection sociale ainsi que du rôle capital de personnes occupant des emplois humbles, mal rémunérés et peu protégés.
Dans ses messages quotidiens aux Québécois, François Legault insiste beaucoup sur le fait que c’est en équipe, « tous ensemble », que les Québécois pourront vaincre la menace posée par la COVID-19. Dans une de ces conférences de presse, il a même parlé de « nos sans-abris » pour inclure les plus mal pris.
Les difficultés seront nombreuses à l’autre bout de l’arc-en-ciel. Mais on peut espérer que les citoyens se souviendront de ces moments difficiles lorsque viendra le moment de repenser les pratiques et les institutions sociales de l’État.
Il sera temps en effet de remettre en question les écarts importants de revenu et de situation entre les personnes, les lacunes sérieuses de nos programmes de sécurité du revenu et les fragilités de notre système de santé. Ce sera l’occasion également, à l’échelle canadienne, de faire le bilan somme toute médiocre de notre État-providence. L’heure sera aussi venue de réinvestir dans la coopération internationale pour faire face ensemble aux incontournables enjeux globaux touchant le développement, la santé mondiale et les changements climatiques.
Cet article fait partie du dossier La pandémie de coronavirus : la réponse du Canada.
Photo : Shutterstock / Catherine Zibo