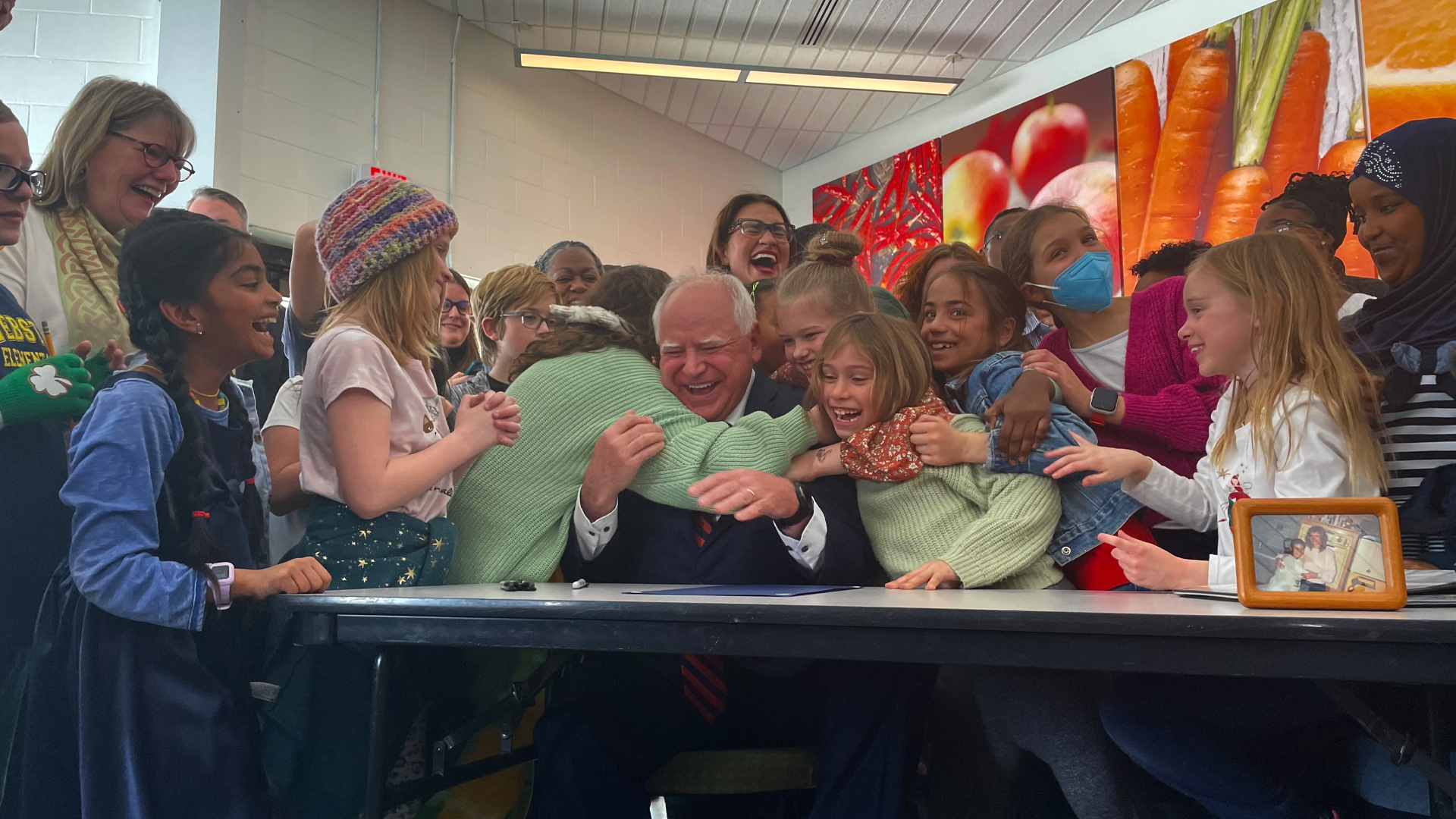Pour les adeptes de la prévision électorale, le tableau politique actuel aux États-Unis devrait, normalement, rendre la tâche infiniment plus simple qu’à l’habitude. Parmi les facteurs couramment cités par les prévisionnistes, on compte : l’état de l’économie (ça va mal) ; la popularité du président sortant (pas fameux) ; le succès ou l’échec des interventions militaires à l’étranger (sans commentaire) ; et le niveau relatif de participation aux primaires de chacun des deux principaux partis, auquel plusieurs spécialistes se fient.
Tous ces indicateurs favorisent les démocrates. De plus, pas besoin d’être fort en maths pour constater l’enthousiasme généré par leur campagne. Tout porte donc à croire que les démocrates voguent vers une victoire facile en novembre.
Mais, pour reprendre un proverbe de chez nous, il n’y en aura pas de facile.
Cet hiver, j’ai la chance d’observer la campagne depuis la capitale américaine, et pour ceux ici qui, comme plusieurs chez nous, attendent avec impatience le départ de celui qu’on juge déjà parmi les pires présidents de l’histoire, une question revient constamment dans les conversations : les démocrates réussiront-ils l’exploit de permettre qu’un républicain succède à George W. Bush ? Réussiront-ils, selon l’expression consacrée, à arracher la défaite des griffes de la victoire ?
Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer les capacités du républicain John McCain, mais l’adversaire le plus coriace des démocrates pourrait bien être leur propre parti. Tous connaissent la citation célèbre du cow-boy humoriste Will Rogers, au début du siècle dernier : « Je ne suis pas membre d’un parti politique organisé… Je suis un démocrate. »
Aujourd’hui, le parti réputé pour son désordre interne est dans de beaux draps. D’abord, les règles des primaires démocrates diffèrent de celles des républicains. Voulant privilégier le maximum d’expression démocratique, les dirigeants du parti ont choisi une formule d’attribution des délégués proportionnelle, plutôt que la formule plus tranchante du « tout au gagnant » (« winner take all »). Donc, dans le cas d’une lutte serrée, la marge entre les candidats de tête est presque assurée de rester infime. Mais le parti réserve de 15 à 20 p. 100 des places au congrès à des « super délégués », qui sont choisis parmi les élus, ex-élus et autres responsables du parti et qui ne sont pas liés par le vote populaire.
Voici donc le premier problème : après les primaires du Potomac (le 12 février), il est mathématiquement impossible à Hillary Clinton ou à Barack Obama de remporter la majorité des 4049 délégués au congrès de Denver en août en comptant uniquement sur les délégués liés au vote populaire. La pression sera donc grande sur les super délégués pour qu’ils ne viennent pas renverser la volonté exprimée par les électeurs.
À ce jour, la majorité des super délégués qui ont annoncé leurs couleurs appuient la sénatrice de New York, Hillary Clinton. Le scénario selon lequel une marge étroite des délégués « ordinaires » en faveur d’Obama pourrait être renversée par les élites du parti fidèles à Clinton donne des maux de tête aux démocrates. Comment expliquera-t-on aux partisans enthousiastes du sénateur de l’Illinois que les bonzes du parti se sont arrogé le droit de décider à leur place ? L’énergie des supporters d’Obama et l’espoir généré par sa campagne parmi des électeurs avides de renouveau sont les phénomènes marquants de ces primaires. Mais une victoire du clan Clinton acquise en catimini dans les corridors de l’aréna de Denver pourrait provoquer une réaction de méfiance chez ces nouveaux électeurs, qui les amènerait à tourner le dos au parti.
Comme si cela ne suffisait pas, le cafouillage qui a mené à l’exclusion des délégués du Michigan et de la Floride viendra presque certainement empoisonner les relations entre les deux principaux candidats d’ici au congrès. En bref, pour « punir » ces deux États d’avoir désobéi aux consignes du parti en devançant leurs primaires, les instances du parti ont décidé de retirer à leurs délégués le droit de voter pour le candidat présidentiel. Qu’à cela ne tienne, les autorités démocrates de ces États ont décidé de tenir leurs primaires quand même. Tous les candidats ont respecté les consignes du parti et refusé de faire campagne dans ces États, sauf Hillary Clinton.
Il n’y a pas de solution facile au problème de l’exclusion des délégués de la Floride et du Michigan. Si la direction du parti revient sur sa décision et inclut les délégués élus dans le décompte, elle risque de provoquer la révolte chez les partisans d’Obama. Le parti pourrait décider de tenir de nouvelles primaires dans ces deux États, mais cela serait perçu par tous les autres (et surtout par le camp Obama) comme une occasion de leur donner un poids démesuré dans l’élection, ce qui transformerait la sanction en récompense.
À l’inverse, que se passerait-il si la sanction était maintenue et que Barack Obama gagnait malgré les cris et pleurs de délégués qui se sentiraient floués ? On n’a qu’à se rappeler le rôle crucial joué par la Floride à l’élection de 2000 — alors que quelques centaines de voix auraient pu suffire à changer le cours de l’histoire — pour comprendre le dilemme des démocrates à l’idée de s’aliéner les électeurs de cet État névralgique.
On peut discuter ad infinitum de la meilleure formule de sélection d’un leader pour un parti politique, et les démocrates américains feront un effort particulier pendant les quatre prochaines années pour étudier les alternatives. Mais les partis canadiens et québécois auraient sans doute peu de leçons à offrir à leurs voisins du sud. Le scrutin universel des membres, par exemple, a donné au Parti québécois le leadership catastrophique d’André Boisclair, alors que la lutte à finir entre Michael Ignatieff et Bob Rae pour la sélection de délégués libéraux à la loyauté indéfectible a mené à la sélection de Stéphane Dion, que personne ne voyait venir. Reste à voir si, comme chef, il parviendra à faire mentir les prédictions.
On peut aussi se demander si le ton de plus en plus négatif des échanges entre Hillary Clinton et Barack Obama n’aura pas comme conséquence de fournir des munitions aux républicains pour le dernier droit. C’est surtout la sénatrice de New York qui joue ce jeu « et le ton des attaques s’est durci au lendemain des primaires du Potomac avec un changement de la garde dans l’équipe Clinton » mais Obama ne se laisse pas faire. Quand on sait que les républicains vont s’en donner à cœur joie contre Hillary Clinton, on peut se demander pourquoi elle a choisi elle-même de partir le bal.
Pour ajouter au comique de la situation, celui-là même qui était candidat démocrate à la vice-présidence en 2000, le sénateur « démocrate-indépendant » Joe Lieberman, a donné son appui à John McCain. La mince majorité démocrate au Sénat repose donc désormais sur un « Demublican ». Ça pourrait aller mieux.
Bien sûr, les républicains ne sont pas exempts de divisions. En fait, le mouvement conservateur américain réunit quatre courants distincts. La droite religieuse, qui a trouvé son champion en Mike Huckabee, place les enjeux moraux au cœur de toute son action politique. La droite libertaire, néolibérale en matière économique mais plus ouverte sur les enjeux moraux, pouvait se reconnaître en Mitt Romney, mais son succès dépendait de l’hypothèse improbable que la droite religieuse daigne accorder son vote à un Mormon. Les néoconservateurs, qui nous ont donné Donald Rumsfeld et Dick Cheney, ont perdu du gallon. Les traditionalistes, surnommés « paléoconservateurs », fond de xénophobie toujours présent dans de larges segments de l’électorat conservateur.
La victoire pratiquement assurée de John McCain à l’investiture de son parti a provoqué des remous parmi les porte-parole stridents de chacun de ces quatre grands courants conservateurs, que McCain a offensés à un moment ou un autre de sa carrière de sénateur. Toutefois, l’attrait du pouvoir a toujours permis aux républicains de cimenter l’alliance entre leurs factions. Le mépris envers le couple Clinton est aussi un ciment puissant pour les républicains, comme le montrent les sondages qui attribuent à Barack Obama de meilleures chances de faire une percée au centre et à droite qu’à la sénatrice de New York. Il est aussi clair que, pendant que les candidats démocrates continueront de s’entre-déchirer, John McCain pourra travailler à l’unification de son parti et consolider ses liens avec les électeurs centristes, qui pourraient préférer son image de stabilité à la foire d’empoigne démocrate.
Dans un parti politique, ce sont souvent les divisions internes qui sont les plus difficiles à surmonter. Au Québec, les péquistes en savent quelque chose. À Ottawa, les libéraux fédéraux en font aussi l’expérience. Contrairement à ce qui aurait dû se produire si le « super mardi » cuvée 2008 avait livré un gagnant ou une gagnante, les démocrates continueront encore pour des semaines, voire des mois, à se faire la lutte entre eux plutôt que contre leurs adversaires.
Mon point de départ était une réflexion de Will Rogers sur son parti. On lui attribue aussi cet autre mot d’esprit encore plus mordant : « Les démocrates sont des cannibales qui se nourrissent d’autres démocrates. Les républicains sont pareils : ils se nourrissent aussi de démocrates. »