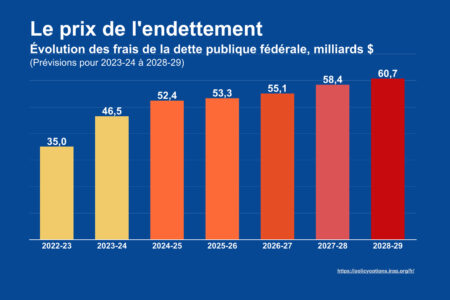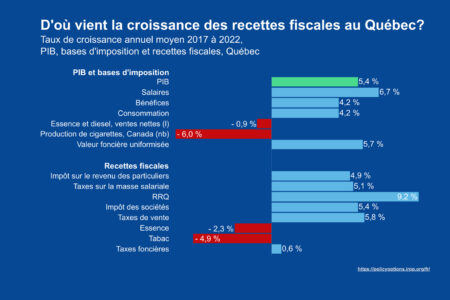
(Ce texte a été mis à jour pendant la campagne électorale pour refléter l’évolution de la projection du nombre de votes et de sièges.)
Au Québec, le lendemain d’une élection, la majorité se retrouve du côté des perdants. C’est comme ça depuis 60 ans, sauf deux fois.
On peut nous comprendre d’être un peu désabusés de la politique.
La dernière fois qu’un parti politique a remporté une majorité de sièges grâce à une majorité de voix, c’était en 1985, avec le PLQ de Robert Bourassa. Guy Lafleur avait pris sa première retraite du hockey un an plus tôt et n’avait pas encore pensé à revenir au jeu.
La « vraie » majorité précédente, c’était en 1973, encore avec Robert Bourassa, en version 1.0. Guy Lafleur entamait sa troisième saison dans la LNH. Il avait récolté 56 points, et on se demandait s’il deviendrait le joueur que tout le monde espérait.
Toutes les autres fois, un plus grand nombre de Québécois ont voté contre le gouvernement plutôt que pour lui. La majorité a perdu ses élections.
Dans 13 des 15 dernières élections générales, le parti qui a formé le gouvernement a reçu moins de 50 % des votes. Donc, minoritaire en votes.
Sur ces 13 fois, le gouvernement a quand même été majoritaire en députés 11 fois, et il a pu faire à peu près ce qu’il voulait pendant quatre ans.
Deux fois, même, le parti qui a formé le gouvernement majoritaire a reçu moins de votes que le celui qui est devenu l’opposition officielle. Tu gagnes au scrutin, mais tu te ramasses quand même dans l’opposition. Faut le faire !
Jusqu’en 1962, ça se passait plutôt bien. (Guy Lafleur avait alors onze ans.)
De 1867 à 1962, vingt-sept élections générales ont eu lieu au Québec. Pour vingt-deux d’entre elles, le parti gagnant a remporté plus de 50 % des voix exprimées. C’était une époque où les choses étaient plus simples. On était pour ou contre. Le ciel était bleu, l’enfer était rouge.
C’est ensuite que ça s’est détraqué. D’autres partis se sont ajoutés, et notre mode de scrutin uninominal à un tour, calqué sur le modèle britannique, s’est cassé pour de bon. Il n’avait tout simplement pas été pensé pour digérer plus de deux partis.
D’ailleurs, même avant 1962, sur les cinq fois où le système s’est détraqué en donnant une fausse majorité, les tiers partis avaient joué les trouble-fête trois fois (1886, 1890 et 1944).
Si la tendance se maintient, comme disait le poète, ça n’ira pas en s’améliorant.
Aux élections de 2018, il a suffi de 37 % des voix à la CAQ pour remporter 60 % des sièges au Salon bleu, une majorité confortable. Pensez-y, près des deux tiers des Québécois ont voté CONTRE leur gouvernement… majoritaire.
Avec le vote aujourd’hui divisé entre cinq partis, la CAQ pourrait remporter une centaine de sièges – 80 % du total – avec un peu plus de 40 % du vote. Une domination totale.
On peut voir nos mathématiques électorales dysfonctionnelles d’un autre angle.
Ensemble, Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti conservateur recueillent présentement un peu plus de 40 % des intentions de vote, soit un peu plus que la CAQ, qui est à 38 % d’appuis. Donc, environ le même nombre de sièges de part et d’autre ?
Pas vraiment. Si des élections avaient lieu demain matin, QS, le PQ et le PCQ récolteraient 13 sièges à eux trois (respectivement 10, 3 et 0). La CAQ, elle, en raflerait 92. C’est même une baisse dans son cas, puisque jusqu’à tout récemment, le cap des 100 sièges était à sa portée.
Je soutiens respectueusement que ça n’a pas de maudit bon sens.
Bien sûr, ça fait un moment que c’est comme ça. René Lévesque voulait réformer le système. Jean Charest et François Legault aussi, lorsqu’ils étaient dans l’opposition. Les trois ont plié devant leur caucus. Ou peut-être juste que ça faisait leur affaire.
Les péquistes de Pauline Marois, minoritaires, auraient eux aussi dû faire preuve d’un peu plus de vision. Ils ont préféré jouer sur le clivage identitaire pour tenter d’aller chercher une majorité artificielle. Ça n’a pas fonctionné. C’est le PLQ de Philippe Couillard qui a réussi le coup en criant « référendum » trente fois par jour pendant la campagne de 2014. En 2018, la CAQ a repris le manuel du PQ, mais avec plus de succès.
Chaque fois, la majorité perdante est plus fâchée. C’est purement mathématique : pour la majorité d’entre nous, la plupart du temps, le mode de scrutin ne fonctionne pas.
Bon pour la partisanerie, moins bon pour la démocratie
Les fondements de notre mode de scrutin datent du Moyen-Âge. Ça commence à faire un bail.
Il y a deux siècles, quand le pouvoir est passé du roi aux élus, les enjeux étaient généralement divisés en deux camps, et la ligne pratiquement toujours tracée entre les conservateurs et les réformistes – ou libéraux.
L’objet des élections n’était pas de former des gouvernements majoritaires, mais de refléter le point de vue majoritaire. Une majorité de votes entraînait normalement une majorité de sièges, et on a fini par confondre les deux. Sauf que la majorité des votes a fini par disparaître au fil du temps.
Ottawa a le même problème que le Québec. La dernière fois qu’un parti fédéral a remporté une « vraie » majorité, c’était avec les conservateurs de Brian Mulroney, en 1984. Ça va bientôt faire 40 ans. La fois d’avant c’était sous John Diefenbaker. En 1958…
En somme, que ça soit au Québec ou ailleurs pays, quand la majorité est divisée en plusieurs groupes et que sa composition varie au gré des enjeux, le bon vieux mode de scrutin britannique first-past-the-post déraille.
En acceptant cet état de fait, on accepte que les élections sont devenues un coup de force visant à recueillir juste assez de votes pour contrôler les leviers du pouvoir pendant quatre ans, peu importe la volonté généralement exprimée. On est content que notre équipe « gagne », peu importe si elle a vraiment gagné, et tant pis pour les autres, même s’ils sont plus nombreux.
C’est bien sûr une question d’équité et de représentation démocratique, mais ça va plus loin que ça. C’est le fonctionnement même de la législature qui est touché.
Un seul député ne peut pas être critique en santé, en finances publiques, en famille et agriculture. Et il ne peut pas siéger à deux commissions parlementaires en même temps. C’est pourtant un peu ça qui nous attend après les prochaines élections, avec des équipes de huit, six ou un député pour une « aile » parlementaire. Non seulement l’opposition va être fragmentée, mais elle va faire face à une députation gouvernementale quatre fois plus nombreuse.
Vous aimez la CAQ ? Vous avez tout à fait le droit. Vous pensez qu’elle détient le monopole des bonnes idées ? Vous avez le droit aussi. Le problème, c’est qu’il y a plus de gens qui pensent le contraire, et qui sont aussi Québécois que vous et moi. Qui décide ?
Le mode de scrutin proportionnel mixte, que plusieurs souhaitent implanter ici, vise justement à concilier tout ça. Quand les libéraux étaient encore au pouvoir, tous les partis d’opposition – PQ, QS, CAQ, et même le Parti vert – ont signé une entente pour changer la façon dont on vote avant les élections de 2022.
La CAQ, comme d’autres avant, a renié sa promesse. Ses supporteurs, aujourd’hui dans le camp des gagnants, applaudissent. Les autres l’accusent de traîtrise. C’est bon pour la partisanerie, moins pour la démocratie.
Le gouvernement actuel, qui a obtenu sa majorité avec le plus petit pourcentage de voix depuis 1867, est moins représentatif que tous ceux qui l’ont précédé. Le prochain le sera encore moins.
Des mythes sur le scrutin proportionnel
Il y aurait beaucoup à dire sur des mythes qui concernent la proportionnelle : elle serait foncièrement instable (c’est faux, allez demander à Angela Merkel) ; elle produirait des gouvernements moins durables (c’est faux aussi, voir notamment ceci) ; et elle encouragerait nécessairement une multiplication des petits partis, ce qui rendrait un État ingouvernable (un danger facilement évitable en imposant un seuil minimal de représentation, comme le font la plupart des pays où la proportionnelle est implantée).
Un autre argument un peu étrange veut qu’un mode proportionnel donnerait trop de pouvoir à la majorité. Rien n’est parfait, et la démocratie est un peu la dictature de la majorité. Mais une dictature de la minorité reste encore plus difficile à défendre.
Quant à la « stabilité » et à la « force » des modes de scrutin non proportionnels, on peut répondre en trois mots : France, Royaume-Uni, États-Unis. Dans ces pays, les gouvernements sont peut-être « stables », mais le couvercle est pas mal sur le bord de sauter…
Les gouvernements de coalition sont par définition plus difficiles à former. En revanche, en forçant différentes factions à s’entendre, ils mènent à des compromis et à des solutions généralement plus durables. Ils sont aussi plus justes et plus représentatifs des courants politiques qui traversent la population, ce qui est quand même le nœud de l’affaire.
Comme leurs prédécesseurs, ceux qui profitent du système actuel vont trouver toutes sortes de raisons pour le maintenir en place, même s’il va éventuellement se retourner contre eux
Maintenir le statu quo serait aussi myope que cupide, et ne changerait pas les données de base : notre mode de scrutin est brisé, il est inéquitable, il est même antidémocratique jusqu’à un certain point, et ça n’ira pas en s’améliorant.