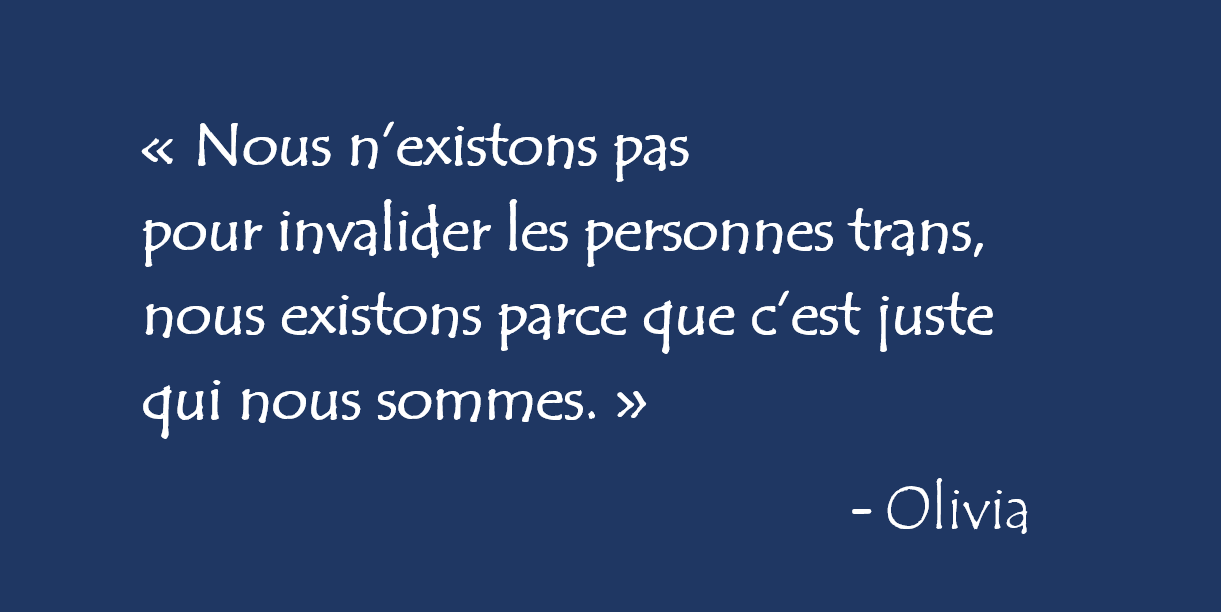« Nous n’existons pas pour invalider les personnes trans,
nous existons parce que c’est juste qui nous sommes.
C’est aussi une part importante de la communauté LGBT,
parce qu’il y a des gens qui ne comprennent pas que c’est OK de revenir en arrière
si le genre dans lequel tu as transitionné
ne te correspond pas ou te fait sentir pire.
C’est tout à fait normal et que c’est juste une partie du cheminement
pour s’identifier soi-même. »
– Olivia
À l’instar des 19 autres jeunes que nous avons interrogés dans le cadre de notre étude sur les discours trans et détrans, Olivia (pseudonyme) nous montre que les parcours de détransition ne sont pas un argument contre les transitions.
Or, de plus en plus d’articles et de lettres d’opinion sur le sujet présentent la transidentité comme anormale, l’accès aux soins d’affirmation du genre comme l’hormonothérapie comme une option trop facile d’accès, et la détransition comme une erreur de parcours qui devrait à tout prix être évitée. Ces arguments sont pourtant erronés, et nuisent à l’accès aux soins pour les jeunes trans et non binaires, comme l’ont récemment démontré deux jugements de la Haute Cour au Royaume-Uni.
De nombreuses sociétés dans le monde reconnaissent depuis toujours la diversité des genres. Depuis au moins une décennie, plusieurs associations professionnelles, dont l’Association mondiale des professionnels pour la santé transgenre, sont d’avis que la diversité des genres « est un phénomène humain commun et culturellement diversifié qui ne doit pas être considéré comme intrinsèquement pathologique ou négatif ». Les lois canadiennes et québécoises ont aussi reconnu la diversité des genres comme une différence et une identité parmi d’autres, grâce aux personnes trans et non binaires qui ont su faire entendre leurs voix.
La fausse banalisation de la transition
Dans les articles traitant de la détransition, la transition de genre médicale est trop souvent présentée comme une option banalisée et trop facile d’accès. Pourtant, plus de la moitié des jeunes trans et non binaires ne suivent aucun traitement médical d’affirmation du genre, que ce soit par choix ou par contrainte. Selon une recherche effectuée dans 10 cliniques médicales pédiatriques d’affirmation du genre au Canada, les jeunes trans et non binaires ont en moyenne vu 3 professionnels avant de pouvoir prendre un premier rendez-vous en clinique et attendu 269 jours entre la demande et la première rencontre.
Nos entrevues auprès de jeunes qui ont détransitionné après une transition médicale révèlent que certains ont dû aussi attendre des mois, voire des années avant d’accéder à des traitements médicaux d’affirmation de genre, ce qui ne les a pas empêchés de discontinuer leur parcours par la suite. Les rares jeunes qui avaient eu accès à des traitements hormonaux dès le premier rendez-vous étaient majeurs et se définissaient comme trans depuis plusieurs années. Nos participants ne préconisent d’ailleurs pas de diminuer ou d’empêcher l’accès aux traitements d’affirmation de genre, mais plutôt d’offrir un meilleur accompagnement pour explorer les raisons de leur décision. Ainsi, l’accès à ces traitements demeure essentiel et est loin d’être trop facile, ou utilisé par tous.
De plus, notre analyse de près de 200 articles de journaux publiés à travers le monde, en anglais et en français, entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2020 montre qu’on dépeint largement le corps médical comme responsable des mauvais diagnostics qui conduiraient à tort à la transition, et qu’on priorise la voix des personnes qui veulent limiter l’accès aux soins d’affirmation du genre en mettant l’accent sur « l’erreur » que représente une transition.
Ces récits sont pourtant peu représentatifs. Les entrevues menées auprès des jeunes qui ont discontinué leur transition révèlent qu’ils forment un groupe hétérogène, et que leur perspective et leurs sentiments face à leur parcours évoluent dans le temps. Les transitions discontinuées ne sont pas nécessairement vécues comme des échecs, et semblent plutôt faire partie d’un processus de redéfinition du genre et de sa signification pour ces personnes. Certains de ces « détransitionneurs » prennent conscience que leur dysphorie de genre demeure présente et que le fait d’arrêter leur transition vient aussi avec des défis et des questionnements identitaires. D’autres ont déconstruit les attentes de genre et se sont tournés vers d’autres identités (non-binaire, femme non conforme dans le genre, butch, sans-genre, etc.).
Le rejet, puis le recul
Des études révèlent que la décision de cesser la démarche de transition est souvent liée à des expériences de rejet de la part de la famille ou de collègues, à l’emploi ou à l’école, c’est-à-dire des expériences directes de transphobie sociale. Parfois, les jeunes ont été amenés à réévaluer leur genre, leurs motivations et leurs besoins durant leur parcours. Il importe donc de mettre en place un système de soutien non contraignant et un accompagnement thérapeutique, sans le lier à une évaluation formelle, afin de mieux soutenir les jeunes dans leur exploration du genre.
Il serait donc dangereux de limiter encore plus l’accès aux soins d’affirmation de genre, comme certains le proposent. Cela nierait les preuves scientifiques sur l’efficacité des transitions médicales, qui améliorent indéniablement la santé globale chez la très grande majorité des personnes concernées par leur identité de genre.
C’est pourtant la voie qu’a pris l’État du Texas, qui vient de criminaliser l’accès aux traitements hormonaux pour les jeunes transgenres, en tenant les parents et les professionnels qui les soutiennent responsables et en les rendant passibles de peines de prison. En plus d’aller à l’encontre du consensus scientifique, la fermeture de l’accès aux moyens d’affirmation de genre provoque une détresse incommensurable pour ces jeunes. Il est désolant de constater à quel point le discours sur la détransition, souvent si peu nuancé, contribuent à dévaloriser la diversité de genre tout en instrumentalisant les parcours détrans.
Autres contributeurs
Alexandre Baril, Ph. D., professeur agrégé, Université d’Ottawa
Tommly Planchat, M. A., professionnel de recherche, Université de Montréal
Mélanie Millette, Ph. D., professeure, Département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal
Denise Medico, Ph. D., psychologue et sexologue, professeure, Université du Québec à Montréal
Olivier Turbide, Ph. D., professeur, Département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal
Rosalie Gravel, assistante de recherche, Université de Montréal