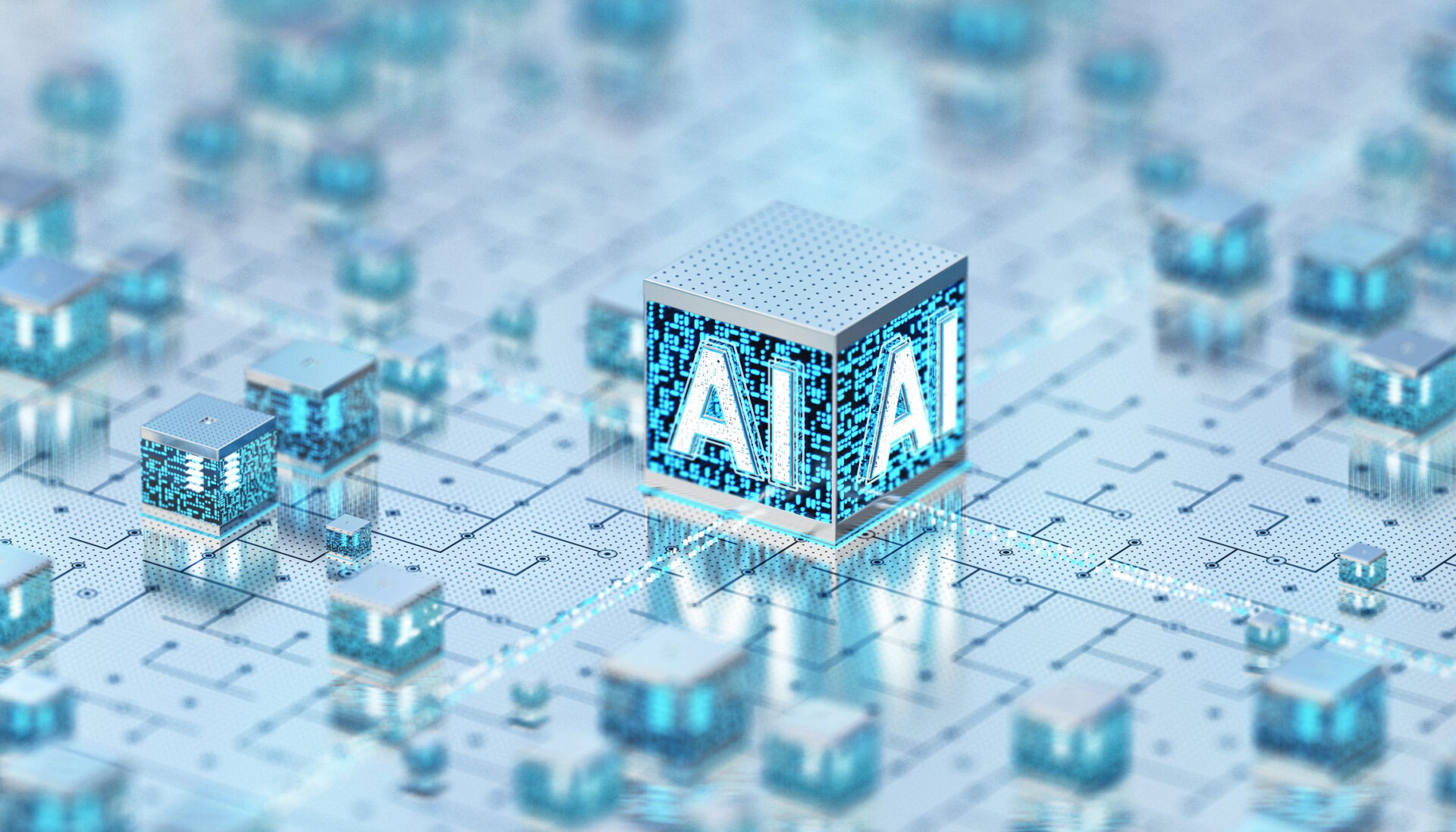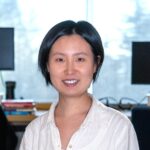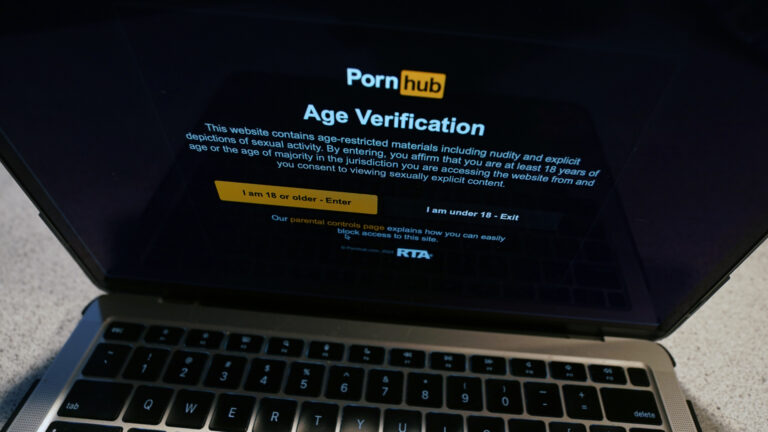(English version available here)
L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée dans nos lieux de travail, nos institutions et notre vie quotidienne.
C’est dans ce contexte que le gouvernement fédéral encourage l’adoption de systèmes d’IA. Ottawa a nommé son tout premier ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, Evan Solomon. La lettre de mandat du premier ministre Mark Carney à tous ses ministres parle de déployer l’IA « à grande échelle », tandis que le budget de l’année dernière engageait 2 milliards de dollars d’investissements pour les entreprises nationales spécialisées dans l’IA.
Pourtant, malgré toutes ces mesures, le Canada pourrait en réalité être à la traîne. De nombreux pays se précipitent pour développer des industries de l’IA, apparemment à n’importe quel prix. Les États-Unis ont même présenté le développement de grands modèles d’IA générale comme une « course » qu’ils sont déterminés à gagner.
Cela soulève la question suivante : les Canadiens ont-ils une chance de remporter cette « course » à l’IA ? Voulons-nous même y participer ?
À notre avis, Canada ne peut pas gagner la bataille contre les entreprises américaines qui disposent de sommes d’investissement bien plus importantes. Le gouvernement fédéral devrait plutôt orienter notre industrie nationale de l’IA vers un créneau écologique et éthique. Créer un avenir différent pour l’IA canadienne est l’occasion d’offrir au monde quelque chose qui se distingue utilement de l’approche américaine.
L’avantage américain
Les récents décrets signés par le président Donald Trump promettent d’accélérer la mise en service de centrales électriques et de centres de données au service de l’IA, malgré leur impact négatif sur l’environnement, et de restreindre l’exportation des composants d’IA dégroupés dont ont besoin les entreprises qui cherchent à développer leurs propres produits, tout cela afin de donner un avantage aux entreprises américaines.
Les entreprises américaines d’IA, qui comptent déjà parmi les plus grandes au monde, dépensent tellement en centres de données en 2025 que cet investissement contribue désormais davantage à la croissance économique américaine que les dépenses de consommation. Parallèlement, aucune réglementation anti-discrimination n’est rédigée, de peur que cela ne ralentisse la dynamique du secteur.
De manière réaliste, une approche canadienne doit être différente.
Les entreprises canadiennes spécialisées dans l’IA ne sont pas aussi bien établies ni aussi riches que leurs concurrentes américaines.
De plus, nos systèmes de traités et de confédération ne nous permettent pas de développer simplement des projets sur les terres autochtones et provinciales sans évaluations d’impact appropriées et consultations significatives (bien que la loi C-5, Unité de l’économie canadienne, permette au gouvernement d’accélérer les projets jugés d’intérêt national, ce qui pourrait inclure les centres de données).
Les réglementations et les consultations sont en fin de compte une bonne chose. Elles permettent aux Canadiens de s’interroger sur nos objectifs en matière d’IA et de déterminer s’ils sont conformes à l’intérêt public plutôt qu’à l’intérêt privé.
En tant que groupe d’universitaires spécialisés dans l’étude des dimensions sociales et environnementales de l’IA, nous soutenons que le gouvernement Carney a l’occasion de donner une nouvelle orientation à l’IA canadienne, en mettant en place un système dans lequel les Canadiens peuvent proposer des systèmes et des infrastructures d’IA plus durables et plus responsables pour les soutenir.
Grâce à une réglementation claire et à une politique créative et innovante, le Canada pourrait se distinguer sur la scène mondiale et éviter une compétition impossible à gagner.
La course impossible à gagner
Le modèle actuel, qui privilégie la taille, part du principe que la course à l’IA sera remportée par les entreprises qui créent les outils polyvalents les plus puissants. L’espoir est qu’avec suffisamment de données (souvent volées!), ces systèmes finiront par se développer au point de pouvoir être vendus pour être utilisés dans un large éventail de contextes, générant ainsi des profits monopolistiques.
Cependant, il s’agit d’un pari coûteux pour les entreprises et dangereux pour le climat mondial. Aujourd’hui, pour obtenir même une légère augmentation des performances des systèmes d’IA, les entreprises doivent investir dans des capacités de calcul exponentiellement plus importantes. Cette approche récompense clairement les acteurs qui disposent déjà de beaucoup d’argent ou qui ont le plus accès aux données (des consommateurs).
Elle privilégie également ceux qui peuvent obtenir des contrats énergétiques pour alimenter de nouveaux centres de données. Et il y a aussi une limite à l expansion physique des centres de données. Ces coûts énergétiques ont des impacts non négligeables sur le climat et la santé, d’autant plus que la ruée vers la mise en service de nouveaux centres de données prolonge l’utilisation du charbon et du gaz.
Pour une intelligence artificielle juste et équitable
Pour une politique de l’IA axée sur les ressources naturelles, les travailleurs et le capita
Le temps pour une loi sur l’intelligence artificielle est arrivé
Comment légiferer sur l’intelligence artificielle au Canada?
C’est pourquoi tant d’entreprises technologiques ont renoncé à leurs objectifs climatiques. C’est aussi pourquoi il existe un lien de plus en plus étroit entre l’expansion des centres de données et la hausse des factures d’électricité des consommateurs.
Cette course à l’IA est en fin de compte un pari risqué. Les modèles d’IA à usage général actuels n’ont jamais réussi à tenir leur promesse d’automatiser les services qualifiés ou d’éliminer les préjugés persistants.
De plus, les efforts visant à utiliser l’IA pour améliorer l’efficacité des services publics ont souvent échoué. Le désastre DOGE d’Elon Musk en est un exemple frappant. Le Canada a également connu des projets annulés et des tentatives infructueuses visant à rendre le gouvernement plus efficace grâce à l’automatisation. Le rapport récent du MIT ajoute aussi de l’huile sur le feu en indiquant que 95 % des entreprises d’IA générative n’obtiennent aucun retour sur leurs investissements.
Si certains espèrent que le temps et l’argent finiront par résoudre ces problèmes, l’engouement actuel pour l’IA pourrait s’avérer être une bulle, voire une nouvelle crise des subprimes, avec des conséquences potentiellement dévastatrices.
Être petit pour aller de l’avant
Une autre approche consiste à créer de petits modèles d’IA, construits à partir de données de haute qualité pour effectuer des tâches spécifiques dans des contextes spécifiques. Ces systèmes sont plus efficaces pour traiter les données sensibles et les biais potentiels. Ils consomment également moins d’énergie. Cela signifie qu’il existe davantage de possibilités d’alimenter ces systèmes avec de l’électricité à faible teneur en carbone, évitant ainsi de compromettre les objectifs climatiques nationaux ou d’augmenter les prix à la consommation sur le marché intérieur.
À cette échelle, le développement de l’IA dépend moins des fabricants de puces ou des fournisseurs de services infonuagiques américains de pointe, ce qui répond mieux aux préoccupations du Canada en matière de souveraineté. Cela pourrait permettre à l’industrie nationale de l’IA d’« acheter Canadien » sur une plus grande partie de sa chaîne d’approvisionnement et d’éviter de faire fonctionner ses systèmes dans des centres de données américains.
Étant donné que les lois américaines autorisent désormais le gouvernement américain à accéder aux données stockées sur des systèmes appartenant à des entreprises américaines, même si ceux-ci sont situés au Canada, il s’agit d’un problème urgent. Une IA petite et adaptée à l’usage prévu permettrait également de garder les investissements canadiens au Canada.
À l’échelle mondiale, il pourrait y avoir un marché en pleine croissance pour les petits systèmes contextuels, en particulier ceux qui ne sont pas liés à l’État et à l’armée américains. En s’appuyant sur l’histoire du Canada en matière de maintien de la paix, d’intervention d’urgence et d’environnementalisme, il est possible de trouver un créneau écologique et éthique sur les marchés internationaux.
Comment soutenir les petites IA souveraines ?
Afin de mieux façonner les perspectives de l’IA made in Canada, le gouvernement fédéral devrait explorer toute une série de réglementations et de mesures politiques. Certaines d’entre elles incluraient des règles qui relèvent du sens commun, qui sont sans ambiguïté et claires, afin d’éviter les mauvais résultats.
Par exemple, l’IA ne devrait jamais être utilisée pour faciliter la discrimination sur le marché du logement ou de l’emploi ni pour exploiter les travailleurs et les consommateurs grâce à des algorithmes de tarification prédictive. Les modèles entraînés à partir de données volées ne devraient pas pouvoir générer de profits.
Si le Canada a fait preuve d’un leadership international en matière de réglementation de l’automatisation au sein du gouvernement, nous manquons actuellement de politiques pour l’IA dans le secteur privé. La mise en place de réglementations sur l’IA ne ralentira pas l’industrie. Au contraire, elles fixent des limites et des objectifs qui orientent les entreprises vers une voie leur permettant de réussir et de promouvoir des avantages sociaux à long terme.
De plus, alors que le gouvernement Carney explore de nouveaux mégaprojets d’infrastructure fédérale, il est possible de créer des parcs de centres de données, alimentés en énergie propre et gérés en collaboration avec les communautés locales et autochtones.
À long terme, une planification participative peut garantir que les prix de l’électricité et les émissions de carbone n’augmentent pas, tandis que les avantages restent dans les communautés qui hébergent les centres de données qui composent le nuagique. Cela pourrait également impliquer la création d’une société d’État chargée de fournir des ressources informatiques abordables, publiques et souveraines aux entreprises nationales et aux acteurs publics.
Lorsque les puissances mondiales s’affrontent dans des directions opposées, le Canada a toujours trouvé une troisième voie. Alors que l’IA semble de plus en plus être le prochain enjeu, nous avons beaucoup à gagner à suivre notre propre voie et à respecter les engagements du Canada en matière de droits de la personne, d’environnement, de gouvernance délibérative et de réconciliation avec les peuples autochtones.
Sarah-Louise Ruder et Olivia Doggett sont coauteures de cet article. Nous remercions également les auteurs du livre blanc intitulé « Défis et opportunités d’une approche canadienne en matière d’IA », dont les arguments sont repris dans cet article.