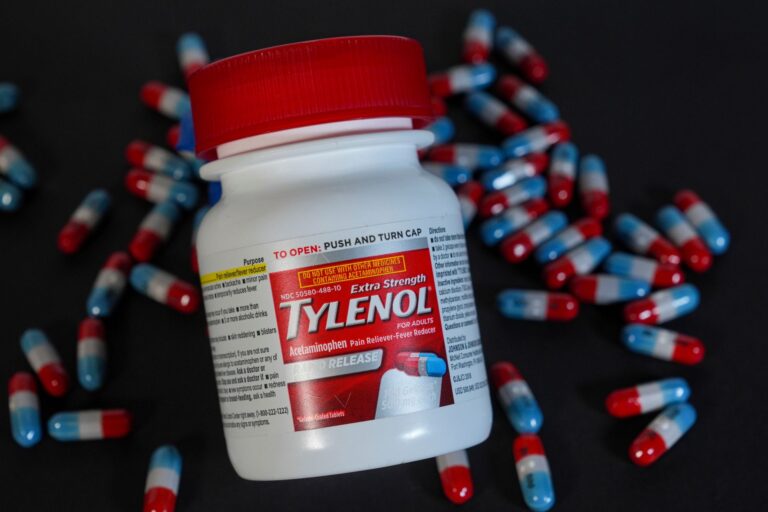Quel que soit le contexte culturel, le passage à l’âge adulte est une période cruciale, marquée par de nombreux défis : développement de l’identité, nouvelles relations, attentes accrues en matière d’autonomie et de responsabilité.
Ces défis coïncident avec l’évolution rapide des technologies, une plus grande vulnérabilité aux difficultés psychologiques et des attentes souvent dissonantes entre générations, entraînant un décalage entre enseignants et apprenants.
Les générations Z et Alpha (nées entre 1995 et 2010, et depuis 2010, respectivement) dominent la population mondiale, représentant ensemble environ 46 % de celle-ci. La génération Z présente des caractéristiques distinctives, alliant forces singulières et vulnérabilités spécifiques, ce qui la différencie nettement des générations antérieures. Ses valeurs, attitudes et comportements contrastent souvent avec les attentes des enseignants et recruteurs des générations précédentes.
Une génération confiante, mieux scolarisée et exigeante
Les milieux d’enseignement et de travail sont appelés à adapter leurs pratiques et mettre en place des stratégies plus innovantes pour favoriser l’épanouissement académique et professionnel des jeunes recrues, tout en exploitant pleinement leur potentiel.
La théorie interdisciplinaire d’autodétermination offre un contexte logique pour comprendre leurs besoins d’autonomie (sentiment de contrôle sur ses choix et actions), de compétence (sentiment d’efficacité et de maîtrise) et d’affiliation (sentiment d’appartenance et de connexion sociale). Ces besoins sont les fondements de la motivation intrinsèque et du bien-être psychologique.
Par rapport aux générations précédentes, les jeunes adultes d’aujourd’hui sont plus confiants, mieux scolarisés et plus compétents sur le plan technologique que toutes les générations qui les ont précédées. Ils valorisent leur temps libre, recherchent l’équilibre entre le travail et le loisir et attachent une grande importance à l’autonomie individuelle.
En matière de communication et d’apprentissage, les jeunes adultes privilégient une communication flexible et recherchent des expériences porteuses de sens, qui renforcent leur engagement envers les objectifs éducatifs. Leur conception du leadership est collaborative, guidée et fondée sur la reconnaissance. En cohérence avec ces valeurs, ils souhaitent que les milieux scolaires et professionnels incarnent eux aussi ces valeurs dans leur pratique de gestion.
Entre quête de bien-être et vulnérabilité
Les jeunes adultes ont des atouts, mais ils font aussi partie de la tranche de population la plus vulnérable. De 1990 à 2016, les problèmes de santé mentale chez les jeunes ont triplé à l’échelle mondiale. Cela se traduit par une augmentation préoccupante de la prévalence des troubles psychiatriques chez les étudiants universitaires. Parallèlement, le recours à la pharmacothérapie chez les adolescents les jeunes adultes a également augmenté.
Des recherches menées dans 18 pays à revenu élevé et pays à revenu faible ou intermédiaire révèlent qu’environ deux tiers des étudiants présentaient, au cours de leur vie, des antécédents d’au moins un trouble de santé mentale. L’usage de substances et les troubles dépressifs majeurs sont les pathologies les plus fréquentes.
Les femmes rapportent une prévalence plus élevée de dépression et d’anxiété (des troubles internalisés) tandis que les hommes rapportent une prévalence de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de toxicomanie (troubles externalisés). Parmi eux, 20 % ont recours à des traitements pharmacologiques avec ou sans psychothérapie. Plus de 83 % des troubles de santé mentale sont diagnostiqués avant l’entrée à l’université et jusqu’à un quart des étudiants universitaires déclarent avoir eu des pensées suicidaires durant leurs études postsecondaires.
Intolérance croissante à l’effort et aux émotions négatives
Bien que chaque génération soit confrontée à des défis spécifiques, l’augmentation préoccupante des diagnostics et du recours à la pharmacothérapie chez les plus jeunes générations exige une réflexion approfondie. Parmi les hypothèses explicatives récentes, les travaux récents mettent en lumière une hausse de l’intolérance aux émotions négatives chez les jeunes adultes, ce qui pourrait contribuer à une détérioration du fonctionnement chez les étudiants.
Certaines études suggèrent que cette intolérance résulte d’un décalage entre l’effort perçu et la récompense attendue. Les exigences académiques peuvent être perçues par les étudiants comme excessivement contraignantes au regard de la note espérée. La valeur accordée à la récompense, ou au renforcement positif, apparaît ainsi comme un élément central pour cette génération.
La hausse des diagnostics rapportés peut être interprétée comme le reflet d’un échec structurel à répondre aux trois besoins fondamentaux de la motivation autodéterminée. Si les environnements d’apprentissage et professionnels ne nourrissent ni l’autonomie, ni le sentiment de compétence, ni l’affiliation sociale, les jeunes développent une motivation interne fragile, voire absente. Ce phénomène engendre une gêne fonctionnelle et une souffrance accrue.
L’essor de l’individualisme et ses conséquences éducatives
Comment expliquer l’émergence de cette fragilité ? Une hypothèse repose sur l’essor de l’individualisme au détriment de la collectivité. Les recherches en sciences sociales révèlent que les fonctions cérébrales se sont développées pour assurer la survie de l’espèce, donnant ainsi priorité au cerveau social. Or, la montée de l’individualisme a transformé les modes d’interaction sociale, les perceptions et les réponses émotionnelles.
Cette prédominance des préoccupations individuelles a transformé l’éducation parentale. Sous l’influence de parents privilégiant l’épanouissement personnel plutôt que l’engagement collectif, les pratiques éducatives deviennent plus indulgentes. Les activités collectives sont remplacées par des sports compétitifs, axés sur la performance individuelle. L’hyperimplication des parents peut aussi devenir problématique. Les jeunes avec des parents surprotecteurs sont plus anxieux, moins confiants et ont plus de difficultés à réussir et à gérer leurs émotions.
Plusieurs chercheurs s’inquiètent que cette approche freine le développement de l’autonomie, accroisse les risques de difficultés psychologiques et sociales, et affaiblisse la persévérance. En effet, la valorisation excessive du confort et l’évitement de l’échec empêchent les jeunes de développer une relation saine à l’effort et de surmonter les crises développementales essentielles liées à l’autonomie et à la motivation intrinsèque. L’ingérence parentale excessive et la surprotection entravent leur capacité à affronter et dépasser les défis nécessaires à la maturation.
Cette dynamique augmente les risques de déficits psychosociaux et de difficultés psychologiques. Les conséquences de ce style d’éducation se manifestent aujourd’hui chez de nombreux jeunes qui peinent à gérer leur détresse émotionnelle et faire face aux défis et exigences professionnels.
L’impact des technologies sur les fonctions cognitives et sociales
À cette parentalité surprotectrice s’ajoute l’omniprésence des technologies numériques. Depuis l’enfance, les jeunes générations ont bénéficié d’un accès immédiat à des outils numériques facilitant l’accès à l’information et la communication. Cette facilité d’accès et de traitement tend à encourager une logique de multitâche, incitant les individus à vouloir accomplir davantage en simultané. La surstimulation et les distractions répétitives peuvent affecter les fonctions exécutives, essentielles à la régulation des pensées, des émotions et des comportements.
Besoin urgent de services en santé mentale
Les sciences humaines et les compétences fondamentales pour l’emploi
Des études mettent en évidence un phénomène de déclin cognitif attribuable au recours excessif à des dispositifs technologiques, notamment l’IA générative, pour accomplir des tâches mentales autrefois réalisées de manière autonome. Ce « délestage cognitif », initialement centré sur des tâches individuelles, s’est progressivement étendu aux interactions sociales. Les individus délèguent des fonctions relationnelles (mémoire sociale, régulation émotionnelle, initiation des échanges) à des interfaces numériques.
L’usage excessif de ces outils peut ainsi devenir une stratégie d’évitement social. Il réduit la tolérance à l’effort physique, intellectuel et social, au détriment des interactions réelles, plus exigeantes mais plus enrichissantes. Certaines études suggèrent même un lien entre l’utilisation des médias sociaux et le risque de suicide chez les jeunes.
Ainsi, lorsque leur utilisation dépasse leur utilité réelle, les outils technologiques peuvent se muer en artefacts ludiques, qui détournent le temps plutôt que de l’optimiser. Ils deviennent alors des vecteurs de distraction ou de dépendance, susceptibles de compromettre le processus d’adaptation psychosociale.
La solitude, un mal silencieux
L’utilisation excessive des technologies, qu’il s’agisse d’outils ou de médias sociaux, au-delà des recommandations établies, est un prédicteur d’isolement social et de symptômes dépressifs. Une corrélation bidirectionnelle significative a été observée entre l’utilisation du téléphone intelligent et la dépendance chez les étudiants universitaires. Ce phénomène est en partie attribuable à l’isolement social, et il contribue à une prévalence élevée (mais souvent négligée) de la solitude chez les jeunes adultes en transition.
La solitude définie comme un écart entre les relations sociales désirées et celles vécues est en hausse chez les jeunes adultes. Elle se distingue du simple manque de contacts sociaux : même entourés, certains se sentent déconnectés, en raison d’un déficit perçu en relations intimes ou d’intégration sociale.
Deux périodes de la vie sont marquées par des pics de solitude : l’entrée dans l’âge adulte et la vieillesse. Une étude allemande à grande échelle a révélé qu’un tiers des étudiants en première année d’université se sentent modérément seuls et que la solitude émotionnelle était plus fréquente que la solitude sociale. Une recherche regroupant les résultats de nombreuses études dans le monde a révélé une vulnérabilité généralisée à la solitude chez les étudiants à l’enseignement supérieur.
Les jeunes rapportant les difficultés affectives ou relationnelles sont les plus exposés à une solitude dite « sévère », fortement associée aux idées et comportements suicidaires, indépendamment d’un diagnostic psychiatrique. Il devient donc essentiel de favoriser les relations interpersonnelles hors ligne, non seulement pour réduire la détresse émotionnelle et la dépendance technologique, mais pour soutenir l’apprentissage et des conduites professionnelles efficaces
Vers une intégration harmonieuse
La convergence entre l’individualisme sociétal et une parentalité axée sur la récompense et la facilitation expose la jeune génération à une motivation extrinsèque exacerbée au détriment d’une motivation intrinsèque. Cette dynamique est susceptible de renforcer l’intolérance à l’effort et aux émotions négatives, telle que la peur de l’échec ou de l’ambiguïté. Il apparaît donc essentiel de rééquilibrer cette dynamique afin de mieux soutenir l’avenir des individus et de la collectivité.
Or, de nombreuses institutions fonctionnent encore selon des systèmes de valeurs perçus comme obsolètes par une génération en quête d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce fossé générationnel renforce la vulnérabilité émotionnelle des jeunes et les discordances liées à l’effort, la gratification et l’intégration sociale.
Les jeunes recrues se heurtent à des cadres institutionnels hérités du passé qui compromettent leur autonomie, leurs compétences et leurs interactions sociales. Ce constat appelle des innovations intégrant facteurs sociaux protecteurs et processus cognitifs partagés.
En définitive, il est crucial de reconstituer la main-d’œuvre avec des travailleurs psychologiquement et socialement confiants et compétents. Cela exige un accompagnement adapté des jeunes générations, pour assurer une adaptation harmonieuse aux exigences du monde professionnel.