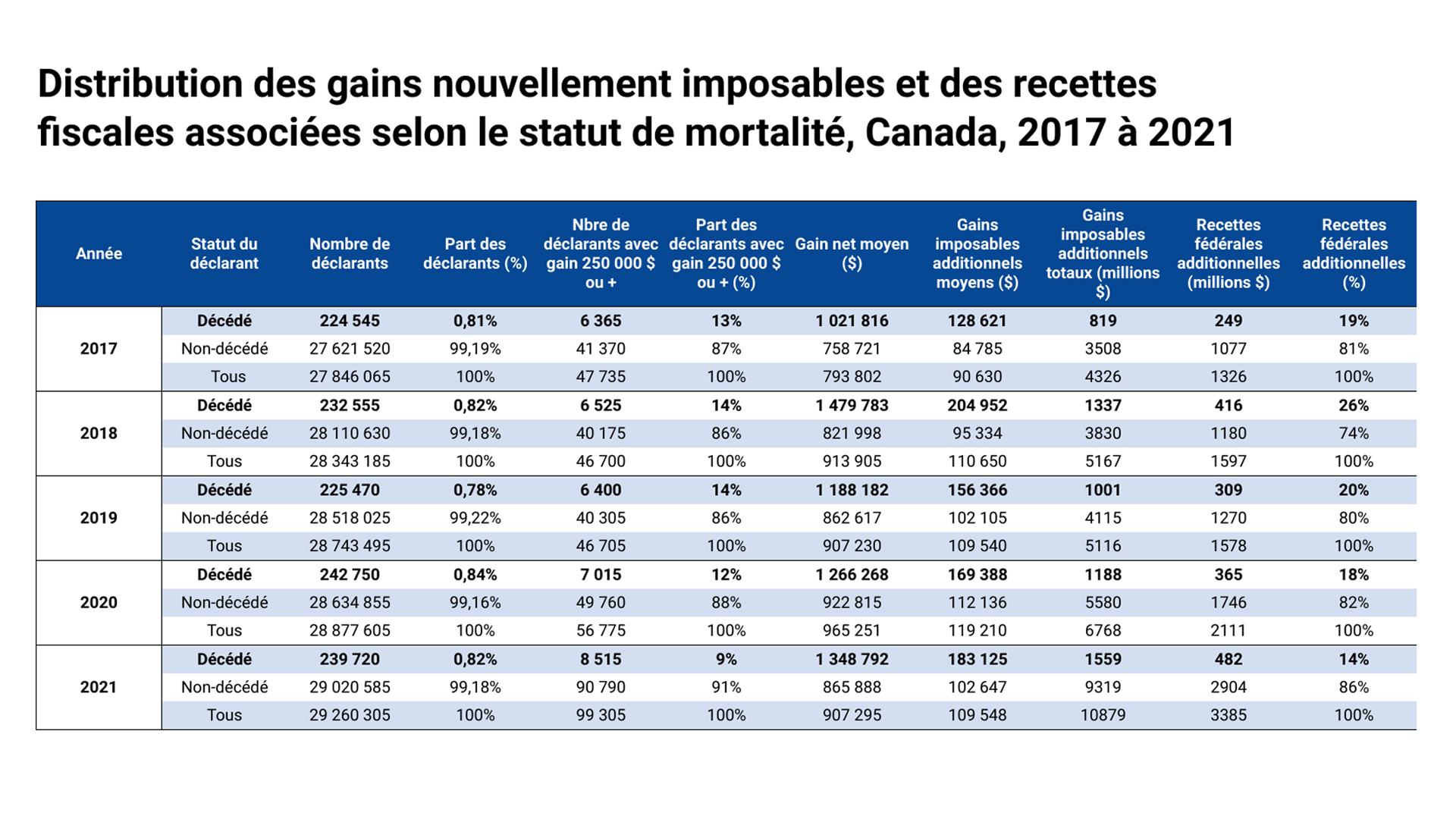
En Grèce, Syriza, le parti de la gauche radicale, est maintenant au pouvoir, avec le mandat de renégocier la lourde dette du pays et de remettre en question les politiques de réformes structurelles dictées par les institutions prêteuses. Les discussions sont entamées, mais elles ne seront pas faciles, les partenaires estimant avoir déjà beaucoup fait pour soutenir un petit pays mal gouverné qui représente à peine plus de 2 p. 100 du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro.
Et ce d’autant plus que toute concession à la Grèce risque de faire école. En Espagne, le tout nouveau parti Podemos, qui a été fondé il y a un an et présente un programme assez semblable à celui de Syriza, devance maintenant le vénérable Parti socialiste ouvrier dans les sondages et se retrouve pratiquement à égalité avec le Parti populaire de l’actuel premier ministre Mariano Rajoy. Or à elle seule, l’Espagne pèse cinq fois plus que la Grèce, sa part du PIB de la zone euro se situant légèrement au-dessus de 12 p. 100. Et après l’Espagne, il pourrait y avoir l’Italie.
Des concessions trop importantes risquent donc d’être lourdes de conséquences, et elles seraient très mal reçues par les électeurs des pays du nord de l’Europe, les Allemands notamment, qui estiment avoir fait suffisamment pour soutenir les pays en difficulté. En même temps, le poids de la dette étouffe les possibilités de reprise en Europe, et il condamne plusieurs pays à un régime d’austérité dont ils ne voient pas la fin.
Vraisemblablement, un autre accommodement provisoire sera bricolé pour tenter encore une fois de faire tenir une union monétaire sous-optimale dont on ne sait plus comment se défaire.
Mais comment en est-on arrivé là ? On peut, bien sûr, en faire une question morale, et souligner la corruption, la duplicité et l’évasion fiscale qui ont marqué la politique grecque depuis l’entrée du pays dans l’Union européenne. Mais ce ne serait voir qu’une partie du problème. En 2008, par exemple, avant la crise financière, l’Espagne réalisait un surplus budgétaire et avait une dette publique moins lourde, en pourcentage du PIB, que l’Allemagne. Ce sont la crise économique et les politiques d’austérité subséquentes qui ont fait exploser la dette espagnole, qui atteint maintenant presque 100 p. 100 du PIB.
On pourrait aussi, à juste titre, blâmer l’euro, qui a alimenté les déséquilibres en dotant une économie fortement exportatrice comme celle de l’Allemagne d’une monnaie relativement sous-évaluée, pendant que des économies plus fragiles, la Grèce et l’Espagne par exemple, se retrouvaient avec une monnaie trop forte, sans bénéficier, comme les régions d’une fédération, de mécanismes de péréquation qui en auraient compensé partiellement les effets négatifs.
Jamais nos gouvernements ne sont apparus aussi désemparés.
Mais il y a plus. À l’échelle mondiale, le poids de la dette, publique et privée, a atteint des niveaux sans précédent. Entre 2007 et 2014, selon un rapport du McKinsey Global Institute paru en février, la dette mondiale s’est accrue de 57 000 milliards de dollars, pour atteindre 286 p. 100 du PIB mondial. Dans pratiquement tous les pays, la part de la dette dans le PIB a crû pendant cette période. La dette publique, notamment, a atteint un tel niveau que, dans bien des cas, la croissance ou les politiques d’austérité ne suffiront pas à en venir à bout. Les Grecs sont rendus à cette étape.
Dans un livre qui a suscité beaucoup de discussions en Allemagne et qui vient de paraître en français (Du temps acheté : la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique), Wolfgang Streeck, sociologue à l’Institut Max-Planck pour l’étude des sociétés, voit dans l’impasse actuelle liée à la dette un symptôme d’une crise plus large qui concerne le fonctionnement même de nos sociétés démocratiques.
La crise actuelle, explique Streeck, est triple : une crise bancaire, liée à un excès de prêts douteux qui mettent tout le système bancaire en péril ; une crise fiscale, causée par la croissance presque ininterrompue des dettes publiques au cours des dernières décennies ; et une crise de l’économie réelle, marquée par une croissance faible et, en Europe du moins, des taux de chômage élevés. Nous n’avons jamais vu nos gouvernements aussi « désemparés », dépourvus de réponses autres que temporaires pour faire face à ces crises, observe-t-il. Nous vivons sur « du temps acheté ».
Pour Streeck, le problème prend sa source dans la tension constitutive entre la démocratie et le capitalisme. Après la Seconde Guerre mondiale, cette tension s’était résolue par la constitution d’un nouvel équilibre qui accordait la priorité au plein emploi, faisait place à la négociation collective et permettait l’avènement de la protection sociale, dans un contexte de libéralisation des échanges internationaux. Le grand compromis social de l’après-guerre conciliait ainsi la quête du profit et de la croissance avec les aspirations démocratiques à une plus grande justice sociale.
C’est ce compromis qui a été remis en question dans les années 1980 : au nom du marché et de la compétitivité, on a affaibli les syndicats, resserré la protection sociale et déréglementé les institutions financières. Mais dans le bras de fer qui a suivi, il est apparu plus facile de diminuer les revenus de l’État ― pour « affamer la bête » ― que de couper dans les dépenses, l’endettement permettant en quelque sorte de satisfaire tout le monde. À peu près en même temps, des institutions financières déréglementées contribuaient à une hausse concurrente de la dette privée, qui deviendra en partie publique après les sauvetages financiers de 2008.
Incapables de véritablement concilier la démocratie et le capitalisme, nous aurions ainsi vécu sur « du temps acheté », pour nous retrouver aujourd’hui avec des États de moins en moins souverains, dont l’horizon principal est devenu la réalisation de surplus budgétaires récurrents dans le but de payer la dette. Dans ce monde, un peu comme dans celui de Thomas Piketty, seuls les rentiers triomphent.
Streeck ne propose pas véritablement de voie de sortie, sauf peut-être une remise en question de l’euro. Les problèmes actuels sont tels, explique-t-il au départ, qu’il n’existe peut-être pas de solution. Mais en remettant à l’avant-plan la démocratie, plutôt que les lois inéluctables du capitalisme comme Piketty, Streeck laisse tout de même une porte entrouverte. Et il nous ramène à Syriza et à Podemos, qui au minimum redonnent une voix aux premiers concernés, ces citoyens qui contestent l’emprise sur leur pays de politiques punitives et contre-productives, qu’il faudra bien finir par revoir pour permettre une reprise soutenable et juste.
Photo: Shutterstock







