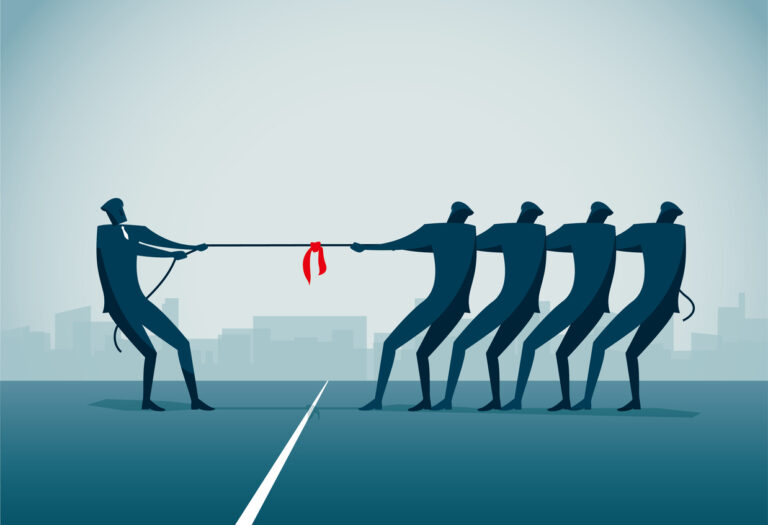(English version available here)
Le résultat des élections fédérales d’avril a été radicalement différent de ce que beaucoup avaient prédit quelques mois plus tôt. Ce qui devait être un couronnement pour le chef conservateur Pierre Poilievre s’est finalement transformé en une course serrée et âprement disputée, qui a conduit à la formation d’un nouveau gouvernement libéral minoritaire.
Une différence fondamentale séparait les deux partis. Les libéraux avaient un nouveau chef, Mark Carney, qui avait remporté une victoire écrasante lors de la course à la direction après que son prédécesseur, Justin Trudeau, profondément impopulaire, ait annoncé en janvier sa démission.
Carney semblait changer la donne. Combiné à un environnement international en rapide évolution, notamment à cause des actions du président Trump, son leadership a séduit suffisamment de Canadiens pour permettre aux libéraux de remporter encore plus de sièges en avril qu’ils n’en détenaient avant la dissolution du Parlement.
L’idée que les dirigeants jouent un rôle dans le succès ou l’échec de leur parti n’est pas nouvelle. Des modèles classiques aux approches plus contemporains du comportement électoral, les dirigeants, tout comme l’identification au parti et les préférences en matière de politique, restent parmi les facteurs les plus déterminants pour prédire le vote.
D’importantes recherches ont été menées pour déterminer quel aspect du leadership influence le plus les préférences des électeurs : la compétence ou la personnalité. D’autres travaux ont examiné comment l’influence des dirigeants peut s’accroître avec le temps — la thèse de la présidentialisation.
Cependant, même si les dirigeants exercent souvent une influence décisive sur le choix électoral, leur impact réel sur le résultat d’une élection peut être limité. Parfois, comme dans le cas de Carney, un changement de dirigeant bénéficie réellement au parti. Parfois, c’est le contraire qui se produit. C’est arrivé à John Turner après Pierre Trudeau en 1984, ainsi qu’à Kim Campbell après Brian Mulroney en 1993.
Cela soulève une question : les dirigeants peuvent-ils vraiment influencer le vote autant qu’il y paraît ? Ou y a-t-il un écart entre perception et réalité ?
Nous soutenons que l’impact des dirigeants sur la part des voix que recueille un parti tient principalement à la manière dont ils influencent l’image de marque du parti. Partant du principe que l’image de marque est cruciale pour attirer et fidéliser les partisans, nous affirmons que les dirigeants façonnent la perception qu’ont les électeurs des partis eux-mêmes.
Dans le cas de Carney, le programme présenté par les libéraux en 2025 différait grandement de celui que Justin Trudeau avait proposé lors de sa première élection en 2015. Les « méthodes optimistes » avaient laissé place à l’image d’un Carney perçu comme un gestionnaire prudent.
Nous formulons l’hypothèse que c’est au moins en partie par cet impact sur l’image de marque que les dirigeants influencent les choix électoraux. Pour la tester, nous avons utilisé les données du Bilan de la démocratie mené par le Consortium de la démocratie électorale du 21 mai au 12 juin 2024.
Nous avons posé des questions hypothétiques à plus de 1000 répondants : comment évalueraient-ils les partis politiques (libéral, conservateur, NPD) sur une échelle de 0 à 100 si ceux-ci avaient un dirigeant différent ?
Pour le Parti conservateur, nous avons interrogé les participants sur Leslyn Lewis et Jean Charest, qui s’étaient tous deux présentés à la course à la direction contre Poilievre en 2022. Pour le NPD, nous avons posé des questions sur Charlie Angus et Nikki Ashton, deux des députés les plus en vue du parti. Pour les libéraux, nous avons interrogé sur Carney (en référence aux rumeurs de 2024 selon lesquelles il pourrait se présenter) et Chrystia Freeland, vice-première ministre de 2019 à 2024.
Nous nous concentrons ici sur les électeurs hors Québec, car la force et le caractère régional du Bloc Québécois (ainsi que les enjeux propres au Québec qu’il a tendance à défendre) compliquent les comparaisons entre les choix offerts par les partis nationaux et leurs candidats à travers les provinces. Nous pouvons ainsi comparer ces résultats aux cotes de popularité des partis avec leur chef réel à l’époque, pour estimer l’effet qu’un changement hypothétique de dirigeant aurait pu avoir, même sans modification du programme des partis.
Le graphique 1 montre que l’effet d’un changement de dirigeant serait considérable, entraînant dans de nombreux cas une variation importante de la cote de popularité globale d’un parti. Cependant, l’ampleur et la direction de l’effet varient.
Les partis conservateur et néo-démocrate obtenaient leurs meilleures notes sous la direction de leurs chefs réels à l’époque. Les libéraux, en revanche, obtenaient leurs pires résultats sous Trudeau et auraient vu leur cote augmenter de manière significative (+ 4,5 points) si Carney avait été à leur tête à ce moment-là (Carney n’était alors pas encore un candidat sérieux à la direction).
Ces résultats incluent tous les répondants, y compris les non-partisans.
Pour que le résultat électoral change autant qu’en 2025, un parti doit séduire des électeurs au-delà de sa base traditionnelle.
Pour évaluer cela avec un changement hypothétique de chef, nous avons ventilé les résultats selon l’affiliation partisane des répondants, examinant l’effet du changement sur les partisans du parti concerné, mais aussi sur ceux des autres partis et sur les non-partisans.
Le graphique 2 montre que les partisans libéraux préféraient Trudeau à Carney ou Freeland. Les conservateurs et les non-partisans, en revanche, préféraient largement le parti dirigé par Carney. Les partisans néo-démocrates montraient une légère préférence pour Freeland.
Il est notable que les cotes des libéraux doublent quasiment parmi les partisans conservateurs dans ce scénario hypothétique de 2024 avec Carney à leur tête. Cela suggère qu’un changement de Trudeau à Carney aurait pu entraîner une légère perte auprès de la base libérale tout en augmentant l’attrait du parti auprès d’autres électeurs.
Le graphique 3 montre que le Parti conservateur serait mieux noté par les libéraux et les néo-démocrates si Charest en était le chef, mais beaucoup moins par les conservateurs. Contrairement aux résultats libéraux, aucun effet significatif n’est observé chez les non-partisans. Les conservateurs préféraient Poilievre.
Le graphique 4 montre que les partisans du NPD attribuaient la note la plus élevée à Singh. Libéraux et non-partisans préféraient également Singh, tandis que les conservateurs optaient légèrement pour Angus. L’ampleur des différences restait faible parmi les non-partisans.
Ces résultats confirment que les dirigeants peuvent fortement influencer la perception d’un parti, tant chez ses partisans que chez les électeurs d’autres partis.
Cela a une importance particulière dans une élection serrée comme celle de 2025 : un parti capable de séduire les partisans d’autres partis dispose d’un avantage considérable, malgré une éventuelle baisse du soutien de sa propre base.
Nos données suggèrent que, même un an avant les élections de 2025, il existait déjà des indices laissant penser que les libéraux pourraient améliorer leurs résultats auprès de certains partisans de l’opposition et des non-partisans sous la direction de Carney.
Bien qu’un tel changement puisse réduire le soutien de la base libérale, il serait largement compensé par un gain significatif auprès d’autres électeurs.
Pour les conservateurs, un changement de chef aurait produit l’effet inverse : gains modérés auprès des partisans d’autres partis et pertes importantes chez les conservateurs. Pour le NPD, un changement aurait surtout nui au parti parmi ses partisans, sans attirer de nouveaux électeurs.
Si un tigre ne peut pas changer ses rayures, un parti politique peut, semble-t-il, gagner en flexibilité grâce à un nouveau chef — du moins dans certaines circonstances.