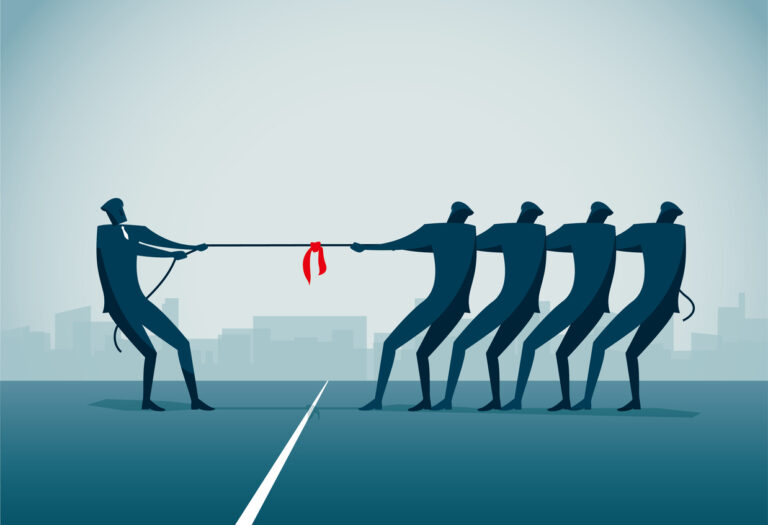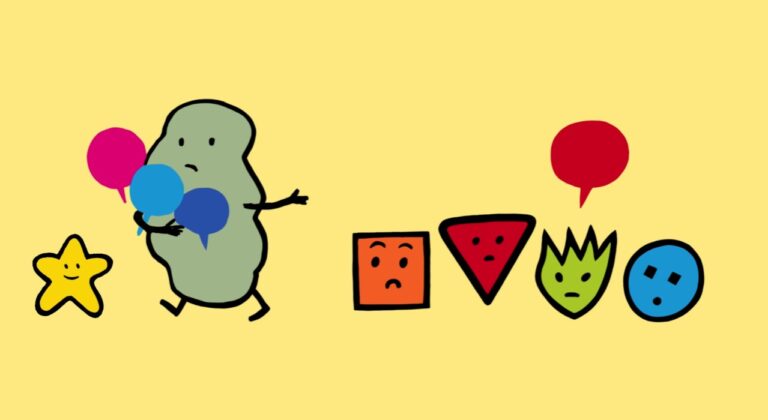(English version available here.)
Cet article fait partie de notre série Réfléchir ensemble à l’unité nationale, réalisée dans le cadre des 30 ans du référendum québécois.
Quiconque était en âge de voter le 30 octobre 1995, se souvient de la phrase prononcée par Jacques Parizeau ce soir-là. « C’est vrai qu’on a été battus, au fond par quoi ? Par l’argent, puis des votes ethniques ». Selon le premier ministre, les sommes considérables investies par le fédéral ainsi que le vote des personnes immigrantes auraient eu raison de la victoire du Oui, appuyé par plus de 60 % des Québécois francophones.
La réalité est en fait un peu plus nuancée. D’abord, en 1995, personne ne s’attendait à ce que le vote ethnique se prononce en faveur de la souveraineté. La surprise est venue bien davantage de régions majoritairement francophones — la Beauce et la ville de Québec, par exemple, 44 % et 54 % seulement pour le oui. Le vote des femmes, dont on a très peu parlé dans la foulée référendaire, s’est montré, lui aussi, assez timide.
Le Oui à la traîne chez les femmes
Tout au long de la campagne référendaire, les femmes ont trainé loin derrière les hommes pour ce qui est de l’option souverainiste. À moins de 30 jours du vote, seulement 38,9 % des femmes cochaient oui, contre 52,6 % des hommes. « Elles n’ont pas encore pris conscience qu’elles peuvent être responsables de la défaite du peuple québécois », dira Louise Harel lors d’une séance du conseil des ministres. « Il faut leur faire sentir que l’heure est grave ».
Malgré des réalignements stratégiques importants lors de la campagne, dont la nomination de Lucien Bouchard à la tête du camp du oui et la proposition d’un partenariat économique avec le Canada, les femmes sont restées de marbre alors que les hommes se laissaient gagner petit à petit. C’est sur le tard, acculé à une méfiance féminine notoire, que le camp du oui ait compris qu’il fallait s’adresser aux femmes différemment. Il ne s’agissait pas seulement d’adopter un ton moins « agressif » mais de leur proposer un véritable « projet de société ».
Opération porte-voix : séduire les Québécoises
À partir de la fin septembre 1995, les initiatives s’adressant directement aux femmes se multiplièrent. Des dépliants, des spectacles, des diners-conférences. Sous la bannière « Opération porte-voix », une cinquantaine de femmes parcoururent la province afin de convaincre les Québécoises qu’elles n’avaient rien à perdre.
Au contraire, la liberté qu’elles avaient chèrement acquise se trouverait bonifiée dans un Québec indépendant.
Non seulement leur promettait-on la parité salariale, on leur assurait l’édification du nouveau pays en stricte égalité avec les hommes. Le Québec devenait un des rares endroits au monde où « la cofondation par les hommes et par les femmes de l’espace politique » était possible.
Un sursaut… mais pas de victoire
L’offensive féministe tous azimuts n’a pas tout à fait donné les résultats escomptés. Bien que cette campagne inusitée dans l’histoire du Québec explique sans doute le bond de dernière minute chez les femmes (de 38,9 % à 52,6 %, selon les sondages effectués dans les derniers jours de la campagne), celles-ci se retrouveront toujours loin derrière les hommes, à 63,5 %.
« Si les Québécoises francophones avaient appuyé autant que les hommes le camp du Oui, écrit le politologue Guy Lachapelle dans une étude menée sur la répartition du vote, celui-ci l’aurait emporté et la majorité aurait été substantielle […] à près de 55 % ».
La souveraineté a-t-elle un sexe ?
La souveraineté aurait-elle donc un sexe ? Personne, bien sûr, n’accuserait les femmes de ne pas porter la nation québécoise dans leur cœur. Les gardiennes de la langue et de la culture, après tout, ont toujours été des femmes.
C’est au niveau politique que ça se gâte. Pour des raisons évidentes, les femmes trainent une méfiance envers le pouvoir, longtemps exercé à leur insu. Mais alors que cette méfiance traditionnelle s’estompe, vu la place grandissante des femmes en politique, un autre scepticisme, en réaction au projet souverainiste, cette fois, est bien implanté.
Un récent sondage en fait foi : 32 % des femmes contre 42 % des hommes voteraient en faveur de la souveraineté aujourd’hui. Exactement le même écart de 10 points qu’il y a 30 ans. Pourquoi ?
Deux visions de l’indépendance
Il y a toujours eu deux courants distincts au sein du mouvement indépendantiste : les Pierre Falardeau et les Françoise David. Ceux qui se préoccupent d’abord du contenant contre celles qui ont à cœur le contenu. Dans le premier cas, l’important est de planter son drapeau coûte que coûte ; on s’inquiétera plus tard de quoi aura l’air le nouveau pays. Cette approche séduit davantage les hommes.
Dans le deuxième cas, l’essentiel se trouve dans les principes qui définiront le pays à venir, dans le projet de société, une méthode qui rejoint davantage les femmes. Et pour cause. Depuis 50 ans, non seulement les femmes ont-elles mené leur propre campagne pour l’Indépendance, mais elles ont réussi là où les indépendantistes purs et durs ont échoué.
Le statut du Québec est resté le même alors que le statut des femmes a dramatiquement changé. Un Québec indépendant qui ne serait pas également féministe et progressiste représente un risque que bien des femmes, visiblement, ne veulent pas prendre.
Trente ans plus tard, la même méfiance
Croire que cette méfiance des femmes disparaitra dans l’éventualité d’un troisième référendum relève, à mon avis, de la pensée magique. Le Parti québécois a beau avoir repris du poil de la bête, en mettant le cap, justement, sur la souveraineté, il n’y a pas l’ombre d’un « projet de société » dans l’air.
Le PQ de Paul St-Pierre Plamondon est une copie assez conforme de la Coalition avenir Québec de François Legault. Après deux échecs référendaires, en plus, on imagine mal les Québécoises, ou même les Québécois, se laisser tenter par un saut dans le vide.
Relations États-Unis-Québec : ce que les référendums nous apprennent encore