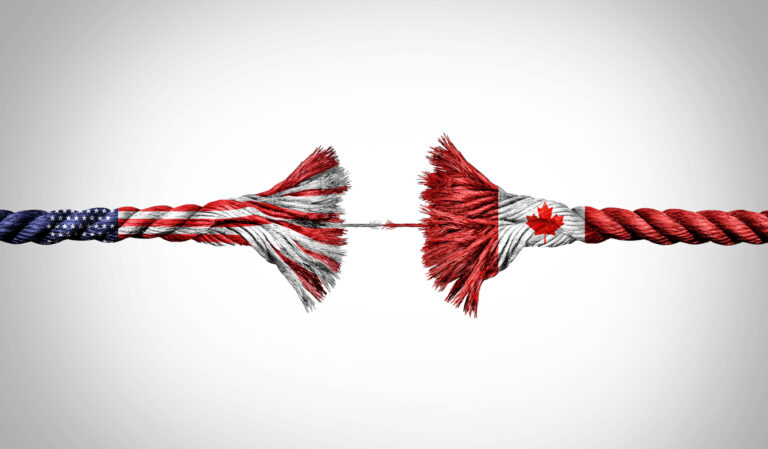La rentrée scolaire 2025 marque un tournant au Québec : les téléphones cellulaires seront bannis des écoles primaires et secondaires, et ce, pendant toute la journée de classe. Mais pour réduire de façon vraiment efficace les distractions et recadrer l’apprentissage, pourquoi se limiter aux cellulaires et aux seules écoles primaires et secondaires?
En réponse à cette mesure — et en allant au-delà de la position actuelle du gouvernement québécois — nous recommandons la restriction de tout appareil électronique dépourvu d’une finalité pédagogique explicite, au sein des établissements accueillant des jeunes, de la petite enfance jusqu’aux salles de classe destinées aux jeunes adultes de l’université.
Des technologies qui présentent des risques réels
Les recherches internationales soulignent à quel point l’utilisation des téléphones intelligents est devenue omniprésente et habituelle dans le quotidien des jeunes. En Europe, les adolescents de 13 à 15 ans déclarent consulter leur téléphone en moyenne cinq fois par heure. Le rapport Constant Companion de 2023, publié par Common Sense Media, révèle que les jeunes Américains âgés de 11 à 17 ans consultent leur téléphone plus de 100 fois par jour, recevant en moyenne 237 notifications quotidiennes, dont le quart pendant les heures de classe.
En 2024, à l’instar des statistiques américaines, les adolescents québécois passaient en moyenne 460 minutes par jour en ligne, soit près de 8 heures. Ce chiffre était de 6 heures en 2018, et il dépasse désormais la durée moyenne d’une journée scolaire au Québec (et au Canada).
Un rapport provincial récent met en évidence les risques : baisse du rendement scolaire, perturbation du sommeil, détresse émotionnelle, cyberintimidation, diminution de l’empathie et de la capacité d’attention. Ces effets rejoignent ceux observés mondialement et aggravent la crise mondiale de santé mentale chez les jeunes adultes émergents.
Des habitudes influencées par celles des parents
L’accès aux téléphones, de la petite enfance à l’adolescence, est largement influencé par les attitudes et les valeurs parentales. Les pratiques parentales actuelles, souvent permissives et centrées sur la sensibilité émotionnelle, établissent peu de limites, créant des difficultés d’autorégulation chez les jeunes de tout âge, telles que l’agressivité, la tristesse, la peur et les troubles du sommeil.
Ces pratiques sont profondément influencées par les propres habitudes technologiques des parents. Plus de 70 % des parents utilisent des appareils électroniques pendant les repas ou les jeux en famille et 89 % consultent leur téléphone pendant les interactions avec leurs enfants. Les enfants de parents distraits présentent, dès la maternelle, des taux plus élevés d’anxiété, d’agressivité et de comportements d’attachement désorganisés. Des résultats similaires ont été observés chez les jeunes en âge scolaire primaire et secondaire.
Le cerveau n’a pas le temps de s’adapter
Depuis l’industrialisation, les transformations technologiques ont dépassé celles des millions d’années précédentes. L’évolution cognitive humaine n’a pas suivi, créant un décalage entre innovation rapide et adaptation cérébrale.
Si les outils numériques ont considérablement accru notre capacité à stocker, traiter et projeter l’information, ils ont également redéfini les comportements, les identités et les normes culturelles. Pourtant, l’architecture neurobiologique du cerveau humain est restée en grande partie inchangée depuis l’ère paléolithique, créant ainsi un décalage entre l’accélération technologique et la lenteur de l’adaptation cognitive.
Le progrès technologique de l’humanité s’est toujours fondé sur des avancées cognitives collectives, élaborées sur de longues périodes s’étendant sur des millénaires plutôt que sur quelques années. Donc, l’essor des technologies numériques dépasse désormais la capacité d’adaptation du cerveau, avec des conséquences psychologiques, sociaux et écologiques.
Une surcharge cognitive qui favorise l’impulsivité
Le cerveau humain peine à suivre le rythme soutenu de l’innovation technologique, qui, bien qu’elle facilite certains processus cognitifs, le fait parfois à son détriment. D’abord, l’effort cognitif demeure essentiel au développement, au maintien et au bon fonctionnement du cerveau. Par conséquent, le fait de faciliter nos processus cognitifs a réduit notre capacité à tolérer une exigence mentale élevée. La délégation de cet effort aux technologies, phénomène connu sous le nom de déchargement ou délestage cognitif, tend à diminuer la stimulation mentale nécessaire à une activité cérébrale saine.
Génération sous pression : un appel urgent aux universités et employeurs
Puis, l’incitation à l’activité numérique constante inonde le cerveau d’informations, rendant plus difficile la hiérarchisation, le filtrage et l’évaluation des options lors de la prise de décision. Cette surcharge cognitive accroît le risque de fatigue mentale, poussant les individus à privilégier des choix impulsifs ou routiniers au détriment de décisions réfléchies. Les utilisateurs deviennent ainsi plus enclins à agir de manière impulsive et moins sensibles aux conséquences à long terme.
Enfin, la surstimulation intense induite par les outils numériques, combinée à l’activation répétée des circuits dopaminergiques de récompense, compromet les capacités attentionnelles, l’empathie et la résilience émotionnelle. Ce constat soulève des inquiétudes quant au développement humain, à la capacité d’innovation, et, par extension, à la vitalité des économies de demain.
Protéger la réussite scolaire avec l’interdiction complète
Ainsi, nous recommandons une déconnexion des téléphones cellulaires, mais aussi de tout autre appareil électronique (montre intelligente ou tablette), dépourvu de finalité pédagogique de la petite enfance jusqu’à l’université.
Notre position s’aligne sur celles de l’UNESCO et de l’OCDE. L’UNESCO préconise l’usage des technologies en milieu scolaire uniquement lorsqu’elles soutiennent clairement l’apprentissage. L’OCDE, pour sa part, avance qu’une interdiction encadrée des téléphones intelligents exerce un effet protecteur sur la réussite scolaire.
Au-delà des préoccupations liées à la fatigue cognitive et au déchargement cognitif — tous deux associés à une altération des capacités décisionnelles et intellectuelles — d’autres enjeux, plus urgents encore, viennent renforcer notre position :
- Le temps passé devant les écrans crée une dette temporelle au détriment d’activités sociales et intellectuelles plus enrichissantes chez les tout-petits, les enfants d’âge scolaire et les jeunes adultes.
- Les médias sociaux et les flux d’information crée de l’addiction et de la désinformation. Même les enfants d’âge préscolaire et les jeunes joueurs développent des schémas durables d’irritabilité et de faible tolérance à la frustration en réponse à l’usage des tablettes.
- Les algorithmes mettent de l’avant des contenus polarisants ou fortement chargés sur le plan émotionnel. Cela engendre des perceptions biaisées, une exposition accrue à des points de vue extrêmes, et renforce les biais de confirmation au moyen des dynamiques de chambre d’écho, au détriment de la pensée critique et de la capacité à adopter différentes perspectives.
- Le défilement (scrolling) et le visionnement compulsif des vidéos, notamment sur TikTok et Instagram, favorisent la solitude et l’isolement émotionnel autant en contexte social, comme à l’école. L’usage excessif du téléphone chez les jeunes est associé à des altérations psychiatriques, cognitives, émotionnelles, médicales et cérébrales. L’usage compulsif est aussi prédicteur d’une utilisation des réseaux sociaux motivée par la détresse, deux facteurs associés à un risque accru de pensées suicidaires.
Une pandémie de solitude
Un rapport économique récent de HEC Paris soutient que le capital social fonctionne comme une forme de richesse : il peut être investi, épuisé et redistribué. Le rapport conclut que d’ici 2050, cette « pandémie de solitude » aura des effets majeurs sur la natalité et l’économie.
Au fil du temps, l’investissement des contribuables dans le système d’éducation visait à produire le capital humain devant contribuer à la société, dès le début de l’âge adulte, grâce à leurs compétences, leur productivité et leur potentiel d’innovation. Cette logique suppose qu’en retour les élèves intègrent aux institutions d’enseignement et du marché de travail avec une préparation cognitive favorable à l’apprentissage.
Être en condition d’apprendre requiert non seulement des capacités cognitives, mais des compétences motrices et socio-émotionnelles. La préparation à l’apprentissage devrait être une préoccupation à chaque âge et à chaque étape du parcours scolaire, y compris à l’université. Les étudiants amorcent souvent leur première année universitaire mal préparés, jusqu’à deux tiers d’entre eux déclarant avoir déjà reçu un diagnostic psychiatrique. Se déconnecter pendant les cours serait bénéfique pour eux.
Une question de santé publique
Une instruction de qualité est essentielle à la croissance économique et au bon fonctionnement de la démocratie. L’ouverture, la curiosité et la créativité sont des compétences indispensables à la réussite. Grâce à l’éminent sociologue Durkheim, nous savons depuis plus de cent ans que l’enseignement et l’apprentissage sont une expérience partagée entre l’enseignant et l’élève en présence réelle. Il serait donc de notre responsabilité collective de veiller à ce que les élèves, à tout âge, intègrent les institutions d’enseignement dans un état cognitif propice à l’apprentissage. Cette exigence est d’autant plus pertinente dans le contexte actuel de crise en santé mentale chez les jeunes, de pénurie croissante d’enseignants au primaire et au secondaire, et de détresse psychologique chez les étudiants universitaires.
L’investissement public commence désormais dès la naissance. Au cours du dernier demi-siècle, les politiques publiques ont évolué vers un financement accru de la stimulation et des soins à la petite enfance, dans le but de favoriser le développement cognitif et social en vue de la scolarisation. La littérature scientifique est abondante et claire quant aux risques bio-psycho-sociaux associés à l’exposition précoce aux écrans et à la «technoférence». De plus, les distractions causées par l’usage des appareils mobiles par les adultes dans les milieux familiaux et les services de garde nuisent à la qualité des interactions et à la stimulation, éléments fondamentaux pour les premiers apprentissages et la régulation émotionnelle chez les très jeunes enfants.
Cette réflexion nous ramène à l’importance d’intervenir tôt, dès la petite enfance. Or, les politiques gouvernementales sont souvent adoptées de manière réactive, en réponse aux risques observés à l’échelle de la population. Des mesures comme l’interdiction des téléphones cellulaires, les lois sur le port de la ceinture de sécurité, la conduite avec facultés affaiblies ou les environnements publics sans fumée suscitent inévitablement des débats, car elles visent à rétablir la santé publique et à réduire les risques nocifs. Parce qu’elles relèvent de l’investissement public, les institutions d’enseignement ont le devoir de réduire les facteurs de risque susceptibles de nuire au développement des étudiants.
Il n’y a donc pas lieu de maintenir des environnements qui favorisent la surstimulation, la distraction constante ou la réduction des interactions sociales. Les directions d’école et le corps enseignant devront travailler ensemble pour proposer d’autres formes d’activités sociales, capables de remplacer l’omniprésence du téléphone cellulaire et de favoriser l’épanouissement des élèves. Adopter une politique de sobriété numérique, c’est protéger le développement cognitif et social des jeunes. Et, ultimement, l’avenir de l’humanité.