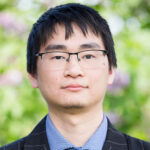(English version available here)
Le gouvernement canadien veut retrouver un rôle de premier plan sur la scène internationale. Le premier ministre Mark Carney a fièrement annoncé qu’il formerait des coalitions avec d’autres pays pour défendre la démocratie et lutter pour les droits de la personne, dans un contexte où l’ordre mondiale est mis à rude épreuve.
« Le Canada est prêt à prendre les devants », a-t-il écrit sur X à la suite d’un appel avec le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, peu après les élections du printemps.
Cette promesse intervient à un moment de profonde incertitude pour les droits de la personne internationaux. Le recul de la démocratie s’accélère, les institutions multilatérales sont ébranlées et les régimes autoritaires s’affirment davantage.
Les États-Unis, qui ont longtemps été une force dominante dans l’élaboration des cadres mondiaux en matière de droits, se sont retirés d’institutions et d’accords clés. D’autres puissances établies se sont repliées sur elles-mêmes, offrant l’occasion au Canada de se démarquer, non seulement en tant que gardien de la morale, mais aussi en tant que défenseur des droits et de la démocratie.
Mais le Canada ne peut prétendre jouer un rôle crédible sur la scène internationale s’il continue lui-même à hésiter lui-même sur ces enjeux. Derrière un discours progressiste, on constate un manque de transparence, de volonté politique et d’engagement pour concrétiser ses propres objectifs.
Dans le cadre de nos recherches en tant qu’étudiants diplômés de L’École des politiques publiques et des affaires mondiales de l’Université de la Colombie-Britannique, nous avons interviewé des dizaines de responsables et de dirigeants de la société civile sur la question. Leurs témoignages montrent clairement que le Canada souffre d’un déficit de crédibilité en matière de droits de la personne. Si le nouveau gouvernement veut vraiment jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale, il doit commencer dès maintenant à combler ce déficit.
Le problème d’engagement du Canada
En théorie, le bilan du Canada en matière de droits de la personne semble solide, mais la réalité est plus complexe. Nous avons ratifié de nombreux traités internationaux relatifs aux droits de la personne, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cependant, ces engagements sont rarement intégrés dans le droit interne. Le système juridique dualiste du Canada exige que les traités internationaux soient incorporés dans la législation nationale pour avoir force de loi au pays. Sans cette transposition, ils ne restent qu’au stade d’aspirations.
Cet écart entre les promesses et la réalité est un thème récurrent dans nos entretiens. « Il n’y a aucune transparence dans les rapports du Canada sur les droits de la personne », a déclaré une militante des droits des femmes. « Ils (le gouvernement) disent : “Nous avons dépensé 20 millions de dollars pour cela.” Mais quels ont été les résultats ? » Sans données accessibles et sans obligation claire de rendre des comptes, a-t-elle fait valoir, les déclarations du gouvernement restent de simples promesses sans suite concrète.
Isolement carcéral : il est temps d’examiner et de réformer la structure de surveillance
Compressions budgétaires de 2025 : Ottawa met en péril les droits des Premières Nations
Droits des personnes trans : quand le fédéralisme devient un champ de bataille politique
Les organisations de la société civile s’inquiètent depuis longtemps du manque d’engagement et de suivi. « Ils agissent comme des gardiens de l’information », a déclaré un défenseur des droits de la personne, décrivant comment les ministères contrôlent souvent l’accès aux réunions et les informations qui sont communiquées. Les responsables peuvent se montrer ouverts au dialogue, mais ils fournissent rarement des réponses concrètes et ne s’engagent pas à changer les choses.
Lorsque le plaidoyer national se heurte à un mur, nombreux sont les groupes qui se tournent vers des instances internationales. Un ancien observateur des Nations unies explique : « Les communautés autochtones et les groupes de défense des droits de la personne ont depuis longtemps recours aux systèmes multilatéraux pour obtenir justice, car les voies nationales leur sont fermées. »
Même au sein du gouvernement, certains reconnaissent les lacunes. Un haut fonctionnaire fédéral nous a confié : « Nous rendons toujours des comptes [à l’ONU], mais nous pourrions faire mieux en matière de transparence, notamment sur la mise en œuvre au niveau national. »
Il cite les problèmes de coordination entre les ministères et la fragmentation du système canadien de protection des droits de la personne. Par exemple, le ministère du Patrimoine canadien est chargé de coordonner les rapports sur les droits de la personne, mais les ministères de la Justice, de l’Immigration et des Services aux Autochtones travaillent chacun de leur côté, sans coopération.
Un fonctionnaire nous a fait remarquer que la collecte de données sur les droits au logement ou les questions autochtones nécessitait de « suivre plusieurs pistes », souvent à travers les juridictions fédérales, provinciales et territoriales. Un autre a souligné la difficulté de préparer les rapports destinés à l’ONU sans qu’un organisme central oblige les ministères à répondre dans les délais ou de manière détaillée.
Un cadre dysfonctionnel
Le Canada compte plusieurs organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux censés contribuer à la mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits de la personne, mais ceux-ci obtiennent rarement des résultats significatifs. Le Comité permanent des fonctionnaires chargés des droits de la personne et le Forum des ministres sur les droits de la personne ont été créés pour promouvoir l’harmonisation entre les différentes instances. Les conclusions de notre recherche montrent qu’en pratique, la coordination est incohérente, la communication limitée et qu’il n’existe aucun mécanisme contraignant pour assurer l’imputabilité.
Le problème n’est pas seulement technique. Il est politique. Les provinces et les territoires résistent souvent à la surveillance fédérale et les réunions se tiennent à huis clos. « Nous ne savons pas qui se trouve dans la salle ni quels sont les sujets de discussion », nous a révélé un défenseur des droits immobiliers.
Une initiative prometteuse est la base de données nationale de suivi des recommandations, une initiative mondiale des Nations unies pilotée par le Canada, afin de surveiller la manière dont les pays planifient et respectent leurs obligations en matière de droits de la personne. Elle vise à centraliser les informations et à rendre les progrès visibles pour le public. Son succès dépend de l’action et de la transparence du gouvernement et, sans leadership politique, elle risque de devenir un simple exercice de cases à cocher.
Pas de responsabilité sans volonté politique
Le manque de supervision politique à haut niveau est peut-être la lacune la plus flagrante. Jusqu’à il y a deux ans, les ministres fédéraux et provinciaux chargés des droits de la personne ne s’étaient pas réunis officiellement depuis près de trois décennies. Cela a changé avec la création du Forum des ministres sur les droits de la personne, mais l’impact de celui-ci a été négligeable jusqu’à présent. Un expert juridique que nous avons interrogé a qualifié la réunion inaugurale du forum en juin 2023 de « déception ».
« Rien n’a été annoncé. Aucun engagement n’a été pris. Il n’y a eu aucun résultat concret », a déclaré l’expert, qui a ajouté que le seul résultat était « une liste de choses dont ils ont parlé, rien de plus ».
Un sénateur à qui nous avons parlé l’a exprimé plus crûment : « Nous avons besoin de plus que de simples réunions. Nous avons besoin de plans d’action, de calendriers clairs et de conséquences en cas de non-respect ». Selon elle, sans responsabilités politiques, les progrès en matière de droits de la personne au Canada continueront de stagner.
Une opportunité pour le Canada
Si le premier ministre Carney souhaite réellement que le Canada joue un rôle de premier plan dans la gouvernance internationale postétats-unienne, notre pays doit d’abord prouver qu’il est capable de respecter les valeurs qu’il promeut à l’étranger. Cela signifie renforcer ses institutions nationales en matière de droits de la personne, non seulement en améliorant les rapports, mais aussi en veillant à ce que les engagements soient respectés, que les données soient accessibles et que les groupes communautaires, les défenseurs et les organisations non gouvernementales soient traités comme de véritables partenaires.
Les personnes interrogées ont systématiquement appelé à des mécanismes de responsabilisation plus solides. Certaines ont proposé une législation visant à rendre obligatoire le suivi des recommandations de l’ONU ou à créer un organisme de coordination indépendant doté d’un réel pouvoir. Sans obligations contraignantes, comme l’a fait remarquer un expert, « tout reste au stade des aspirations ».
D’autres ont souligné la nécessité de rendre la base de données de suivi publique, régulièrement mise à jour et conviviale, afin que les défenseurs et les groupes de la société civile puissent suivre les progrès et faire pression sur le gouvernement si nécessaire.
Enfin, le partenariat doit aller au-delà des consultations. Les parties prenantes ont appelé à des discussions régulières, transparentes et inclusives avec toutes les parties, en particulier les communautés autochtones et les organisations de défense des droits. Comme nous l’a dit une personne interrogée, « la transparence n’a aucun sens sans un accès significatif ».
Tout cela implique une volonté politique. Les droits de la personne ne peuvent rester un projet bureaucratique secondaire enfoui dans des comités intergouvernementaux. Les dirigeants fédéraux doivent fixer des attentes claires aux provinces et aux territoires, donner un réel pouvoir aux organismes de surveillance et, surtout, montrer aux Canadiens et au monde entier qu’ils sont prêts à rendre des comptes.
Le Canada dit vouloir montrer la voie? C’est l’occasion de passer de la parole aux actes dans sa propre cour.