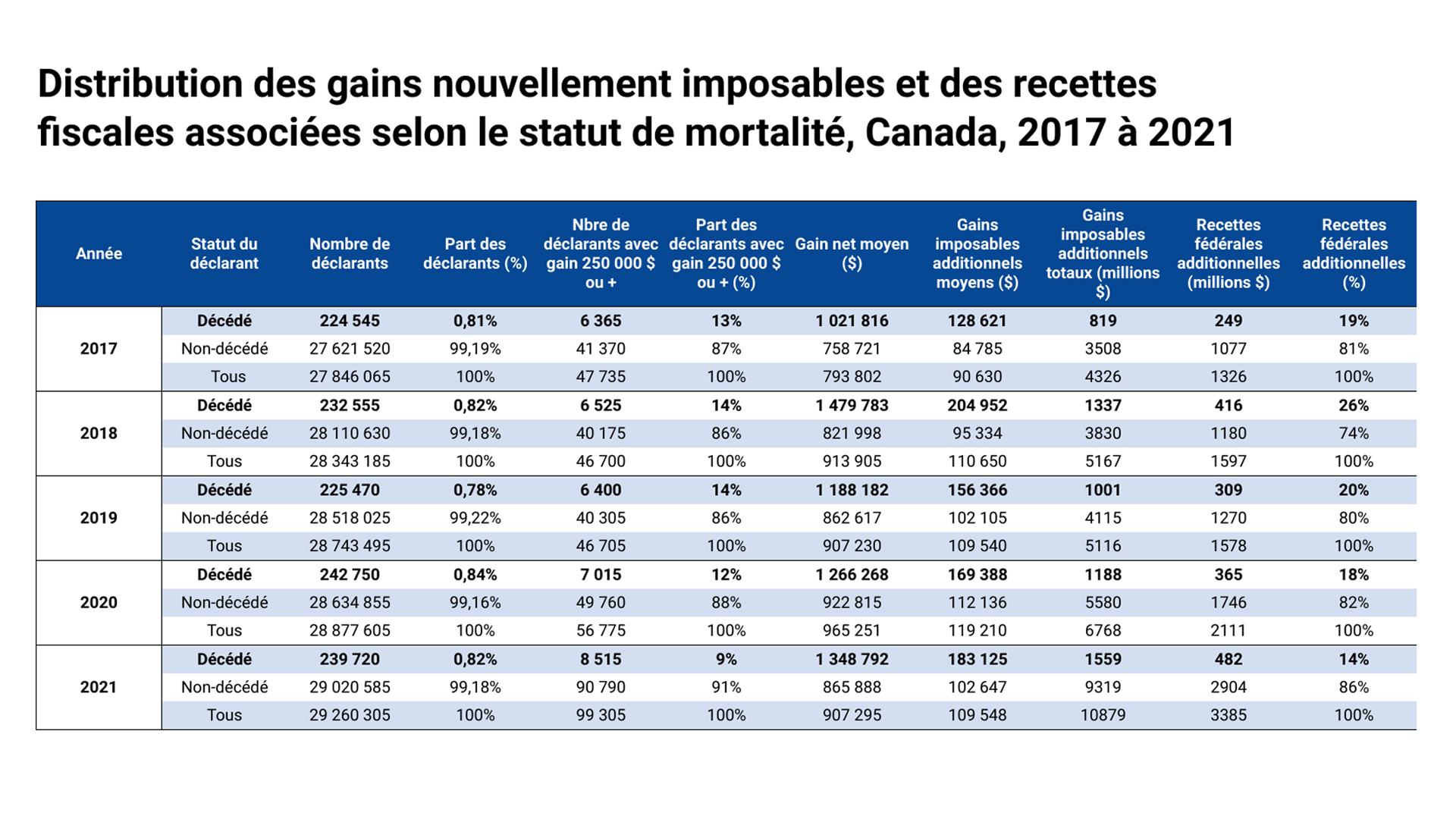En dépit de la mondialisation de l’économie, le principe de souveraineté nationale demeure l’un des plus structurants de l’humanité. Cela explique en partie pourquoi chaque fois que l’on croit le mouvement souverainiste moribond au Québec, celui-ci se recompose et rebondit évoquant toujours de nouveaux arguments qui s’ajoutent aux plus anciens toujours valides. C’est parce que la souveraineté demeure un trait essentiel du système inter- national que ce mouvement ne peut pas, sérieusement, être accusé d’être dépassé. Loin de cultiver une vision archaïque du monde, les souverainistes québécois sont au contraire au diapason des grandes tendances internationales. Je voudrais illustrer la justesse de leur ambition en examinant les six propositions suivantes.
Les petits pays s’en tirent bien dans la mondialisation. L’ouverture des frontières a donné libre cours à diverses logiques de réseaux. Les flux financiers, l’information télévisée autant que la musique commerciale ou le cinéma, circulent désormais nuit et jour sans contrainte, ou presque,par satellite, par câble ou par Internet, partout où la tech- nologie permet à un individu de se connecter au reste du monde. Les migrations internationales sont également plus nombreuses. Des solidarités religieuses, culturelles ou lin- guistiques, des diasporas de toutes sortes l’emportent sur les logiques territoriales.
L’espace économique mondial est, lui aussi, désormais ouvert. Il n’est pas dénué de contraintes mais il permet plus que jamais l’extension d’activités de toutes sortes en dehors du territoire national. Le monde devient alors un horizon de possibles, une source d’inspiration, un territoire à explorer et à conquérir. Il s’agit certainement de l’un des principaux effets de la mondialisation : elle suscite le désir chez les individus de tirer profit des possibilités que lui offre cette ouverture.
Le monde est aussi devenu le lieu d’une féroce com- pétition pour la conquête de marchés et le recrutement d’in- vestisseurs étrangers. Tout État qui a la responsabilité de veiller au bien-être et à la prospérité d’un peuple doit, de nos jours, élaborer ses politiques en gardant les yeux rivés sur ce qui se passe à l’échelle plané- taire. Le cas du Québec est patent à cet égard : 60 p. 100 de notre économie est tributaire du commerce international.
Cette vision capitaliste et compéti- tive de la mondialisation est contestée. C’est justement ce modèle néolibéral du monde qui suscite tant de protesta- tions au sein de la société civile. Cette mondialisation-là tire les pays vers la logique du marché et tend à imposer aux États des règles du jeu favorables au secteur privé mais qui accentuent les inégalités entre les classes sociales au niveau national aussi bien qu’entre les pays. Les États ont des moyens à leur disposition pour résister à cette tendance, j’y reviens au point suivant.
Pour le moment, je constate toute- fois que, dans la jungle de l’économie mondiale, les petits pays sont en mesure de tirer leur épingle du jeu. Le prix Nobel d’économie Gary S. Becker, de Chicago, a montré que, dans le monde d’aujourd’hui, être un petit pays n’est nullement un handicap sur le plan économique. Au contraire, à partir de 1950, le produit national brut per capita a augmenté plus vite dans les petits pays que dans les grands, a observé l’économiste. Plusieurs de ces petites nations ont compris qu’elles pourraient faire mieux en spécialisant une partie de leur production indus- trielle et en destinant cette production au marché mondial. À cause de leur petite taille ou à cause de la plus forte homogénéité de leur population, ces pays-là semblent avoir été en mesure de s’adapter aux conditions nouvelles plus facilement que les plus grands. Cette adaptation dépend évidemment de la capacité d’innovation des petites nations concernées.
Après leur divorce de velours, la République tchèque et la Slovaquie ont vu leurs économies prendre du mieux. Les pays où le niveau de vie est le plus élevé sont les pays scandinaves, don’t la taille ressemble à celle du Québec. L’exemple irlandais n’est pas banal non plus. Pays archipauvre au début du siècle, qui, après son indépendance et en jouant toutes les cartes à sa dis- position dans l’économie mondiale, notamment ses liens avec l’Europe, a su rattraper les autres.
En outre, au fur et à mesure que le système commercial mondial va adopter des règles de fonctionnement contraignantes, il va donner aux petits pays les moyens de se défendre contre les gros. C’est la souveraineté nationale qui crée ici l’égalité entre les États mal- gré la disproportion de leurs puis- sances économiques respectives. Le Canada vient de remporter une vic- toire à l’OMC dans le dossier du bois d’œuvre contre les États-Unis. Le Costa Rica, un petit pays de 3,1 millions d’habitants, a réussi la même chose il y a quelques années contre le géant américain qui lui avait imposé des restrictions sur la vente de produits textiles sur son territoire. Ce sont les pays du Tiers-Monde qui ont fait échouer la conférence de l’OMC à Seattle. Ce sont eux qui, aujourd’hui, forcent la main des grandes puissances dans le dossier agricole et dans celui des médicaments.
La coopération internationale renforce la souveraineté des États. La liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux a sans nul doute accru le pouvoir des acteurs économiques à l’échelle plané- taire, en particulier celui des entrepri- ses multinationales. Ce pouvoir tient à la capacité de ces entreprises de choisir où elles vont faire fructifier leurs avoirs. Les pays sont entrés dans une course pour l’investissement étranger. C’est à qui en attirera le plus. Comme l’écrivait, avec une pointe d’ironie, le sociologue Ulrich Beck dans le dernier numéro de la revue Le Débat, « il n’y a qu’une seule chose pire que d’être envahi par les multinationales : c’est de ne pas être envahi par elles ». Le pouvoir des multinationales leur vient donc de la possibilité d’aller ailleurs.
Contrairement à celui, classique, des États, le pouvoir des entreprises n’est lié à aucun lieu précis et c’est ce qui le rend si prodigieux. La libéralisa- tion des échanges doublée à la creation d’un espace mondial virtuel, numérique, intangible, a aussi rendu plus compliquée la répression de la criminalité et le contrôle des trafics illicites de tous genres.
Dans la mondialisation néolibérale, les sociétés privées sont à même d’af- faiblir les États nationaux en les jouant les uns contre les autres. La concurrence entre les États renforce le pouvoir des acteurs économiques. La force du pou- voir économique vient de la dissocia- tion de leur activité d’avec un territoire en particulier. Pour faire contrepoids au pouvoir déterritorialisé des entreprises, les États n’ont qu’à imiter les entreprises et à porter l’exercice du pouvoir éta- tique à l’échelle mondiale. Ils ont d’ailleurs déjà commencé à le faire.
Les 190 pays qui existent dans le monde sont déjà liés par un maillage serré d’institutions et de traités. Près de 350 organisations intergouverne- mentales, dont plus de la moitié ont été créées après 1960, remplissent des fonctions économiques et sociales ou de maintien de la paix. Celles-ci n’empêchent pas toutes les guerres, ni l’effet de serre, et encore moins l’élargissement du fossé entre riches et pauvres. Mais elles imposent déjà des normes en matière d’environ- nement, de conditions de travail, de sécurité ou de protection du patri- moine et des cultures.
Les États agissent déjà dans l’es- pace transnational lorsqu’ils négo- cient des accords commerciaux contraignants ou, comme en Europe, créent des structures de souveraineté partagée et coopérative. En d’autres termes, c’est en liant leurs efforts, en s’associant, en coopérant entre eux que les États portent leur pouvoir au même niveau que celui des entreprises multinationales.
La coopération n’entraîne pas la fin de la souveraineté. L’ouverture des frontières n’est pas synonyme de leur abolition. S’il n’y a plus de contrôle douanier entre les pays membres de l’Union européenne, par exemple, la circulation des biens et des per- sonnes n’en est pas totalement libre pour autant ; en effet, on l’a remplacé par des formalités administratives, des vérifications aléatoires sur les routes, le filtrage des passagers par les compagnies d’aviation ou encore l’utilisation de banques de données pour repérer les étrangers jugés indésirables. Les différents corps de police nationaux augmentent par ailleurs leur coopération pour juguler l’immi- gration clandestine, réprimer la crimi- nalité, freiner le trafic de stupéfiants ou se protéger contre le terrorisme.
Les mécanismes à l’œuvre à l’échelle mondiale sont d’ailleurs, en général, des structures intergouverne- mentales. Il n’y aura sans doute jamais de « gouvernement mondial » placé au-dessus des États parce que la démo- cratie n’est pas applicable à un ensem- ble aussi vaste et aussi diversifié. Les ententes multilatérales restent les meilleurs instruments de coordination des activités étatiques à l’échelle plané- taire. Ce sont les pays qui décident de leur création, qui en contrôlent les décisions et qui déterminent les normes communes. Seuls les pays y ont droit de cité. Ce sont les pays qui mènent le monde. Encore faut-il pos- séder la souveraineté avant de pouvoir la partager. Seule la possession de la souveraineté permet à un État de s’en- gager envers un partenaire à appliquer sur son propre territoire le contenu d’un traité.
Contrairement à ce que l’on entend parfois, la coopération interna- tionale ne réduit pas la souveraineté des États, elle l’accroît. Il est donc faux de prétendre, comme le fait par exem- ple le chef de l’Alliance canadienne, Stephen Harper, que la souveraineté est une notion caduque à une époque comme la nôtre où domine l’inter- dépendance entre les peuples. Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’aucun pays souverain, même parmi les plus petits, ne semble disposé à renoncer à la souveraineté déjà acquise. Au contraire, depuis 1980, 43 nouveaux pays ont été admis aux Nations unies.
Ulrich Beck fait une distinction utile entre autonomie et souveraineté. L’autonomie est la capacité d’agir à sa guise. La souveraineté est la capacité de résoudre des problèmes politiques dans un territoire donné. Par la signa- ture de traités internationaux, les États réduisent certes en partie leur autonomie. Ils s’imposent volontaire- ment des contraintes. Mais la coopération accroît leur souveraineté de deux manières.
D’une part, les ententes interna- tionales contribuent au règlement de problèmes qui ne peuvent plus trouver de solution sur le plan national. Les problèmes environnementaux sont le meilleur exemple. La lutte contre le ter- rorisme ou contre les trafics illicites ne peut être menée efficacement autrement que par la coopération interétatique. Il en est de même pour la régulation des flux financiers, l’imposi- tion de normes de sécurité, de conditions de travail minimales, le respect des droits de la personne et tant d’autres choses. On l’a vu plus haut, les États portent ainsi leur autorité au niveau transnational. Il s’agit donc pour eux d’un gain de souveraineté. Par leur action commune, ils peuvent imposer des normes aux acteurs, notamment les entreprises multinationales, qui cher- chaient à échapper à leur autorité.
D’autre part, les ententes interna- tionales contribuent à réduire certains risques ou ouvrent des possibilités aux ressortissants des pays signataires qui aident chacun des États à résoudre des problèmes nationaux. En permettant aux entrepreneurs locaux d’exporter plus facilement dans le pays voisin, on favorise la croissance de l’économie et la création d’emplois, la réduction du chô- mage et l’élévation du niveau de vie, ce qui permet non seule- ment de résoudre certains pro- blèmes sociaux liés au chômage et à la pauvreté, mais aussi d’augmenter les revenus tirés par l’État des impôts et des taxes pour ainsi rehausser sa capacité à dépenser des fonds publics pour financer des services. Les béné- fices du partage de la souveraineté par la coopération incluent également la sécurité et la stabilité, des dépenses militaires réduites, etc.
Si la coopération internationale accroît la souveraineté des États, une nation sans État est doublement péna- lisée par la mondialisation. Non seule- ment cette nation subit les effets délétères des tendances néolibérales dominantes mais elle voit se renforcer le pouvoir d’États sur lesquels elle n’a aucune capacité de contrôle. En sus, elle est privée de la possibilité d’ac- croître son propre pouvoir.
La mondialisation ne réduit pas le rôle de l’État sur son territoire. La mon- dialisation est un phénomène bourré de paradoxes. Ainsi, autant les entreprises préconisent-elles des allégements régle- mentaires ou la réduction de l’interven- tion des pouvoirs publics dans l’économie, ce qui pourrait être assimilé à une réduction du rôle de l’État, autant la mondialisation requiert des États suffisamment puissants pour faire accepter aux populations locales les normes adoptées à l’échelle interna- tionale pour favoriser aussi bien la libéralisation des échanges que la pro- tection de l’environnement, par exem- ple. La mondialisation ne peut donc pas se passer des États. Les entreprises non plus qui doivent s’insérer, partout où elles s’établissent, dans un cadre légal prédéterminé qui assure l’équité de traitement entre les différents acteurs économiques. L’une des premières choses que fait une multinationale en s’installant dans un pays est d’em- baucher un avocat pour veiller à se con- former aux lois en vigueur.
L’État a donc de l’avenir. Il en a aussi pour une autre raison. Dans bon nombre de domaines, le marché ne pourra jamais remplacer l’État : la médiation et l’arbitrage entre des intérêts diversifiés ; l’administration de la justice ; la sécurité publique ; la réglementation des marchés ; la livrai- son des services publics ; la redistribu- tion de la richesse ; le soutien aux productions culturelles ; la protection de l’environnement; le développement du capital humain par l’éducation ; la protection de la santé ; la construction et la préservation d’infrastructures ; la perception des taxes et des impôts pour financer un ensemble de services ; la protection des droits fondamentaux ; la protec- tion des identités collectives ; la trans- mission des valeurs communes ; la représentation des intérêts de la nation à l’étranger ; la création d’un environnement favorable au développement économique et social ; l’aménagement du territoire ; etc.
La part du PIB que prennent les dépenses publiques n’a guère diminué ces dernières années dans les économies occidentales. La perspective de la dissolution des États dans une économie mondialisée n’est pas con- forme à la réalité.
L’importance du rôle des États nationaux et l’effet de la souveraineté peuvent aussi se mesurer par la com- paraison des politiques en vigueur dans deux pays voisins. En dépit de leur puissance militaire et de leur poids économique, les États-Unis ne sont souverains qu’à l’intérieur de leurs frontières. La souveraineté américaine ne peut pas déborder au Canada. On ne peut pas nier l’influence améri- caine. Mais il existe de profondes dif- férences entre les cultures politiques des deux pays qui ont adopté des poli- tiques publiques parfois aux antipodes. L’existence au Canada d’un système public et universel de santé est sans doute l’illustration la plus éloquente de la différence entre les deux régimes ; l’abolition de la peine de mort au Canada, qui est toujours en vigueur dans une majorité d’états américains ; la perspective d’autoriser les mariages entre personnes de même sexe ; l’exis- tence d’un réseau public de télévision ; la nature des ententes conclues avec les nations autochtones ; le bilin- guisme officiel ; le multiculturalisme ; le soutien public aux entreprises cul- turelles ; le contrôle des armes à feu ; le sort réservé aux délinquants juvéniles ; et le reste à l’avenant. L’existence d’une frontière entre les deux pays rend possibles ces distinctions.
Le même constat peut être fait en Europe malgré la construction de l’Union européenne.
En somme, la mondialisation ren- voie les nations à elles-mêmes, qui doivent se doter des outils pour faire face à la compétition des autres pays, pour préserver l’identité nationale, sauvegarder l’autorité des institu- tions, adapter les politiques aux besoins et aux préférences des citoyens. C’est ce que les Québécois ont cherché à faire, au fil du temps, dans les limites du pouvoir provincial. Leur identité particulière et leur volonté d’autonomie les a poussés à former une communauté politique distincte au sein du Canada, même si de nombreuses compétences constitutionnelles, y compris dans le champ économique, leur échappent.
Malgré ces contraintes et ces manques, le Québec s’est doté d’un modèle de développement (le fameux modèle québécois) qui lui a permis de se défaire d’un héritage de pauvreté et d’infériorité économique, de sortir d’une économie centrée sur les ressources pour créer une économie diversifiée, et de réduire l’écart de richesse qui nous sépare de nos voisins. Ce modèle s’appuie sur une société distincte par rapport au reste de l’Amérique du Nord, plus libérale et plus égalitaire, moins autoritaire, plus sympathique aux organisations collectives, plus sensible aux revendi- cations des femmes, plus efficace à réduire les écarts entre riches et pau- vres. La société québécoise jouit d’une grande capacité d’innovation et a su faire évoluer démocratiquement son modèle. Ces deux caractéristiques (innovation et démocratie) doivent être préservées pour que le Québec puisse continuer à la fois à tirer son épingle du jeu sur les marchés et préserver la capacité de son État à répondre aux besoins, préférences et aspirations de son peuple. Ces ques- tions ont été débattues lors d’un forum public en février 2003 auquel ont participé quelque 400 citoyens provenant de toutes les régions du Québec et dont les actes seront pu- bliés cet automne sous le titre Justice, démocratie et prospérité : L’avenir du modèle québécois.
Or présentement, la capacité d’in- novation du Québec est brimée par les ambitions de l’État central canadien, par l’étranglement fiscal qui découle du déséquilibre observé par la Commission Séguin et de l’utilisation du pouvoir fédéral de dépenser, aussi bien que par l’extension des compé- tences fédérales dans tous les champs définis par la Constitution. Cette entrave à l’innovation qui se trans- forme progressivement en déni démocratique s’observe dans des domaines aussi divers que la santé, la citoyenneté, l’intégration des immi- grants, la langue, l’économie, la poli- tique sociale, la politique familiale, l’assurance-chômage, le développe- ment local, le financement des univer- sités, le soutien au cinéma, etc.
La souveraineté est une condition de la démocratie. Il existe des pays sou- verains qui ne sont pas démocratiques. La souveraineté n’est donc pas une garantie de démocratie. Elle en est toutefois une condition. Dans Après l’État-nation, le philosophe Jà¼rgen Habermas a montré que l’idée qu’une société puisse agir démocratiquement sur elle-même n’a connu jusqu’ici de concrétisation que dans un cadre national. L’État-nation est, dit-il, « la formation sociale la plus grande que l’on connaisse jusqu’ici, qui ait su ren- dre acceptables les sacrifices liés à la redistribution de la richesse ». De ren- dre acceptables, également, les con- traintes imposées par la loi. Ce qui est en cause, c’est la légitimité des déci- sions prises par l’État. La légitimité ne peut découler que de mécanismes démocratiques et d’une pratique de formation de la volonté commune par la délibération.
Il serait impossible de mettre en œuvre, à l’échelle continentale ou planétaire, un mécanisme de délibéra- tion qui puisse se rapprocher, même timidement, d’un processus démocra- tique. Les obstacles matériels à l’or- ganisation d’élections continentales ou planétaires sont déjà une con- trainte majeure, bien que non insur- montable. Le principal problème réside dans l’incapacité évidente de faire participer à un débat démocra- tique des personnes aussi nombreuses, disséminées aux quatre coins du monde, parlant des langues dif- férentes, ayant des conditions de vie qui ne sont aucunement comparables et des références culturelles incompa- tibles. Le quadrillage du monde en pays séparés contribue à rendre appli- cable le principe démocratique.
La légitimité d’un gouvernement ou d’un État lui vient de la population qui décide, démocratiquement, du bien commun. Or, comme l’a écrit le philosophe Charles Taylor dans Penser la nation québécoise, « pour décider ensemble il faut aussi délibérer ensem- ble, et il n’y a pas de délibération col- lective possible sans un accord de fond sur des principes, des buts, des valeurs clés ». Ou encore, comme l’a expliqué Jà¼rgen Habermas, la mobilisation poli- tique des citoyens suppose une idée qui soit assez forte pour marquer les consciences et qui, plus que la sou- veraineté populaire et les droits de l’homme, en appelle au cœur et au sentiment. En somme, il faut une nation pour légitimer l’État. C’est la conscience nationale, cristallisée autour de la perception d’une langue et d’une histoire communes, donc la conscience d’appartenir à un même peuple, qui tranforme les sujets en citoyens capables de se sentir solidaires les uns des autres.
Cette conscience nationale ne peut se bâtir autrement que sur un territoire donné, relativement délimi- té, gouverné par des institutions démocratiques.
La mondialisation ne supprime pas les identités nationales. La mon- dialisation n’a pas eu pour effet de détruire les identités nationales. Au contraire, elle fait naître des résis- tances à l’homogénéisation qui s’ap- pellent régionalismes, nationalismes, réveils politiques. Le combat pour la diversité culturelle à l’échelle plané- taire représente l’un de ces mouve- ments de résistance.
La mondialisation nous fait pren- dre conscience du fait que les identités nationales s’expriment désormais dans un ensemble plus vaste. Les peuples ont un désir de s’inscrire dans le monde. On ne peut plus vivre comme Robinson sur son île. Les identités sont soumises à l’influence de tous les vents et elles alimentent à l’inverse l’évolu- tion des autres.
La modernité poussée par la mon- dialisation n’est pas incompatible avec des identités fortes. La modernité a libéré l’individu de son passé et de la tradition. C’est-à-dire que celui-ci n’est plus contraint. Il exerce désormais des choix. Mais c’est en eux-mêmes, dans leur subjectivité, comme l’explique Joseph-Yvon Thériault dans L’Identité à l’épreuve de la modernité, que les hommes et les femmes puisent les règles qui les guident en société. Or en renvoyant les sujets à leur volonté, la modernité réintroduit par le fait même une dimension identitaire parce que l’une des choses qui influence la volonté, c’est l’identité d’une person- ne. Le sujet a une langue, une culture, une histoire. Je suis moi, mais l’une des choses qui fait que je suis ainsi, c’est que je suis Québécois.
Le pouvoir et la persistance des États nationaux s’appuient sur l’iden- tité culturelle qui refait surface dès que l’on cherche à l’ignorer. Devant l’im- mensité du monde, l’individu perd ses repères, tandis que, dans la nation, il trouve une échelle qui rend possibles l’action, l’engagement, les relations avec les autres, la reconnaissance de sa propre existence ainsi qu’une capacité d’avoir une emprise sur les instances qui gouvernent sa vie. L’appartenance nationale agit comme un réconfort et confirme que l’on n’est pas laissé seul face à l’immensité du monde.
L’identité culturelle ou nationale est un bien qu’il faut préserver.
Les nations ne peuvent plus s’appuyer sur la tradition mais sur la démocra- tie. A contrario, l’identité culturelle est contestée aujourd’hui par l’individua- lisme. La référence nationale n’a plus la même force d’attraction qu’autre- fois. La persistance des nations, qui sont garantes de la démocratie au sein de l’État moderne, ne peut plus s’appuyer sur la tradi- tion. Rares aujourd’hui sont les personnes qui veulent se faire imposer un mode de vie ou des choix par la cou- tume ou la mémoire des Ancêtres. La liberté vient de la capacité de choisir.
La démocratie moderne et du métissage. La référence nationale a ainsi perdu de sa force d’identifica- tion au profit de la citoyenneté qui, elle, a le mérite de conférer aux indi- vidus des droits sur la base de l’égalité entre les personnes.
Nous avons dit que la nation était un bien qu’il faut préserver au nom de la démocratie. Nous constatons que la référence nationale, de nature cul- turelle, n’est plus suffisante pour préserver l’unité du groupe. La citoyenneté est désormais une référence plus forte. Si les Québécois veulent préserver et consolider l’unité de leur communauté politique, il leur faut fonder une citoyenneté québé- coise accueillante et inclusive. La citoyenneté consolide la nation.
Or, la manière dont le régime politique canadien a évolué depuis quelques décennies, vers un État- nation classique, renforçant divers élé- ments de la citoyenneté canadienne (notamment le rôle de la Charte des droits et libertés) pour favoriser la construction d’une nation unifiée d’un océan à l’autre, porte à croire qu’une citoyenneté québécoise ne sera jamais reconnue dans le cadre consti- tutionnel actuel. Le Canada a meme est née comme projet de donner la parole au peuple. Or la démocratie dis- paraît lorsque, au lieu de la délibéra- tion des citoyens, ce sont des règles techniques du marché ou du droit qui dictent la volonté au peuple. L’antidote aux effets pervers de la mondialisation se trouve dans le ren- forcement de la démocratie. Or la démocratie n’a pas de sens, avons- nous observé, si elle n’est pas exercée au sein d’une communauté politique formée de personnes ayant conscience de constituer un même peuple.
Dans le contexte ouvert et mon- dialisé d’aujourd’hui, où les identités culturelles sont contestées par l’indi- vidualisme, la seule voie de sortie est de doter les nations d’une existence collective de nature politique, pro- tégée par des institutions démocra- tiques et cosmopolites, dans lesquelles les droits individuels sont garantis par la citoyenneté.
Le projet souverainiste québécois n’est rien d’autre que l’application de ce principe.
Les Québécois forment une nation. Je définis la nation, m’inspi- rant d’Alain Touraine, comme « une société qui a suffisamment débattu et réfléchi sur elle-même pour acquérir la conscience de former une commu- nauté politique enracinée dans une histoire et dans une culture ». J’ai essayé de montrer ailleurs que, suivant cette définition, il est incontestable que la société québécoise répond à ces critères. Or la société québécoise, à l’instar des autres sociétés occiden- tales, est devenue pluraliste sous l’in- fluence des migrations internationales été incapable de reconnaître que le Québec forme une société distincte. Au contraire, en acquérant la sou- veraineté, le Québec pourrait fonder une nouvelle citoyenneté.
La souveraineté reste l’un des principes les plus structurants de l’humanité. La coopération, l’inter- dépendance et l’ouverture des fron- tières ne suppriment pas la souveraineté ; au contraire, ces phénomènes sont de nature à ren- forcer l’autorité étatique. La sou- veraineté est une condition de la démocratie et du respect de la diversité identitaire à l’échelle mondiale. Les petits pays peuvent tirer leur épingle du jeu dans la mondialisation s’ils sont intégrés dans un grand marché et capa- bles d’innovation.
Or le statut actuel du Québec l’empêche de devenir un acteur à part entière sur la scène internationale. Il brime la reconnaissance de l’identité nationale québécoise à l’échelle plané- taire. Il empêche le Québec de fonder une citoyenneté susceptible de con- solider la nation, elle-même garante de la démocratie. Il confine les Québécois dans le nationalisme. Il brime la capacité d’innovation de la société et ainsi sa capacité d’être com- pétitif avec les autres nations du monde. Toutes ces raisons expliquent en quoi le statut d’État souverain serait, pour lui, préférable.