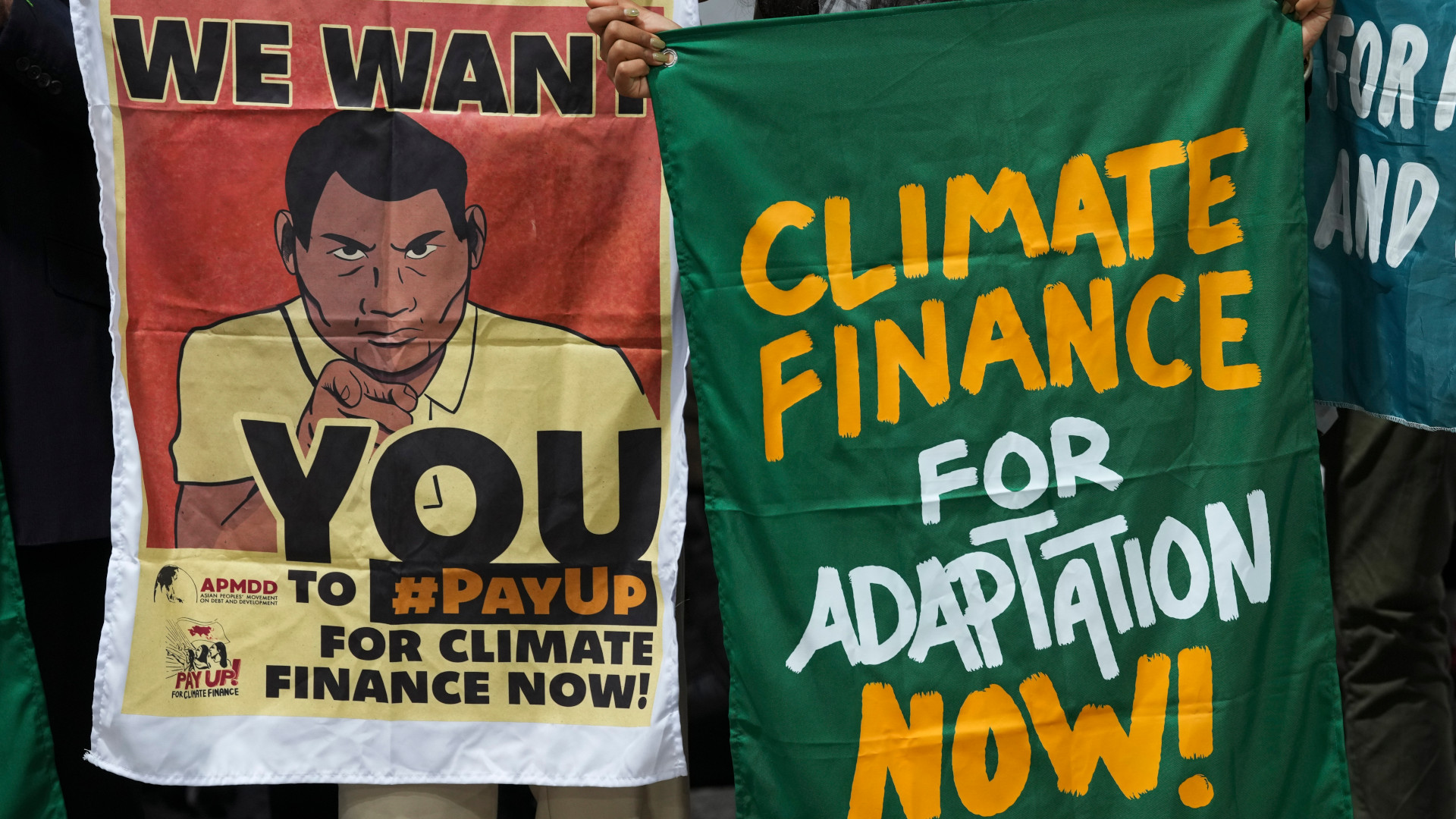(English version available here)
Le paysage politique mondial évolue, passant de la collaboration internationale, qui a permis l’Accord de Paris il y a dix ans, à des politiques de plus en plus nationalistes. Ce changement met en lumière l’un des problèmes les plus complexes dans la lutte contre les changements climatiques : le « problème de l’action collective ». Pour obtenir des résultats optimaux à l’échelle globale, une coopération internationale est nécessaire, mais les pays tendent à adopter des trajectoires qui peuvent paradoxalement aggraver la situation.
Par exemple, bien que l’abandon progressif des combustibles fossiles soit une exigence incontournable de la lutte contre les changements climatiques, des préoccupations économiques et énergétiques poussent certains pays à continuer, voire à intensifier, l’exploitation des combustibles fossiles, parfois en contradiction flagrante avec leurs engagements climatiques.
Cela se produit dans un contexte où les conséquences dramatiques des changements climatiques sont déjà visibles partout dans le monde, et où l’atténuation des effets du réchauffement semble devenir un défi de plus en plus difficile à relever. Malgré la gravité de la situation, il pourrait en réalité s’agir d’une occasion historique de renouveler et de remodeler les politiques climatiques. Deux actions essentielles s’imposent : reconnaître que l’approche de l’Accord de Paris a échoué, puis réorienter l’action vers la résilience et l’adaptation plutôt que l’atténuation seule.
Par exemple, au lieu de chercher à décarboniser les bâtiments à faible performance, comme nos politiques actuelles le permettent, voire l’encouragent, nous devons nous concentrer sur la conception et la construction de bâtiments à haute performance, garantissant la protection des occupants contre les effets des changements climatiques, tels que les vagues de chaleur ou les pannes d’électricité.
Les efforts d’atténuation actuels échouent
Malgré des décennies d’efforts, le monde est loin d’atteindre les objectifs de réduction des émissions fixés par l’Accord de Paris. Selon cet accord, le Canada s’était engagé à réduire ses émissions de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Or, en 2022, nos émissions n’avaient diminué que de 7,1 %. Depuis la baisse temporaire liée à la COVID-19, nos émissions ont en fait augmenté. La situation mondiale n’est guère plus encourageante : entre 2005 et 2021, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 24 %.
La première étape vers une politique climatique plus efficace consiste donc à reconnaître l’échec de l’Accord de Paris et des politiques nationales qui en découlent. Cela inclut les lacunes méthodologiques et conceptuelles de l’accord, ainsi que les insuffisances pratiques de sa mise en œuvre.
Cet aveu d’échec ne vise en aucun cas à minimiser les progrès accomplis, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables ou de l’électrification des transports et des bâtiments. Il s’agit simplement d’une évaluation réaliste de la situation en matière d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux objectifs fixés par l’accord.
La deuxième étape consiste à abandonner certaines ambitions d’atténuation devenues inaccessibles pour se préparer aux conséquences inévitables du changement climatique. Bien que les notions d’adaptation et de résilience fassent progressivement leur apparition dans le discours, elles sont rarement au cœur de la politique climatique et sont encore souvent envisagées uniquement pour des événements extrêmes, plutôt que comme réponse à un changement progressif mais certain (la « nouvelle normalité »).
Ces deux étapes seront difficiles, notamment en raison de la charge émotionnelle qu’elles pourraient susciter chez ceux qui sont engagés dans ces actions. Cependant, cette transition est à la fois nécessaire et réalisable.
Trois observations doivent guider ce changement de paradigme dans l’action climatique :
- D’ici 2050, les températures mondiales continueront d’augmenter d’au moins 1°C par rapport aux niveaux préindustriels, quelle que soit l’action que nous entreprenions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
- Même si le Canada cessait immédiatement toute émission de gaz à effet de serre, cela n’aurait quasiment aucun effet sur les émissions mondiales, et donc sur les changements climatiques.
- Le passage de l’atténuation à l’adaptation et à la résilience nécessitera un réexamen des priorités et une réallocation des ressources.
Les températures mondiales continueront d’augmenter
Il semble que rien ne puisse arrêter l’augmentation des températures mondiales au cours des 25 prochaines années. L’un des grands travaux réalisés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) consiste à établir des projections sur les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à partir de différents scénarios d’émissions. Curieusement, tous ces scénarios, malgré les marges d’erreur, conduisent aux mêmes conclusions : d’ici 2050, nous devrions connaître un réchauffement moyen d’au moins 1°C, ce qui pourrait atteindre 2°C au Canada.
Tous les scénarios ont essentiellement le même résultat jusqu’à 2050 environ et les trajectoires divergent rapidement par la suite, selon les scénarios d’émissions. Dès lors, il est légitime de se demander : comment nous préparons-nous à ce réchauffement, quasiment certain, qui affectera le Canada dans les 25 prochaines années ?
L’importance des actions du Canada : une question complexe
Les émissions du Canada représentent seulement 1,4 % des émissions mondiales en 2021. Il est donc évident que la réduction de cette part, si petite soit-elle, n’aura pas un impact suffisant sur les changements climatiques à l’échelle mondiale. Cependant, les émissions des pays à plus forte responsabilité augmentent rapidement, et le Canada peut difficilement influer sur cette tendance. Ce fait est largement reconnu depuis de nombreuses années, mais souvent ignoré sous prétexte de « montrer l’exemple » ou de responsabilité morale.
Cependant, la transition vers l’adaptation et la résilience semble offrir une solution, ou du moins une alternative, au problème de l’action collective. Si le Canada ne peut pas inverser ou ralentir les changements climatiques à l’échelle mondiale, il peut toutefois prendre des mesures pour se préparer à leurs effets. Ces actions peuvent être mises en œuvre à l’échelle régionale et communautaire, notamment dans le secteur de la construction, où les provinces et les municipalités ont le pouvoir de garantir des bâtiments résistants au climat.
Réaffecter les ressources pour une action plus efficace
L’un des principaux défis de l’action climatique est la gestion des ressources limitées, qu’il s’agisse de temps ou d’argent. Depuis des décennies, la communauté climatique se bat pour obtenir des financements et des ressources, qui restent insuffisants au regard de l’ampleur du problème. Le changement de paradigme proposé peut toutefois s’appuyer sur de nombreuses initiatives déjà en cours, comme la diversification des sources d’énergie, le stockage de l’énergie, et l’électrification des transports. Toutefois, cette transition vers l’adaptation et la résilience nécessitera un investissement en ressources, au détriment des objectifs d’atténuation actuels.
Une nouvelle approche qui abandonnerait des objectifs peu réalisables permettrait de libérer des ressources précieuses et de se concentrer sur l’essentiel. Elle permettrait aussi de mobiliser une autre ressource essentielle : l’énergie et la passion d’une génération jeune et désillusionnée. Reconnaître cette frustration et lui donner une place légitime dans le processus, plutôt que de multiplier les promesses irréalistes, comme l’a souligné Greta Thunberg avec son fameux « bla-bla-bla », serait un premier pas vers la réconciliation et la mobilisation en faveur de l’action climatique. Il est essentiel de ne pas aliéner ceux qui devront prendre en main l’avenir climatique.