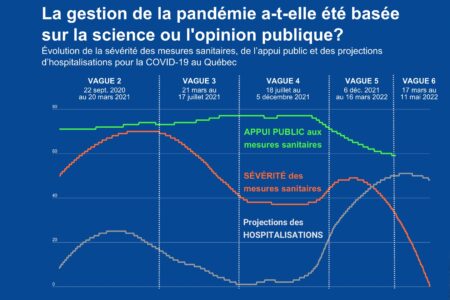Durant l’été de 1999, j’ai lu le livre The Hot Zone, un thriller de Richard Preston qui raconte les origines du virus Ebola. À l’époque, j’avais commencé à travailler sur une étude clinique pour la prévention du VIH et à m’intéresser à la recherche en prévention des maladies infectieuses. Non seulement l’auteur prédisait d’autres épidémies d’Ebola pour le futur, mais sa description laissait présager qu’un jour un nouveau virus émergerait avec des caractéristiques et dans des conditions optimales pour provoquer une épidémie causant plus de morts que la pandémie d’influenza de 1918-1919, la fameuse « grippe espagnole » (50 millions de décès). Un tiers de la population mondiale, soit 500 millions de personnes, avait été infectée durant cette pandémie. Même aujourd’hui, bien des questions concernant l’évolution de la pathogénicité de ce virus restent sans réponse.
On peut croire que les progrès de la médecine et les réponses concertées et rapides des autorités locales, avec l’aide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), nous protégeront d’une épidémie de cette ampleur. Toutefois, le progrès vient avec son lot d’inconvénients : il crée des conditions favorables à la propagation d’un virus. Non seulement la densité de la population sur la planète a augmenté, mais les virus voyagent beaucoup plus rapidement d’une région à l’autre. De plus, la planète se réchauffe, créant un milieu potentiellement plus clément pour les virus. Présentement, on estime qu’il y a des cas d’infection au COVID-19 dans plus de 25 pays et que plus de 200 000 personnes en sont atteintes dans la seule province de Hubei en Chine. Or, l’épidémie a débuté il y a quelques mois à peine.
Les conditions optimales pour les virus sont une transmission par voie aérienne, de nombreuses infections asymptomatiques et une longue période d’incubation. De plus, un virus « idéal » survit longtemps sur une surface inanimée (un banc ou une table) et entraîne un taux de décès élevé. Outre ces caractéristiques, la propagation peut être favorisée par des facteurs sociaux et géographiques. Par exemple, la réponse des autorités locales et de l’OMS se matérialiserait difficilement si le foyer initial de l’épidémie se trouvait dans une région aux prises avec des conflits importants et à la frontière de plusieurs pays (ce fut le cas pour l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo).
Le « Big One » des épidémies
Un matin de décembre 2019, j’apprends qu’un nouveau virus est potentiellement en émergence en Chine. La crainte d’un nouveau virus est comparable à celle des Californiens lorsque la terre commence à trembler : est-ce le début du « Big One », le très grand séisme qu’on prédit depuis longtemps dans cette région ? Au début d’un séisme, il n’est pas possible de déterminer la magnitude qu’il atteindra. De la même manière, on ne peut prédire avant quelques semaines ou mois l’ampleur que prendra une épidémie émergente, ses caractéristiques et son potentiel de causer un grand nombre de décès.
La réponse de la Chine et de l’OMS au COVID-19 a été rapide, ce qui est crucial pour limiter la propagation. L’OMS mobilise présentement des experts et des scientifiques pour contrôler l’épidémie, traiter les personnes infectées, développer des vaccins et des antiviraux, et mettre en œuvre d’autres moyens de prévention. Plusieurs scientifiques canadiens contribuent d’ailleurs à cette mobilisation. Pour les épidémies comme le SRAS et le COVID-19, nous avons rapidement pu identifier le virus responsable, ce qui nous donnait une longueur d’avance. Toutefois, un vaccin efficace contre le COVID-19 est une solution à long terme ; dans le meilleur des cas, il ne sera pas disponible avant 5 à 10 ans, même si plusieurs vaccins expérimentaux seront évalués d’ici 12 à 18 mois.
Comprendre le facteur humain
Il est encore trop tôt pour déterminer si le COVID-19 disparaîtra comme le SRAS ou s’il est là pour rester et devenir endémique comme l’influenza annuelle. Somme toute, la réponse à l’émergence du COVID-19 est, à ce stade-ci, adéquate, mais elle est axée uniquement sur les aspects cliniques, scientifiques et préventifs. Il manque l’élément sociétal.
On ne semble pas avoir appris des quelques ratés des réponses passées pour d’autres épidémies. Par exemple, les réponses initiales de l’OMS lors des épidémies d’Ebola au Gabon et en République démocratique du Congo en 2001-2001 et en Guinée-Conakry en 2014 avaient été reçues avec défiance et réticence par les populations. L’OMS tentait de proscrire certains soins aux malades et des rites funéraires pratiqués en Afrique de l’Ouest qui impliquent une grande proximité corporelle, car ils augmentaient considérablement le risque de transmission du virus. Lorsque les interventions se butent à la culture, c’est la culture qui prédomine. Sociologues et anthropologues ont alors été appelés en renfort pour élaborer une approche anthropologique en vue de contrer l’attitude de la population. Or, dans la frénésie d’une épidémie en émergence, il est difficile de mettre au point de telles approches.
Dans le cas du COVID-19, les mesures de confinement et la quarantaine sont certes des moyens efficaces pour contenir la propagation, mais encore faut-il qu’elles ne suscitent pas la défiance de la population. Initialement, les gens acceptent bien ces mesures, mais elles risquent de ne plus être respectées lorsqu’elles se prolongent.
La réponse par le confinement est adéquate au sens qu’elle respecte le plus possible les droits et libertés individuels et tente de limiter les dommages à l’économie. Mais ces décisions sont excessivement difficiles pour les autorités. La réponse ne doit pas être trop forte (afin d’éviter de provoquer un mécontentement collectif), ni trop faible (afin de rester efficace). Par exemple, combien de décès sommes-nous prêts à tolérer pour éviter une récession mondiale ? L’épidémie d’influenza annuelle est acceptée par la population ; elle cause des centaines de décès, mais toutes les activités se poursuivent. La collectivité consent à ce risque tout comme les autorités, qui ne se croisent pas les bras et essaient d’augmenter la vaccination.
Assurément, on peut stopper la propagation de toute épidémie beaucoup plus rapidement si on ne se préoccupe pas trop des droits et libertés individuels ni des dommages économiques.
La quarantaine, dans le cas du COVID-19, a été bien acceptée par les voyageurs arrivant dans leur pays de résidence après avoir séjourné dans des régions qui comptent un nombre élevé de personnes contaminées. Mais lorsque les autorités japonaises ont choisi la manière forte et mis en quarantaine les passagers d’un bateau de croisière, ils ont augmenté non seulement le risque d’infection de ces personnes, mais aussi leur risque de décès. La quarantaine repose sur le principe que ce qui est bon pour l’individu n’est pas nécessairement bon pour la collectivité.
Vers une approche collectivité partenaire
L’appui des collectivités est essentiel dans le contrôle d’une épidémie. Dans les grandes études cliniques pour la prévention du VIH auxquelles j’ai participé, nous avons commencé à intégrer les membres des communautés dès la conception de l’étude, et non seulement lorsque les protocoles ont été approuvés. Nous nous étions aperçus que l’acceptation par la communauté était un élément clé du succès d’une intervention. Cette intégration ressemble à l’approche du patient partenaire, élaborée durant la dernière décennie, où les médecins tiennent compte de l’expérience des patients et l’intègrent dans leur approche de traitement. C’est ce modèle qui devrait prévaloir dans la lutte contre une épidémie.
Dès le départ, la population doit avoir accès à de l’information valide et digne de confiance. Cela pose un énorme défi, car on contrôle difficilement l’information qui circule dans les médias, et encore moins celle des médias sociaux. Le directeur général de l’OMS a déclaré il y a quelques jours qu’on doit non seulement combattre une épidémie, mais également une infodémie. Déjà, plusieurs incidents de stigmatisation visant certains segments de la population ont été observés au Canada et à travers le monde.
Il est donc souhaitable que les plans d’urgence pour le contrôle d’une épidémie en émergence incluent ses aspects sociétaux. À ma connaissance, ce n’est malheureusement pas le cas. Par exemple, le Plan d’urgence québécois sur les maladies infectieuses à surveillance extrême : volet santé publique est centré sur les aspects logistiques et les communications initiales. Il ne contient aucune information pour contrer la réticence et la défiance de la population à l’égard des mesures entreprises par les autorités de santé publique, ni pour combattre des informations potentiellement erronées et incorrectes circulant dans les médias. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a bel et bien mis des renseignements détaillés sur l’épidémie de COVID-19 sur son site Web, et l’OMS fournit de son côté un excellent tableau de bord avec des rapports journaliers sur le virus, mais cela est loin d’être suffisant.
Il faut travailler sur les aspects sociétaux d’une épidémie en amont, avant son émergence et non en situation d’urgence. L’importance de ces aspects est reconnue par les autorités de santé publique et l’OMS. Pour le COVID-19, les Instituts de recherche en santé du Canada ont lancé un programme de financement pour une intervention de recherche rapide qui contient deux domaines de recherche de contre-mesures : médicales et sociales. C’est un bon point de départ. Les recherches sociales devraient notamment comprendre des études sur la réaction de la population à une épidémie, des stratégies pour lutter contre la désinformation et la stigmatisation, des répercussions économiques et des interventions de santé publique. Mais un financement maximal de 6,75 millions de dollars pour les deux domaines est nettement insuffisant si on considère qu’un seul essai clinique pour évaluer l’efficacité d’un vaccin exigera des fonds de plusieurs dizaines de millions de dollars.
L’élaboration d’une approche collectivité partenaire pour le contrôle des épidémies émergentes est essentielle. Il est difficile de prédire la suite pour l’épidémie de COVID-19, mais de nouveaux virus émergeront assurément dans l’avenir. Le talon d’Achille des réponses actuelles sont les aspects sociétaux d’une épidémie, incluant les impacts économiques. Si les mesures entreprises pour endiguer l’éclosion d’une épidémie ne sont pas acceptées par la population, la propagation deviendra hors de contrôle et aura des conséquences désastreuses. La solution passe incontournablement par un meilleur arrimage entre l’intervention de santé publique et les collectivités.
Photo : Shutterstock / atiger
Souhaitez-vous réagir à cet article ? Joignez-vous aux débats d’Options politiques et soumettez-nous votre texte en suivant ces directives. | Do you have something to say about the article you just read? Be part of the Policy Options discussion, and send in your own submission. Here is a link on how to do it.