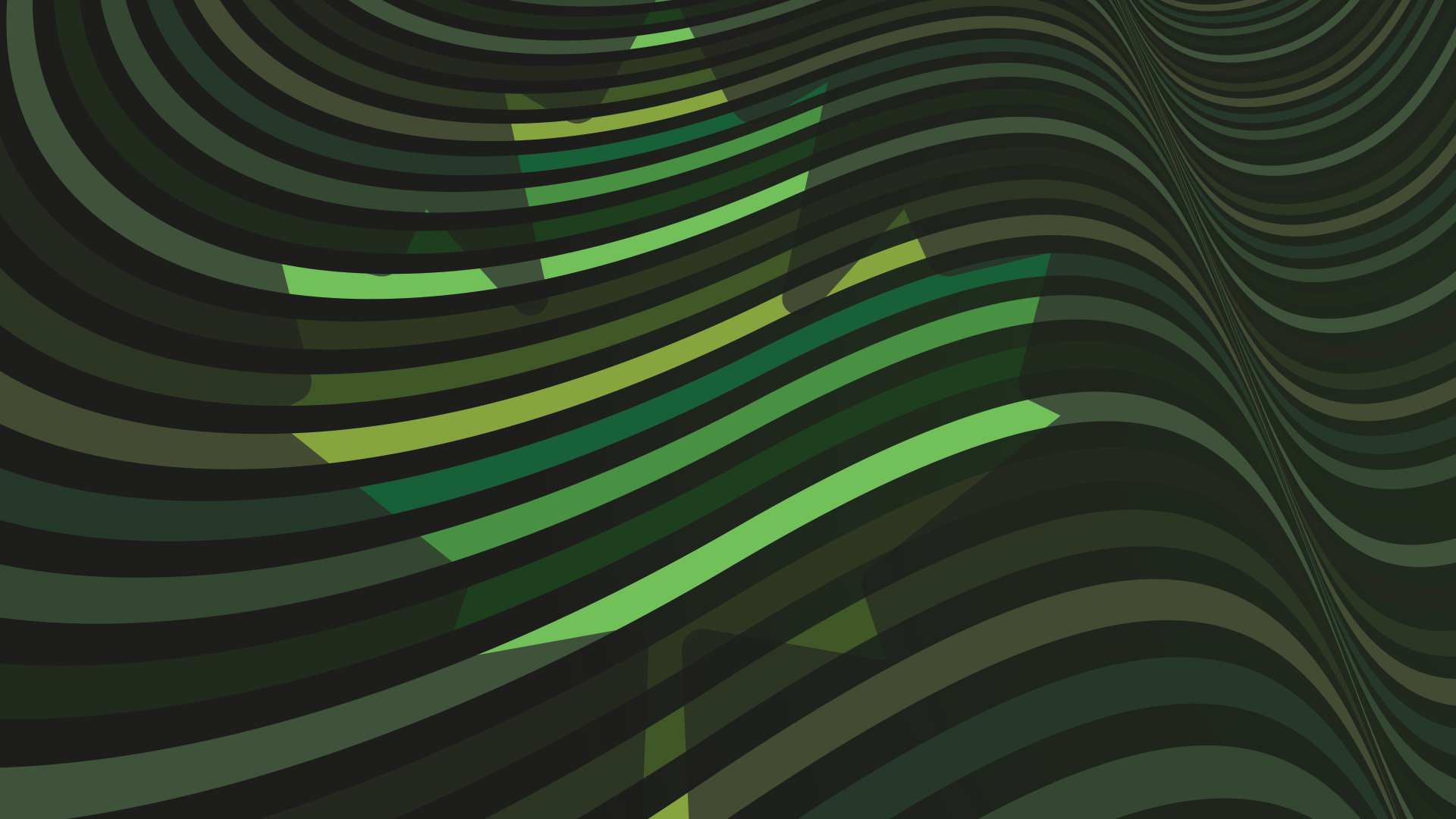
-
Balados 160

Plus de dix ans ont passé depuis que j’ai mis le pied pour la première fois à Kandahar, en Afghanistan. Mon deuxième et dernier séjour là-bas marqua la fin de la présence du Canada dans cette province et le début de notre mission d’entraînement à Kaboul, qui s’est terminée en 2014.
Je suis arrivé en Amérique du Nord en tant que réfugié de la guerre du Vietnam. J’ai grandi en entendant les histoires de mes parents sur la chute de Saigon et la misère des boat people. Cet héritage m’a poussé à me joindre à la Réserve des Forces canadiennes après l’obtention de mon doctorat en médecine dentaire, à la fin de ma résidence, en 1999. J’ai reçu une commission en tant qu’officier d’infanterie pour relever le défi de mener des soldats au combat et je me suis éventuellement retrouvé dans le 4e Bataillon du Royal 22e Régiment.

Mon séjour en Afghanistan m’a donné un aperçu des défis opérationnels de la mission militaire que les décideurs d’Ottawa avaient confiée à nos forces armées. J’en suis venu à remettre en question la possibilité que cette mission nous permette d’atteindre nos objectifs en matière de politique étrangère.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Le Canada est intervenu pour la première fois en Afghanistan en octobre 2001 dans le cadre de l’opération Apollo, en envoyant des forces spéciales et un bataillon au combat et en les retirant une fois que le terrain fut pris. En 2003, le Canada est revenu à Kaboul dans le cadre de l’opération Athena pour ensuite déménager dans la province de Kandahar, que les talibans considèrent comme le berceau de leur mouvement.

Alors que la violence augmentait à Kandahar et dans la province voisine de Helmand – culminant avec les combats de 2006 et l’opération Medusa –, le Canada semblait prêt à maintenir ses efforts. En mars 2006, le célèbre discours du premier ministre Stephen Harper, dans lequel il affirmait sa volonté de maintenir l’engagement canadien (« Canada won’t “cut and run” as long as [I am] in charge », disait-il), m’avait convaincu que nous maintiendrions le cap coûte que coûte.
L’année suivante, j’ai pris un congé sabbatique de la clinique dentaire où je pratiquais pour entreprendre mon premier tour de 10 mois au sein de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan. J’ai passé la majeure partie de ce séjour en tant qu’officier de service aux opérations courantes. Nous étions chargés de suivre et de coordonner toutes nos forces présentes à Kandahar, de gérer chaque événement et de faire face aux conséquences de chaque explosion d’engin improvisé. Notre rotation avait la particularité d’être la première formation à utiliser des outils numériques, mais aussi de communiquer en anglais avec nos alliés et en français avec nos propres unités sur le terrain.

En avril 2008, j’ai dû être dépêché pour commander une équipe de mentorat de la Police nationale afghane, après que trois de ses membres aient été blessés au début de la saison des combats. Cette période revenait de manière cyclique, d’avril à octobre, quand les talibans sortaient de leurs quartiers d’hiver au Pakistan et montaient en Afghanistan pour récolter du pavot et combattre les forces afghanes. Notre équipe participa à des opérations dans le district de Zharey, à l’ouest de la ville de Kandahar, échangeant parfois des tirs avec un ennemi furtif qui se tenait à distance avant de se fondre dans le paysage. Cela nous laissait peu de temps pour offrir un véritable mentorat comme nous l’aurions voulu. Au cours de l’une de ces opérations avec des soldats afghans qui avaient des Canadiens pour mentors, un bâtiment tenu par des insurgés fut détruit par une bombe de 500 livres. Ce moment a été immortalisé par un journaliste du Christian Science Monitor.
Après mon retour au Canada et à mon quotidien comme dentiste pendant un peu plus d’un an, je me suis porté volontaire pour retourner là-bas en 2010, en tant que mentor des opérations pour un bataillon de l’Armée nationale afghane (ANA). Cette année-là, un imposant renfort de troupes américaines (le « surge » d’Obama entamé l’année précédente) avait inondé Kandahar de milliers de soldats. L’avant-poste que j’avais défendu en 2008 avec six Canadiens et huit Afghans abritait maintenant plus d’une centaine de soldats américains. J’ai découvert un endroit beaucoup moins violent, un endroit qui avait prospéré durant les années qui avaient suivi mon premier tour grâce aux progrès durement acquis par les rotations militaires précédentes.

La mission
En 2011, lorsque nous avions cédé notre zone d’opérations à Kandahar aux forces américaines, nous étions convaincus d’avoir accompli la mission qui nous avait été confiée, après des années de contre-insurrection qui avaient réduit la violence et renforcé les forces de sécurité.
Notre mission visait à accomplir ce qui suit :
Il y avait souvent un conflit inhérent et inévitable entre assurer la sécurité d’une zone en menant des opérations de la manière la plus efficace possible et développer les compétences opérationnelles des Afghans en les laissant prendre les devants. En effet, il était prévu que les ANDSF prennent en charge la sécurité du pays après le départ des troupes étrangères. Au début de notre déploiement à Kandahar, il fallait utiliser toute la puissance de feu et le sens tactique à notre disposition pour gagner des batailles intenses et reprendre du terrain stratégique des mains des insurgés. Non seulement il fallait gagner, mais il fallait y arriver sans essuyer de pertes canadiennes. La mort d’un soldat, d’un matelot ou d’un aviateur canadien, qui constituait déjà une tragédie, faisait toujours la une des journaux le lendemain, éclipsant tout le succès d’une opération aux yeux de la population canadienne. Nous visions rien de moins qu’un blanchissage.
Vers la fin de notre mission à Kandahar, en novembre 2011, les mois d’hiver étaient devenus plus calmes. Grâce à nos gains en matière de sécurité et à l’augmentation des effectifs américains, les forces afghanes pouvaient mener des opérations plus complexes. Les ANDSF ont pu prendre les devants et la brigade a pu mener des opérations impliquant des milliers de soldats. Il était parfois difficile de ne pas succomber à la tentation de façonner les opérations au goût des officiers canadiens, mais les progrès réalisés par l’ANA étaient évidents et mesurables vers la fin de notre mission.
La mission afghane a également mis en évidence l’importance de la sensibilisation culturelle, de l’empathie et de la valeur ajoutée qu’apporte la diversité dans une organisation. La majeure partie de notre montée en puissance s’était concentrée sur l’aspect le plus difficile de la mission : les compétences militaires et opérationnelles qui nous permettraient de gagner le combat. Cela nous laissait peu de temps pour familiariser les soldats canadiens à la culture afghane. La plupart des troupes déployées n’avaient pas une connaissance approfondie des complexités du pays et parfois même des différentes ethnies (Pachtounes, Hazaras, etc.). Pire encore, de nombreux Canadiens étaient manifestement mal à l’aise d’interagir avec les Afghans. Une formation obligatoire sur la diversité avait été offerte quelques années auparavant, mais elle était parfois tournée en dérision par les troupes lorsqu’elles estimaient que leurs propres officiers n’y accordaient pas d’importance. Sans surprise, ce sont les équipes dont les leaders avaient à cœur les relations avec leurs partenaires des ANDSF et les dirigeants locaux qui ont obtenu les meilleurs résultats sur le terrain.
La réalité du terrain avait beaucoup d’autres leçons à offrir, et c’est tout à l’honneur des Forces armées canadiennes de les avoir diffusées et appliquées si rapidement d’une rotation à l’autre. L’expérience acquise par les vétérans de cette guerre et l’équipement qui a été acheté rapidement pour combler nos lacunes initiales ont grandement amélioré notre capacité à survivre et à gagner sur le champ de bataille tout au long de notre mission à Kandahar. Grâce à la capacité d’apprentissage et de croissance de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan, le Canada était le seul pays qui a eu sous son commandement plusieurs bataillons américains comptant des centaines de soldats jusqu’à la fin de la mission à Kandahar. La crédibilité et les compétences durement acquises du Canada se maintiennent aujourd’hui, alors qu’il dirige un groupe tactique multinational en Lettonie face aux forces russes et qu’il met encore à profit son expérience dans la formation et l’encadrement de soldats irakiens et ukrainiens.
Les accomplissements du Canada
Au final, même si la mission du Canada à Kandahar ou à Kaboul avait été plus fructueuse, il est difficile d’imaginer que le conflit se règle autrement que par la prise de pouvoir des talibans. Atteindre nos objectifs ne suffisait pas pour gagner la guerre.
Avant notre déploiement en 2010, le ministre de la Défense nationale nous avait rassemblés pour nous parler de l’importance de notre mission. Dans son discours, il admettait qu’il était difficile de prédire ce que l’avenir réserverait à l’Afghanistan. J’avais été frappé et même choqué par une telle affirmation. Je ne comprenais pas comment on pouvait demander à des gens de risquer leur vie sans laisser entrevoir que leurs efforts puissent être couronnés de succès. J’ai réalisé plus tard la dure réalité que cachait cette déclaration : même s’il occupait un rôle de premier plan dans une des provinces clés du pays, le Canada n’était qu’un pays parmi tant d’autres opérant sous l’égide des États-Unis en Afghanistan. Au final, l’avenir de l’Afghanistan reposait sur les dirigeants afghans et sur leurs relations avec leur principal protecteur : les États-Unis.
La somme de tous ces sacrifices
Aujourd’hui, nous nous demandons si nos sacrifices n’ont pas été vains. On peut bien sûr avancer que mourir pour son pays est honorable en soi, peu importe l’issue d’un conflit. Mais nous sommes nombreux à vouloir donner plus de sens à cette intervention. Les plus amers d’entre nous se consolent d’avoir fait de leur mieux, maudissant parfois au passage – bien injustement – les soldats afghans qui n’ont pas réussi à défendre leur propre patrie. Beaucoup d’autres ont tourné la page dès qu’ils ont quitté l’Afghanistan. Pour eux, leur tour n’était qu’un tremplin dans leur carrière.
Comme je n’avais aucune ambition de gravir les échelons militaires et que je m’étais porté volontaire pour des raisons humanitaires, j’ai toujours été exaspéré de voir que certains pouvaient risquer leur vie pour reconstruire un pays tout en étant complètement indifférents quant à son avenir. J’espérais que les années que j’avais sacrifiées – des années où j’aurais pu gagner beaucoup plus en tant que dentiste – auraient contribué à construire un pays capable d’assurer sa défense et d’améliorer la qualité de vie de son peuple extraordinaire, fort de sa grande diversité ethnique. Pour de nombreux anciens combattants, satisfaire aux exigences de la mission canadienne était suffisant. Pour moi, gagner la guerre était plus important. Nous étions nombreux à ressentir la rupture entre la mission menée sur le terrain et les objectifs politiques canadiens, avoués ou non au public, qui soutenaient cette mission. Si l’objectif était simplement de remplir nos obligations envers l’OTAN et de devenir un membre crédible de cette alliance, on pourrait certainement se mettre d’accord avec de nombreux experts et dire « mission accomplie ». Par contre, s’il s’agissait d’éviter que l’Afghanistan ne devienne un refuge de terroristes, les événements récents compromettent grandement l’atteinte de ce but.
Après la chute de Kaboul et le retour au pouvoir des talibans, une grande partie de ce que le Canada présentait comme l’héritage de sa mission s’est envolé en peu de temps. Les routes que nous avons construites et la plupart des projets de développement continueront de profiter aux Afghans, mais, sauf dans la province du Panchir, au nord de Kaboul, les forces de sécurité et la gouvernance que nous avons soutenues ont été vaincues. Ma seule certitude, c’est que 20 ans de présence étrangère ont exposé les Afghans à une abondance d’informations et à une diversité médiatique qui a changé leur société à tout jamais. C’est un pays qui est passé de zéro à 18 millions d’abonnés aux services de téléphonie cellulaire, avec des tarifs et une réception meilleurs qu’en bien des endroits au Canada. C’est une région du monde où j’ai pu passer de nombreux après-midi avec mes frères d’armes afghans à regarder des films traduits comme Waterworld, des dessins animés X-Men, des drames pakistanais et indiens, et même la version afghane du Banquier. On estime qu’aujourd’hui, 60 % des Afghans ont moins de 25 ans. Ces jeunes ont grandi immergés dans cette mer d’informations qui leur a fait prendre conscience des diverses ethnies et cultures de leur propre pays et qui a fait naître chez eux un sentiment de fierté nationale. On ne peut qu’espérer que cela permettra à la société civile d’éventuellement triompher de l’obscurantisme.
Ce que le Canada peut encore accomplir
Au moment d’écrire ces lignes, le Canada n’a pas reconnu le gouvernement taliban et Justin Trudeau a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de le faire. Or, nous aurons du mal à soutenir les résistants dans la vallée du Panchir sans la participation d’autres nations.
Il a fallu mettre fin à notre mission à l’aéroport de Kaboul après avoir évacué 3 700 personnes. Des milliers d’Afghans vulnérables sont restés derrière, dont des interprètes qui avaient travaillé pour nous. À court et à moyen terme, nous pouvons tout à fait continuer à accepter un certain nombre d’Afghans vulnérables qui parviendront à nous demander l’asile à partir d’un pays tiers. En même temps, nous pourrions exercer des pressions sur les talibans de concert avec la communauté internationale pour influencer leur gouvernance et les inciter à respecter les droits humains. Des milliards de fonds sont bloqués par la Banque mondiale et les talibans manquent déjà d’argent pour gouverner.
Nous sommes nombreux à travailler pour extraire du pays nos anciens interprètes, qui ont couru autant, voire plus de risques que nous. Souvent, les menaces n’étaient pas seulement dirigées contre eux, mais contre toute leur famille. Nous n’aurions jamais pu accomplir notre travail sans leur participation, leur compétence et leur courage. Au début, lorsque les interprètes se sont inscrits, nous leur avions promis qu’ils pourraient émigrer au Canada s’ils pouvaient prouver qu’ils étaient en danger et qu’ils avaient accumulé 12 mois de service avec nous. Malheureusement, beaucoup de nos interprètes n’ont pas passé suffisamment de temps avec nous, mais les talibans n’attendent pas que vous ayez cumulé 12 mois de service auprès de l’ennemi pour vous juger comme un traître. La politique canadienne avait peut-être du sens en 2011, lorsqu’elle avait incité les interprètes à travailler pour d’autres contingents nationaux encore présents en Afghanistan, mais plus maintenant.
Je ne peux pas non plus m’empêcher de penser aux soldats et aux officiers afghans que j’ai eu l’honneur d’encadrer lors de mon deuxième séjour. Dans de trop nombreux cas, ils étaient affectés à des unités loin de leurs familles, qu’ils n’avaient pas vues depuis près d’un an. Durant leurs congés, ils devaient ranger leur uniforme et voyager incognito par autobus sur des routes infestées de talibans pour pouvoir apporter de l’argent à leurs proches. Ces soldats afghans voyaient débarquer des rotations successives de troupes canadiennes fraîches et motivées, prêtes à en découdre, qui prenaient souvent les Afghans à partie quand ils ne faisaient pas preuve d’assez d’ardeur au combat à leur goût. Le 16 août 2021, le président américain Joe Biden a vilipendé les forces afghanes, déclarant : « Les Américains ne devraient pas mourir dans une guerre que les Afghans ne sont pas prêts à mener ». C’est ignorer les milliers d’Afghans tués au combat année après année, en nombre croissant à mesure qu’avançait le retrait des troupes américaines. En 2018, de 40 à 60 soldats et policiers afghans mouraient chaque jour. Les bilans des victimes étaient tels qu’ils n’ont plus été rendus publics après cette année-là.
Les raisons de la contre-performance de l’ANA sont trop complexes pour être réduites à une simple question de bravoure. De nombreux articles et livres seront écrits dans les prochaines années pour expliquer cet effondrement. Quant aux unités de sécurité à Kandahar dans lesquelles nous avons tant investi, elles ont livré pendant des semaines des combats qui, depuis Panjwai, le 3 juillet dernier, ont vu tomber les districts les uns après les autres. À la mi-juillet, les forces afghanes ont même tenté de contre-attaquer et de reprendre le poste frontalier avec le Pakistan dans la ville de Spin Boldak. Vers le mois d’août, un groupe de policiers de Kandahar a été réduit à manger des pommes de terre gluantes pour pouvoir continuer à se battre.
En regardant l’évacuation à Kaboul, je me suis souvenu des histoires que mes parents m’ont racontées sur la chute de Saigon. Mon grand-père avait été juge militaire et avait condamné beaucoup de communistes. Ma mère, pharmacienne, craignait que les représailles contre le gouvernement et les familles des militaires n’entraînent un bain de sang. Par mesure de prévention, elle s’était procuré du cyanure.
Pour me secourir, mes parents ont d’abord essayé de me mettre sur un vol d’orphelins avec l’opération Babylift, sachant qu’ils ne me reverraient plus jamais. Je pense souvent à quel point il faut être au comble du désespoir quand le seul moyen de donner une vie meilleure à son enfant consiste à l’abandonner à jamais. En fin de compte, j’ai eu la chance de ne pas me retrouver sur ce vol, car l’avion s’est écrasé, entraînant plusieurs enfants dans la mort.

Une semaine avant la chute de Saigon, ma tante Kim Oanh et son mari américain, mon oncle Mike Cook, ont pu faire venir un employé de l’ambassade pour nous évacuer vers l’aéroport en pleine nuit sans alerter nos voisins. Dans The Vietnamese Mayflowers, mon père a écrit à propos des sentiments de honte et de perte totale qu’il a ressentis lorsqu’il a vu le mot « apatride » estampé sur son formulaire d’immigration. Le Sud-Vietnam n’existait plus. Le pays dans lequel il avait grandi et pour lequel il s’était battu était désormais rayé de la carte. Heureusement, grâce à ses études de médecine effectuées en français, il a pu refaire son internat et sa résidence au Québec et y refaire sa vie. Le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord qui a reconnu les diplômes de mes parents et ceux de milliers d’autres Vietnamiens qui s’y sont installés. Aujourd’hui, le Canada est notre chez-nous et sera la patrie de nos descendants.
Le satiriste Will Ferguson décrit le Canada comme le pays de la seconde chance. Il ne faut pas refuser cette chance aux nombreux Afghans vulnérables qui ont risqué leur vie pour bâtir leur pays. Le Canada doit aussi être l’un des pays qui aideront les Afghans restés là-bas à obtenir une deuxième chance de reconstruire leur pays. À cet égard, les prochaines années seront déterminantes.
Le téléchargement est gratuit. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez des tweets à @IRPP