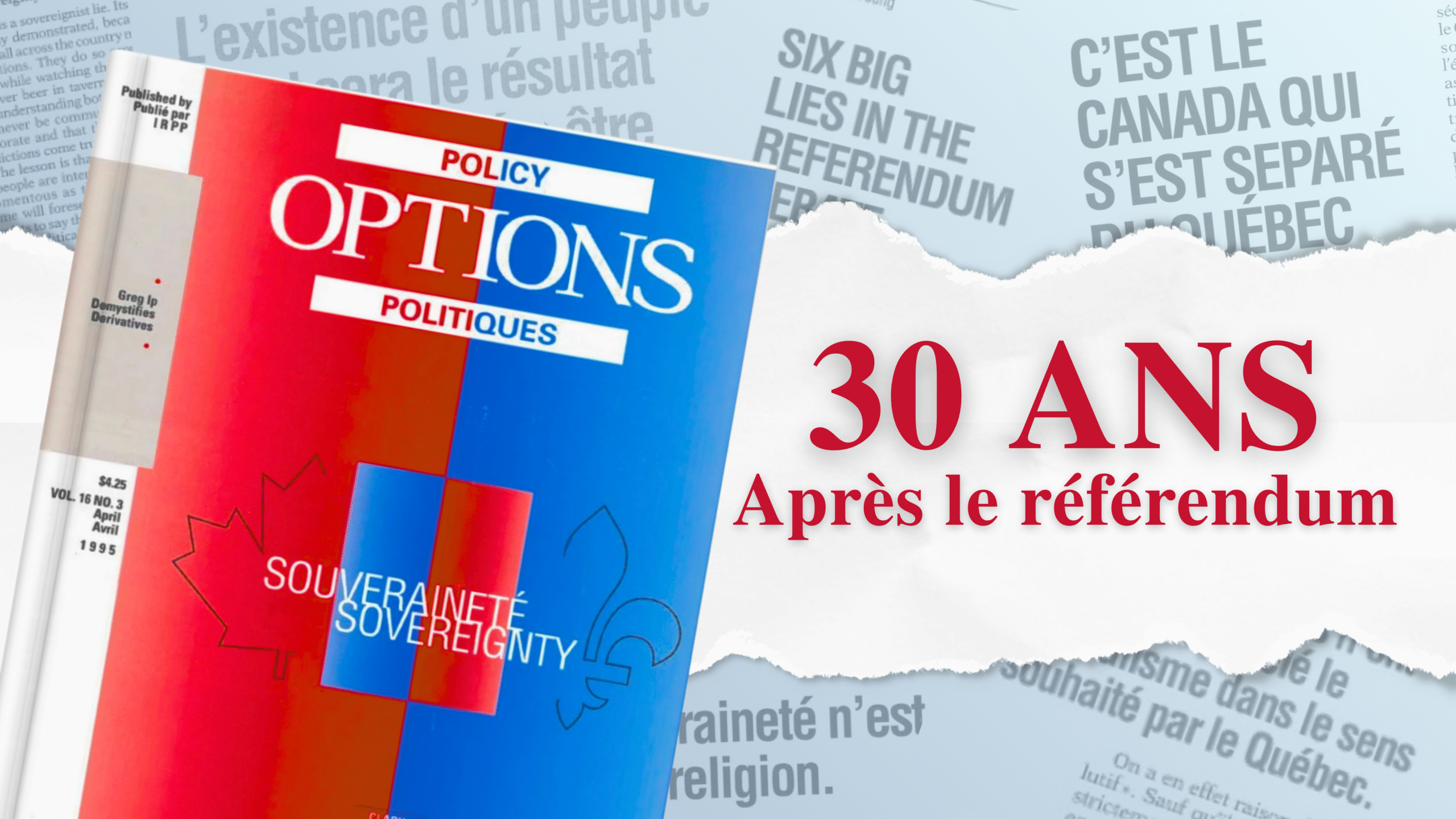Printemps 1995. À quelques mois d’un référendum historique, Options politiques consacrait un numéro spécial sur la souveraineté. La question nationale occupait alors toutes les conversations.
Puis, le 30 octobre, alors que le pays retenait son souffle, le verdict est tombé : le camp du non l’a emporté, par une mince majorité. Le pays ne s’est pas brisé, mais il en est ressorti ébranlé. Tout était à repenser : l’avenir des relations entre le Québec et le reste du Canada et celui de la fédération dans son ensemble.
« Il n’y a pas de divergences insurmontables au Canada », avait justement écrit l’ancien premier ministre Joe Clark dans nos pages. « Après tout, il n’y a pas que les Québécois qui trouvent le statu quo inacceptable. »
Cette phrase résonne encore trente ans plus tard. Comme quoi la question de l’unité nationale n’est pas un vieux débat rangé sur une tablette. Elle s’est transformée, nourrie par de nouvelles tensions et portée par des voix plus diversifiées qu’avant.
Le Québec rediscute souveraineté. L’Alberta revendique davantage d’autonomie. Les relations avec les États-Unis influencent les débats sur le nationalisme. Et pendant ce temps, les communautés LGBTQ+ et autochtones redéfinissent aussi ce que signifie appartenir à la fédération.
Dans ce dossier, Options politiques revisite la question de l’unité nationale non pas pour ressasser le passé, mais pour comprendre comment, trente ans après le référendum, le pays continue d’évoluer.
Bonne lecture!
Le « facteur États-Unis » dans le débat sur l’indépendance du Québec
LGBTQ+ et nationalisme : le déclin d’une alliance progressiste au Québec