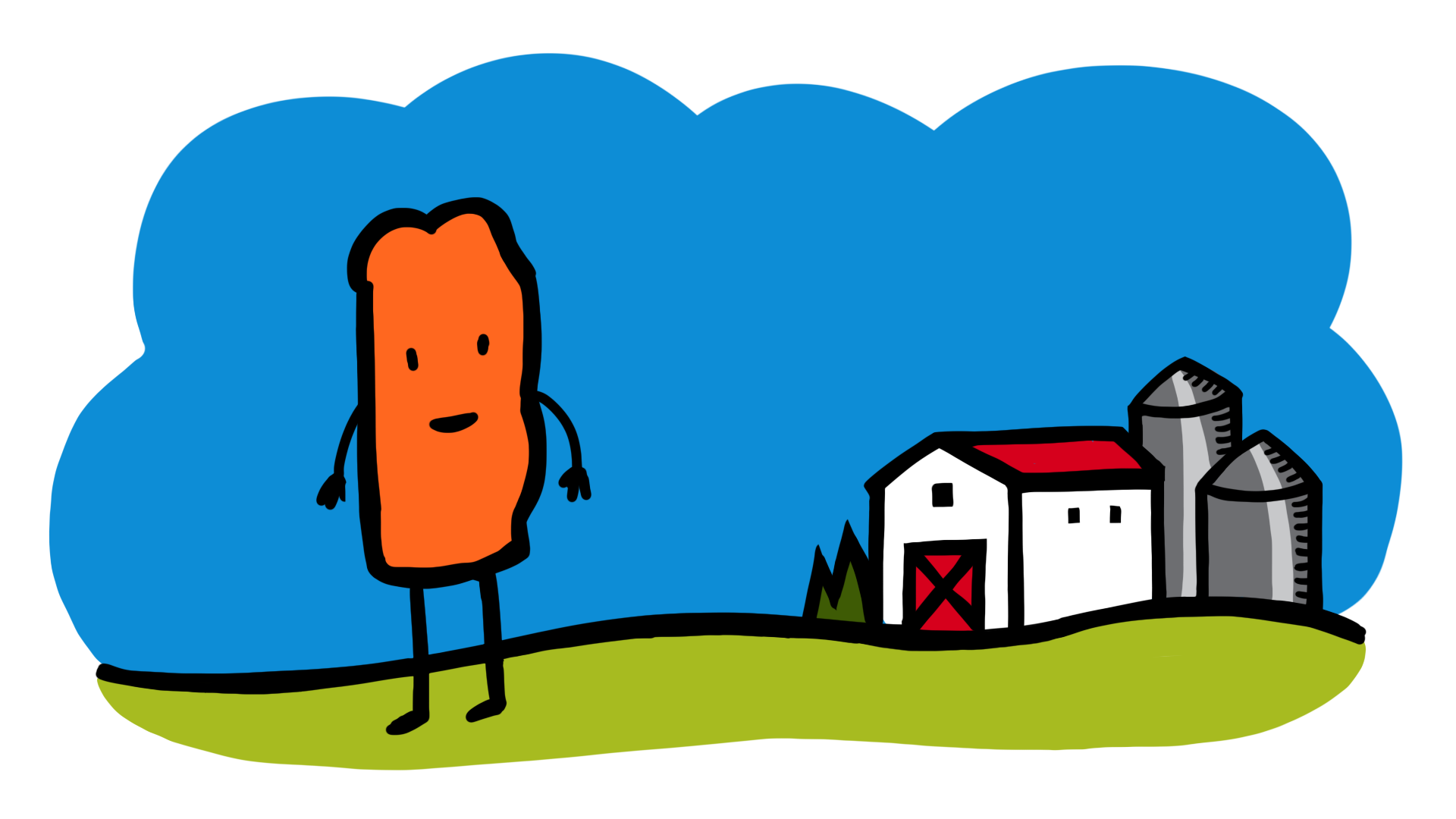(English version available here.)
J. R. a grandi sur une ferme d’élevage au sud de l’Alberta. Malgré ses nombreuses responsabilités sur la ferme, elle était première de classe au secondaire.
Elle savait ce qu’elle voulait faire plus tard : devenir médecin.
Malheureusement, un obstacle important l’attendait. Son école rurale ne proposait pas les cours préalables nécessaires pour entrer en médecine.
J. R. était déterminée à réaliser son rêve. Cependant, lorsqu’elle a soumis sa candidature, toutes ses années d’expérience concrète à aider les vaches à mettre à bas et à gérer les urgences sur la ferme ont été ignorées : ce n’était pas suffisant pour qu’elle soit admise à un stage estival de recherche dans un laboratoire.
La source du problème? Les universités ne sont pas conçues pour comprendre et traduire dans les faits les besoins d’une communauté diversifiée. Les réalités des communautés rurales, comme bien d’autres, passent sous leur radar.
Repenser le rôle des universités
Les enjeux sociétaux complexes nécessitent la participation de tous.
Le modèle universitaire traditionnel a apporté des avantages inestimables au fil des siècles, et a notamment donné naissance aux percées les plus influentes de l’humanité sur le plan social et scientifique. Mais ce sont les élites politiques et savantes qui tiennent la barre plutôt que la collectivité.
Au fil du temps, on est passé à côté d’un monde de solutions pour répondre aux besoins et aspirations de la population parce qu’on ne va pas puiser dans toute la richesse de l’humanité. Un état de fait qui s’inscrit sur fond d’une polarisation grandissante que les universités ont parfois reflétée de manière passive, et parfois amplifiée.
Les institutions ont failli à leur devoir pour préserver la démocratie – les mesures actuelles sont trop brèves, trop éphémères, ou mobilisent toujours les mêmes gens.
Dans une société de plus en plus complexe, cette approche est non seulement déconnectée, mais elle nous prive également de perspectives, de productivité et de savoir-faire précieux.
Rien ne nous empêche de changer de cap.
Les universités peuvent saisir le problème à bras-le-corps et œuvrer pour la démocratie en devenant des moteurs d’innovation sociale qui rassemblent des collaborateurs improbables pour atteindre des objectifs communs – même s’ils sont en désaccord sur tout le reste.
De spécialiste à facilitateur
Avec son nouveau modèle de gouvernance, l’École Cumming de l’Université de Calgary laisse tomber le paradigme traditionnel répandu dans le milieu universitaire selon lequel les spécialistes se chargent de la recherche, de la rédaction et de la diffusion des résultats.
L’École brasse les cartes et fait passer les spécialistes du rôle d’autorités à celui de facilitateurs. Ces derniers ne font plus que simplement transmettre les connaissances, ils doivent plutôt bâtir la confiance, faire le pont entre les gens et trouver conjointement des solutions.
Cette approche récompense l’écoute et incite ainsi les groupes à travailler ensemble sans tenter, comme il est courant, d’en aplanir les points qui les distinguent afin de bien s’entendre et d’aller de l’avant.
Résultat : on donne la chance de participer à toutes les communautés, qui peuvent alors contribuer à façonner l’avenir et à bâtir des relations durables.
De cette manière, l’université tisse des liens entre les communautés et résout les problèmes avant qu’ils ne se muent en crises. Plutôt que d’attendre qu’un mouvement social prenne forme et vienne potentiellement chambouler la société, l’université devient la gardienne proactive du bien-être commun.
De la facilitation à la collaboration
Selon ce modèle de gouvernance, pour répondre aux priorités communautaires, le facilitateur réunit des gens aux identités, idéologies, secteurs d’activités et disciplines différentes afin de comprendre et de résoudre les problèmes.
C’est un travail qui peut prendre toutes sortes de formes : faciliter la collaboration entre les entrepreneurs en devenir et les innovateurs derrière des technologies de pointe; travailler pour et avec les communautés autochtones à améliorer leur sort; favoriser l’accès de la population rurale à l’éducation supérieure; s’attaquer au problème de la polarisation de la population.
Bref, le facilitateur a pour rôle de guider le groupe vers des solutions concrètes.
L’objectif central est de collaborer avec les détenteurs d’une expertise, peu importe où elle réside – elle peut découler de leur vécu, de leurs savoirs autochtones ou de connaissances intersectorielles, en parallèle des approches universitaires traditionnelles.
Les facilitateurs créent un espace où des groupes historiquement en conflit peuvent mettre leurs différences de côté. Par exemple, les groupes religieux et les communautés LGBTQ2S+ peuvent collaborer sur des enjeux comme le vieillissement sain, l’accès aux services en ruralité ou le manque de terrains d’entente dans la société.
Tout commence par l’établissement de priorités conjointes
Plutôt que de laisser le choix des priorités entre les mains d’universitaires et de politiciens derrière les portes closes (comme cela a été le cas jusqu’à présent), il faut plutôt opter pour un dialogue dirigé avec les communautés.
Les gens les plus près du problème sont alors réunis avec les décisionnaires.
Certaines priorités sont locales de nature. Par exemple, les dirigeants d’organismes à but non lucratif désirent développer des compétences exécutives adaptées aux réalités de leur milieu.
D’autres priorités se recoupent : elles ne figurent au sommet de la liste d’aucun groupe, mais en sous-tendent plusieurs autres. La polarisation politique et sociale, par exemple, peut avoir des répercussions sur la productivité, l’innovation et la cohésion sociale.
Toutefois, selon le modèle traditionnel, ces problèmes sont souvent négligés parce qu’ils semblent compliqués et secondaires.
Les retombées du pluralisme
Les priorités établies en tendant le micro aux communautés deviennent les indicateurs de l’efficacité de nos démarches, dont l’aboutissement peut tout autant être une politique qu’un produit, un service ou un programme de recherche, ou simplement des perspectives plus exhaustives et inclusives qui orienteront la prise de décisions.
Mais le processus en lui-même est tout aussi important; il enseigne aux gens comment travailler de concert malgré les différences. L’université devient non seulement un producteur de savoir, mais aussi un carrefour où tisser des relations.
Nul n’a besoin de s’entendre ou de renier ses croyances profondément ancrées pour participer. Plutôt que de devenir un pôle grandissant de polarisation des idées et opinions, les campus peuvent atteindre leur véritable potentiel à titre de terrain d’entente où partager ses idées et prendre des décisions qui reflètent toutes les facettes des communautés qu’ils sont censés représenter.
Cet article fait partie de la série Réinventer la gouvernance dans un monde complexe. Retrouvez la série complète et poursuivez la lecture ici