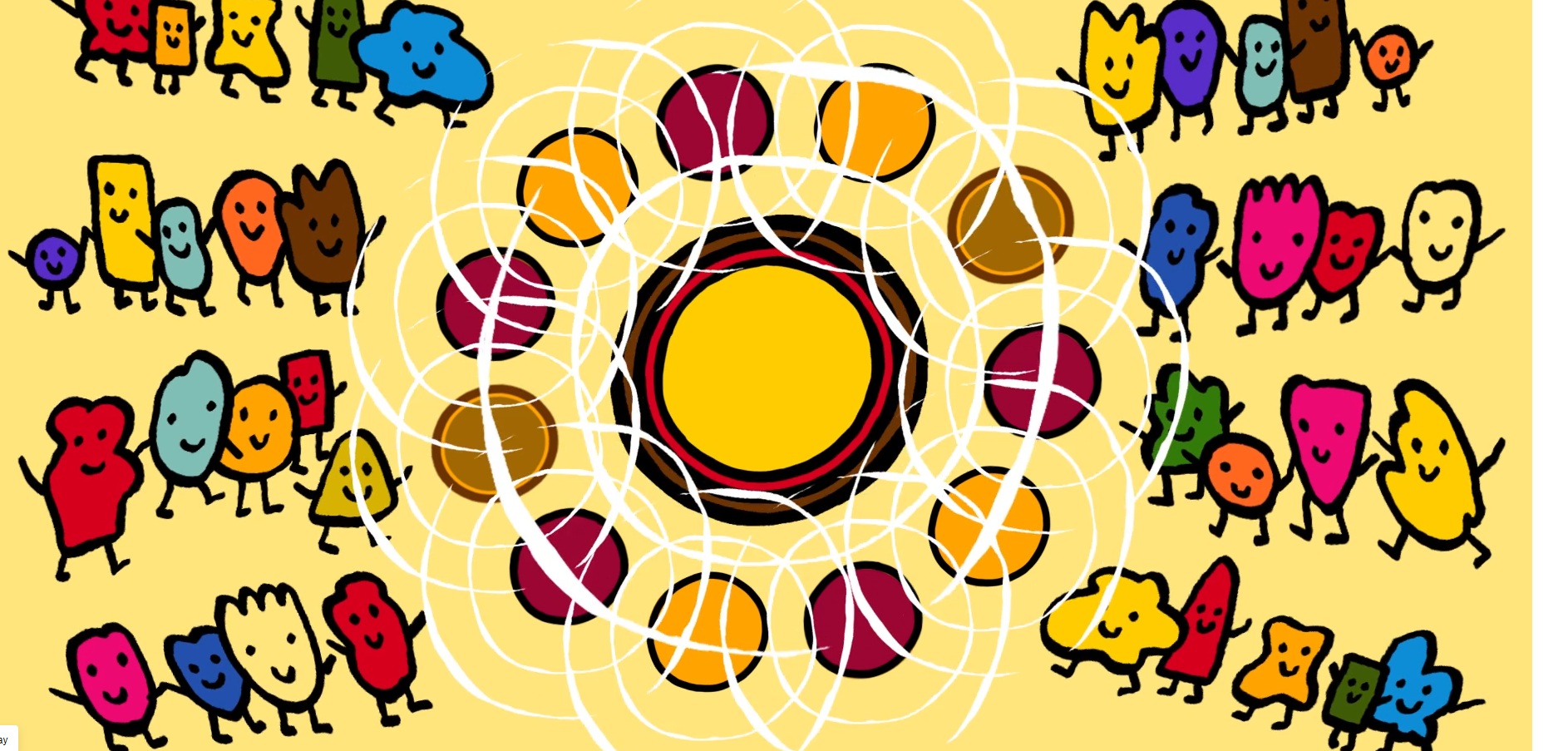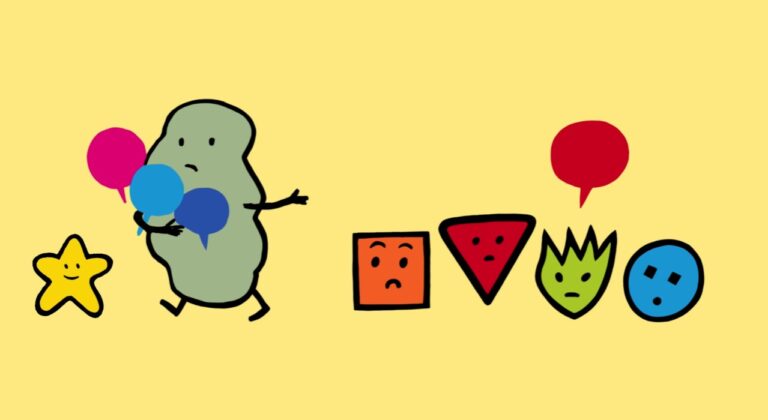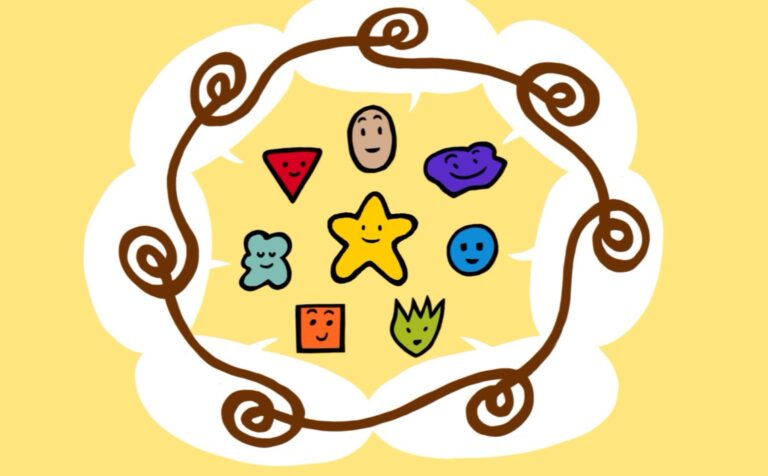(English version available here.)
Pendant des années, Hockey Canada a recruté ses têtes dirigeantes presque uniquement dans un cercle homogène d’adeptes du hockey.
Comme on l’a vu dans les médias et à la cour, une culture du secret régnait : les frais d’inscription des joueurs étaient utilisés pour faire disparaître discrètement les allégations d’agressions sexuelles. Parallèlement, les voix critiques – organisations citoyennes, personnel, athlètes féminines – étaient tenues loin du processus décisionnel interne.
Il en est résulté un échec de gouvernance systémique et chronique.
La révélation du scandale a eu un effet domino : en l’absence de structures pour exprimer des opinions dissidentes, les perspectives critiques ont été ignorées. La crédibilité de l’organisation s’est effondrée. Les commanditaires ont pris leurs jambes à leur cou. Le directeur général et les membres du conseil d’administration ont démissionné.
La renommée de l’organisation et l’ampleur du scandale ont entraîné une importante couverture médiatique, mais la crise de gouvernance de Hockey Canada n’a rien d’unique.
L’établissement d’une structure de gouvernance résiliente et efficace est un processus complexe et exigeant. Même un conseil d’administration diversifié n’est pas à l’abri des erreurs.
Après tout, pour avoir un dialogue véritablement constructif, il faut (beaucoup) plus qu’un ensemble de voix représentatives assises autour d’une table : il faut aussi mettre en place des mécanismes d’apprentissage et favoriser une culture d’écoute même en cas de désaccord.
Le vrai défi, c’est d’y parvenir.
Malgré les efforts de mouvements comme #MoiAussi et #BlackLivesMatter, qui ont poussé les conseils d’administration à se diversifier, les directions d’organismes et les membres de conseils d’administration ont pris l’habitude d’attendre que les mouvements sociaux les forcent à apporter des changements.
Le retour de balancier a provoqué une réaction anti‑EDI, qui s’accompagne de son propre lot de pressions.
Tout ceci représente un échec de gouvernance, une incapacité à comprendre les différences et à s’attaquer aux problèmes de manière proactive.
Ignorance intrinsèque
Lorsqu’on demande aux gens ce qu’évoque pour eux la gouvernance, ils pensent à des organigrammes et à des conseils d’administration. Mais l’efficacité des processus décisionnels passe également par une approche structurée permettant de cerner et de comprendre les problèmes ainsi que les personnes et les communautés touchées.
Ce qu’on appelle couramment la discrimination systémique, je l’appelle l’ignorance systémique : c’est l’incapacité d’un système à connaître et à comprendre les autres, peu importe les différences.
En cas de divergences, les tensions sont normales et attendues. L’idée n’est pas d’éviter le conflit, mais plutôt d’encourager l’expression de points de vue sans taire, effacer ou bannir les perspectives différentes.
Les obstacles à cette vision sont souvent des éléments qui stimulent les têtes dirigeantes et les conseils d’administration, très concentrés sur des objectifs à court terme orientés par les budgets annuels, les mandats et les cycles d’élection. Cette tendance chronique à privilégier le court terme nous enferme dans une mentalité figée, limitée et sans ambition.
Les conseils d’administration se dépêchent de prendre des décisions au nom de l’efficacité.
En d’autres mots, ce sont les modèles de gouvernance eux-mêmes, présents dans la plupart des organisations, qui forcent les têtes dirigeantes à prendre des décisions sous-optimales.
Notre monde complexe a besoin de nouveaux modèles qui remplacent le conflit par le contexte. Ainsi, nous pouvons exploiter nos différences pour alimenter l’innovation et résoudre les problèmes, plutôt que de détruire les relations qui soutiennent notre tissu social par des confrontations toxiques.
Dans cette série qui nous amène à repenser la gouvernance, c’est dans le contexte et la façon de prendre des décisions que l’innovation entre en jeu.
Modèles de gouvernance communautaires
Il est impossible pour un conseil d’administration composé d’une douzaine de personnes de représenter la totalité des facteurs socioculturels, des réflexions ou des points de vue. De plus, les pratiques de recrutement écartent de nombreuses voix, favorisant « certains types » de différences en fonction des tendances actuelles.
La vie des personnes noires est-elle plus importante en 2020 qu’en 2000 ou en 2050? La vie des personnes autochtones est-elle plus importante avant ou après la Commission de vérité et réconciliation? Qu’en est-il de celle des gens vivant en région rurale?
En adoptant une structure qui intègre les organisations communautaires plutôt que les individus, les conseils d’administration deviennent un point d’accès pour tout un réseau sociétal de relations – plus besoin d’attendre un mouvement social pour forcer la représentation de groupes auparavant négligés ou ignorés.
Notre nouvelle approche donne une place aux organisations de la société civile et aux voix autochtones dans le processus de gouvernance – en remplaçant la diversité de façade par une structure de gouvernance et une équipe qui tiennent bien compte des différentes communautés représentées.
Mais deux voix importantes sont encore absentes à la table.
La planète et les futures générations sont touchées par nos décisions d’aujourd’hui, mais n’ont pas leur mot à dire. C’est pourquoi nous les personnifions et leur donnons un siège permanent à table, et que nous assurons leur représentation par une personne garante, comme un Aîné.
Évidemment, plus de différences peuvent amener plus de conflits.
Une personne en situation d’autorité, comme un cadre, un président ou un membre de conseil d’administration, est limitée par sa propre compréhension du monde.
Dans notre nouveau modèle, les têtes dirigeantes facilitent la compréhension et la responsabilisation au sein d’un réseau exhaustif de relations au lieu d’agir à titre d’autorité absolue.
Cette responsabilité n’incombe pas seulement à des particuliers : les organisations et des secteurs entiers l’intègrent aussi à grande échelle. De telles mesures de responsabilisation sont créées en collaboration avec les entités participantes afin que tous puissent apprendre conjointement à mieux agir dans l’intérêt commun – un aspect négligé qui s’érode depuis trop longtemps.
Des bonnes intentions aux mesures concrètes
En règle générale, les modèles de gouvernance sont conçus pour gérer des dossiers précis, comme l’embauche d’un directeur général ou la planification d’une campagne de financement. Pourtant, nos enjeux contemporains sont pour la plupart complexes, multigénérationnels et interconnectés.
La précision est maintenant dépassée.
On peut continuer à faire de la gestion de crise, ou on peut restructurer la salle, la table et la conversation. Pour y arriver, il faut structurer le conflit, intégrer les opinions dissidentes aux processus et laisser les désaccords raffiner les décisions et non détruire les relations.
Cet article fait partie de la série Réinventer la gouvernance dans un monde complexe. Retrouvez la série complète et poursuivez la lecture ici