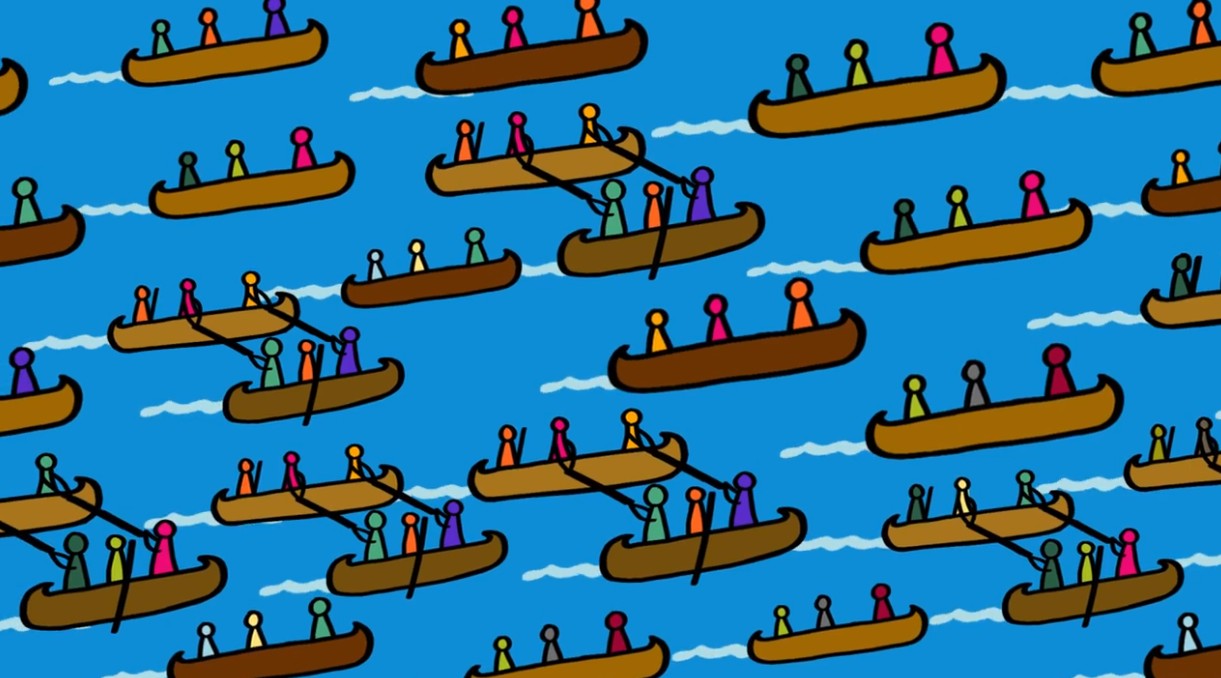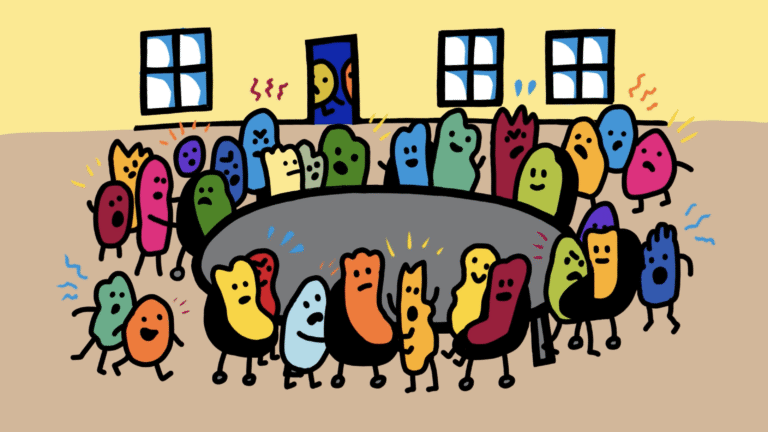(English version available here.)
Co-écrit avec le Cercle d’Aînés ii’ taa’poh’to’p
Malgré les accomplissements remarquables des établissements d’enseignement supérieur du Canada, un problème persiste de façon endémique sur presque tous les campus : l’ignorance systémique des systèmes de connaissances autochtones.
Une lueur d’espoir nous offre une piste de solution : la notion des chemins parallèles, un concept issu des travaux des gardiens du savoir qui ont contribué à la stratégie de mobilisation autochtone ii’ taa’poh’to’p de l’Université de Calgary en 2017.
Chemins parallèles
Le principe des chemins parallèles revivifie les pratiques de gouvernance autochtones tout en réaffirmant la souveraineté des peuples autochtones.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), adoptée en 2007, reconnaît les droits des peuples autochtones et met l’accent sur leur survie, leur dignité et leur bien-être. La pièce maîtresse de la Déclaration est un appel à l’autodétermination autochtone, particulièrement en éducation, où les lois et principes de gouvernance autochtone doivent être revitalisés pour assurer une autonomie et un respect réels.
La Commission de vérité et réconciliation du Canada tient d’ailleurs compte de cette réalité dans son rapport final, dans lequel elle souligne le droit des peuples autochtones de contrôler leurs établissements d’enseignement.
Pourtant, malgré ces engagements, les cadres décisionnels en enseignement supérieur excluent en grande partie les voix et les systèmes de connaissances autochtones.
Pour surmonter ces obstacles, nous devons repenser la relation entre les systèmes de gouvernance autochtones et occidentaux, ce qui passe par la création d’un espace éthique partagé où les deux systèmes coexistent sans se faire de l’ombre, une approche fondée sur le respect mutuel et la responsabilisation communautaire.
En avançant sur des chemins de gouvernance parallèles, nous avons la possibilité d’intégrer à la fois les perspectives autochtones et allochtones. Non seulement cette approche renforce nos systèmes de gouvernance partagée, mais c’est aussi un moyen d’honorer les principes fondateurs d’autodétermination bilatérale et d’inclusion.
Michael Hart, vice-recteur et vice-président associé responsable des relations avec les Autochtones à l’Université de Calgary, illustre ce principe en s’imaginant deux canots dans l’eau : chacun suit sa propre trajectoire, mais les pagayeurs peuvent se parler, échanger sur leurs expériences et discuter de plans pour descendre le cours d’eau.
Parfois, les pagayeurs devront fournir des efforts délibérés : tendre sa propre pagaie vers l’autre et attraper la sienne pour se rapprocher et se stabiliser comme une seule unité. Par cet effort mutuel de connexion, ils ouvrent un dialogue approfondi qui transcende les différences.
Reconnaissance mutuelle des valeurs fondamentales
Suivre ensemble des chemins parallèles requiert un engagement multilatéral et les ressources nécessaires pour intégrer l’espace éthique aux processus décisionnels, en particulier dans les organismes publics.
La notion de chemins parallèles représente la trajectoire de deux regroupements de communautés – autochtones et allochtones –, chacun ayant sa propre diversité interne, dans un espace partagé où aucune vision du monde ne domine et où nous nous entendons sur les façons de parler, d’écouter et de décider.
Tout en reconnaissant le caractère distinct de leurs histoires, de leurs expériences et de leur engagement constitutif envers l’autodétermination, ces communautés cheminent côte à côte, chacune à son rythme, unies par l’objectif de créer des relations mieux équilibrées. Chaque communauté applique ses propres philosophies et connaissances tout en apprenant des autres dans le but de créer un système partagé qui produise des résultats plus justes, fondés sur la compréhension mutuelle et la confiance.
Pour que cette transformation perdure – et qu’elle dépasse les simples ajustements en marge des grandes décisions –, nous devons partir de nos valeurs fondamentales et bâtir des modèles de gouvernance qui incluent réellement les peuples autochtones et qui reposent sur des relations solides. Ces grandes valeurs n’ont pas besoin d’être identiques : en fait, elles seront presque certainement différentes, mais tant qu’elles se recoupent en partie, elles rendent possible l’établissement d’un espace éthique partagé.
Ces espaces favorisent l’établissement d’un dialogue et l’identification de conflits potentiels, tout en encourageant une compréhension mutuelle qui respecte la diversité de nos histoires, de nos perspectives et de nos façons d’être. Bien que ces engagements relationnels n’exigent pas d’arriver à un consensus, ils nous appellent tout de même à réfléchir aux conséquences de nos actions et à tendre vers des résultats communs interconnectés et vers une vision à long terme.
Légitimité de la prise de décisions
Les espaces éthiques s’appliquent aussi au sein de groupes autochtones qui comprennent des peuples des Premières Nations, métis et inuits, chacun constitué de populations, de nations, de communautés, de familles, de systèmes de gouvernance et de visions du monde uniques.
La plupart des chercheurs autochtones et des Aînés partagent la conviction selon laquelle l’autorité de gouverner n’est pas conférée par le poste qu’on occupe, mais par la communauté elle‑même. Selon la vision du monde autochtone, les leaders sont des facilitateurs et non les détenteurs d’une autorité absolue.
En d’autres mots, la forme sert la fonction. Le cercle est une image fondamentale dans les systèmes autochtones de prise de décisions : chaque personne qui en fait partie correspond à un petit arc de cercle, et chacune est donc une partie essentielle au tout.
Cela dit, l’autodétermination s’étend au-delà des structures de gouvernance lorsqu’on parle de la souveraineté des peuples autochtones dans leurs relations avec d’autres peuples autochtones, des peuples allochtones, le territoire, les générations futures, et les entités non humaines. La souveraineté relationnelle nécessite des systèmes de gouvernance qui confèrent aux peuples autochtones l’autonomie dont ils ont besoin pour déterminer leurs propres structures, procédés et priorités, guidés par des cercles d’Aînés représentant diverses nations et communautés.
Pratiquer une gouvernance axée sur la coexistence
Prenons l’exemple d’une réunion où les traditions orales et écrites peuvent coexister en milieu universitaire.
L’Aîné Reg Crowshoe, coauteur de cet article, insiste sur l’importance de valider les bonnes pratiques de gouvernance orales et écrites : on peut signaler le début d’une réunion en frappant avec un maillet (tradition occidentale) et/ou avec une cérémonie de purification (tradition autochtone); le déroulement peut être guidé par un ordre du jour écrit (occidentale) et/ou des souhaits exprimés oralement (autochtone); et les résultats peuvent être ratifiés par un vote (occidentale) et/ou une chanson (autochtone).
C’est au président ou à la présidente de la réunion de choisir la voie à suivre – tradition orale et/ou écrite. Les personnes participantes peuvent exprimer leur préférence avant la réunion, ou la signaler par leur décision d’être présentes ou non.
Le principe des chemins parallèles en tant que dimension centrale d’une réforme de la gouvernance peut être adopté par des organismes publics, privés et à but non lucratif. Pour reconnaître pleinement le fait que différentes communautés ont leur propre identité, leur propre histoire et leurs propres perspectives, nous devons nous efforcer de créer des espaces sains et éthiques ouverts au dialogue.
Ces espaces nous amènent à écouter, même en cas de désaccord, à analyser conjointement les défis sociétaux, à remplir nos obligations légales, morales et culturelles et à en apprendre plus les uns sur les autres avec humilité et ouverture.
Il revient à chaque unité de gouvernance sur ce territoire de déterminer pour elle-même la forme que prendra cet espace éthique.
Cet article fait partie de la série Réinventer la gouvernance dans un monde complexe. Retrouvez la série complète et poursuivez la lecture ici