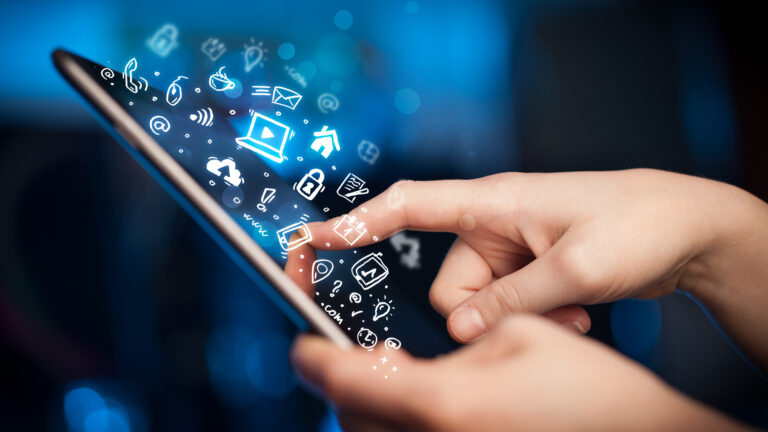(English version available here.)
Cet article fait partie de notre série Réfléchir ensemble à l’unité nationale, réalisée dans le cadre des 30 ans du référendum québécois.
Trente ans après le deuxième référendum sur l’indépendance au Québec et malgré le regain de popularité du Parti québécois (PQ), le défi principal de la fédération canadienne dans ses efforts de cohésion et d’unité semble provenir de l’Alberta.
Effectivement, le gouvernement conservateur de Danielle Smith, élu en 2022, n’a pas manqué de critiquer les gouvernements fédéraux libéraux successifs de Justin Trudeau et, plus récemment, de Mark Carney. De plus, il a délibérément assoupli les règles, ce qui facilite grandement la tenue d’un référendum.
Ce changement a eu lieu au moment où le mouvement indépendantiste albertain, bien que toujours relativement faible (aucun parti politique représenté à l’Assemblée législative ne le soutient), fait parler de lui plus que jamais. Le gouvernement albertain reconnait ouvertement trouver au Québec une source d’inspiration pour son approche.
Cependant, cette inspiration ne rend pas l’indépendance de l’Alberta plus probable. Bien plus que pour le Québec, le projet de sécession en Alberta fait face à des obstacles très importants.
Le Québec comme modèle pour l’autonomie
Avant de discuter ces obstacles, il convient de souligner le lien explicite qui existe en Alberta entre l’enjeu référendaire et l’expérience québécoise. Ce lien renvoie plus généralement à l’importance du Québec dans les débats sur l’avenir de l’Alberta.
En Alberta comme ailleurs au pays, on considère le Québec comme un « modèle » en matière d’autonomie provinciale et d’affirmation politique et territoriale. Cette image est liée notamment aux politiques publiques adoptées au Québec depuis la Révolution tranquille. Plus généralement, les gens perçoivent cette province comme étant à l’avant-garde de la lutte contre la centralisation dans le système fédéral canadien, un enjeu très important en ce moment en Alberta.
Un exemple de résistance à la centralisation
Cette réalité explique en partie la fascination durable que le Québec exerce parmi les autonomistes albertains. Ces derniers critiquent les prises de position du Québec en matière d’environnement ainsi que le programme fédéral de péréquation, qui profite notamment à cette province. Mais ils ont aussi tendance aussi à décrire le Québec comme un modèle en matière d’autonomisme. Ils admirent sa résistance face à l’État fédéral canadien et à toute logique centralisatrice qui semblerait menacer les intérêts provinciaux.
Un exemple clair de cette fascination pour le Québec est le rapport du Groupe d’experts sur l’équité (Fair Deal Panel) mis en place par l’ancien premier ministre albertain Jason Kenney pour promouvoir l’autonomie de sa province. Dans ce rapport publié en juin 2020, le groupe mentionne beaucoup plus souvent le Québec que toute autre province canadienne. Ainsi, le rapport mentionne le Québec pas moins de 56 fois, comparativement à seulement 9 fois pour l’Ontario.
Ce document examine des mesures prises par le Québec, telles que le désengagement de la province du Régime de pensions du Canada à sa création dans les années 1960. Il examine aussi la proposition de droit de retrait avec indemnisation intégrale des programmes fédéraux à coût partagé. Cette idée remonte également à la Révolution tranquille.
Un référendum pour faire pression sur le fédéral
Au-delà des enjeux de politique publique, le Québec est également une source d’inspiration en Alberta en matière de stratégie politique, y compris sur la question référendaire. Une idée fondamentale partagée par plusieurs partisans de la tenue d’un référendum sur l’indépendance de l’Alberta est que le Québec serait plus influent au sein du Canada en raison de la menace même d’un référendum.
Selon cette interprétation du cas québécois, tenir un référendum sur l’indépendance de l’Alberta ou simplement agiter cette menace en public pourrait aider l’Alberta à faire pression sur le gouvernement fédéral et le reste du Canada. Elle pourrait ainsi obtenir plus de respect envers la province et ses intérêts. Les partisans de l’indépendance de l’Alberta considèrent à juste titre que le Québec est un précédent clair à l’organisation de référendums sur l’indépendance d’une province au Canada.
De leur côté, les indépendantistes québécois voient souvent d’un bon œil la tenue d’un tel référendum en Alberta, car elle affaiblirait le Canada, un pays dont ils voudraient que le Québec sorte. C’est dans ce contexte que le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a récemment visité Calgary. Cette visite a suscité une importante couverture médiatique, tout comme sa déclaration selon laquelle, dans le cas d’une victoire du « oui » dans cette province, il reconnaitrait l’indépendance de l’Alberta en tant que premier ministre du Québec.
Obstacles internes à l’indépendance albertaine
Malgré ces remarques, le sécessionnisme en Alberta est assez différent de ce que l’on retrouve au Québec. Il y a dans cette province de l’Ouest plusieurs voix sécessionnistes, telles des organisations comme l’Alberta Prosperity Project, des partis politiques marginaux, comme le Republican Party of Alberta et The Independence Party of Alberta, des membres du parti formant le gouvernement, l’United Conservative Party (UCP), ainsi que quelques intellectuels.
De plus, l’appui à l’indépendance n’est pas négligeable, car il semble fluctuer entre environ 20 % et 30 %. Toutefois, il est loin d’être certain que l’ensemble de ces voix constitue un mouvement, en raison de l’absence d’un leadership clair. La première ministre Danielle Smith, malgré ses nombreux reproches adressés aux gouvernements fédéraux libéraux, a affirmé que ni son gouvernement ni son parti n’allaient prendre position sur l’avenir politique et constitutionnel de la province. En même temps, elle dit espérer que l’avenir de l’Alberta soit au sein du Canada.
Dans ces conditions, il est difficile de voir comment une campagne référendaire pour l’indépendance pourrait être menée, du moins efficacement. Le Brexit a réussi dans un contexte similaire, mais la sécession d’une province canadienne implique des coûts symboliques, politiques, économiques et sociaux très différents de la sortie d’un État de l’Union européenne.
L’absence d’une « nation » albertaine
De plus, le sécessionnisme albertain est différent du sécessionnisme québécois du fait qu’il ne découle pas du nationalisme. La vigueur d’un mouvement sécessionniste provient généralement de ses références à une nation, c’est-à-dire une communauté politique dont les membres ressentent une solidarité particulière et qui recherche un certain niveau d’autodétermination. Ces références sont manquantes en Alberta; malgré les mentions d’une éventuelle République albertaine, la notion de l’Alberta comme communauté nationale n’est pratiquement jamais évoquée.
En fait, certains partisans de la sécession favorisent une annexion aux États-Unis. Sans le réservoir symbolique de la nation, il est difficile de voir comment les chefs sécessionnistes pourraient convaincre les Albertains de quitter ce qu’ils considèrent comme leur communauté nationale, même si l’idée était d’envoyer un « message » d’insatisfaction au reste du Canada.
Les difficultés que rencontreront les partisans de la sécession à trouver un grand nombre d’appuis pour leur projet sont déjà visibles. Le gouvernement albertain avait considéré la mise sur pied d’un fonds de pension provincial à l’instar du Québec, mais il a récemment reculé face à l’impopularité d’une telle mesure.
Si une telle initiative autonomiste n’obtient pas un appui majoritaire de la part des Albertains, que peuvent espérer les partisans de la sécession? De plus, l’une des doléances les plus importantes des sécessionnistes — l’hésitation du gouvernement fédéral envers la construction de nouveaux oléoducs — risquerait de demeurer sans solution. Une éventuelle République albertaine devrait de toute façon négocier avec le Canada le transport et l’exportation de son pétrole vers l’Europe et l’Asie.
Un avertissement autant qu’une inspiration
De plus, à ces obstacles propres à l’Alberta s’ajoutent les difficultés habituelles des mouvements sécessionnistes dans les démocraties libérales industrialisées : convaincre les citoyens de quitter un État stable pour en former un autre. Les incertitudes économiques, la question de la devise ou encore la reconnaissance internationale constituent autant de freins bien connus.
Dans le contexte canadien, un autre défi se poserait : la conformité des sécessionnistes albertains à la Loi sur la clarté, qui confère à la Chambre des Communes le pouvoir de juger de la nature de la question référendaire et du seuil de majorité requis. En bref, même si l’indépendance de l’Alberta est possible, elle semble pour le moins improbable, encore plus que celle du Québec.
Certains partisans d’un référendum estiment toutefois que la tenue d’un tel vote enverrait un « message » fort au reste du Canada sur la volonté de l’Alberta de s’affirmer et d’être respecté davantage par le gouvernement fédéral et les autres provinces, y compris le Québec.
Comme le souligne l’ancien premier ministre Jason Kenney, la tenue un référendum sur l’indépendance est risquée sur le plan économique. Elle serait synonyme d’instabilité politique, ce qui pourrait décourager les entreprises de s’installer ou d’investir en Alberta.
Paradoxalement, il a invoqué l’exemple même du Québec pour dissuader ses partisans :
Ainsi, le Québec sert à la fois d’inspiration et d’avertissement dans le débat sur l’indépendance albertaine.