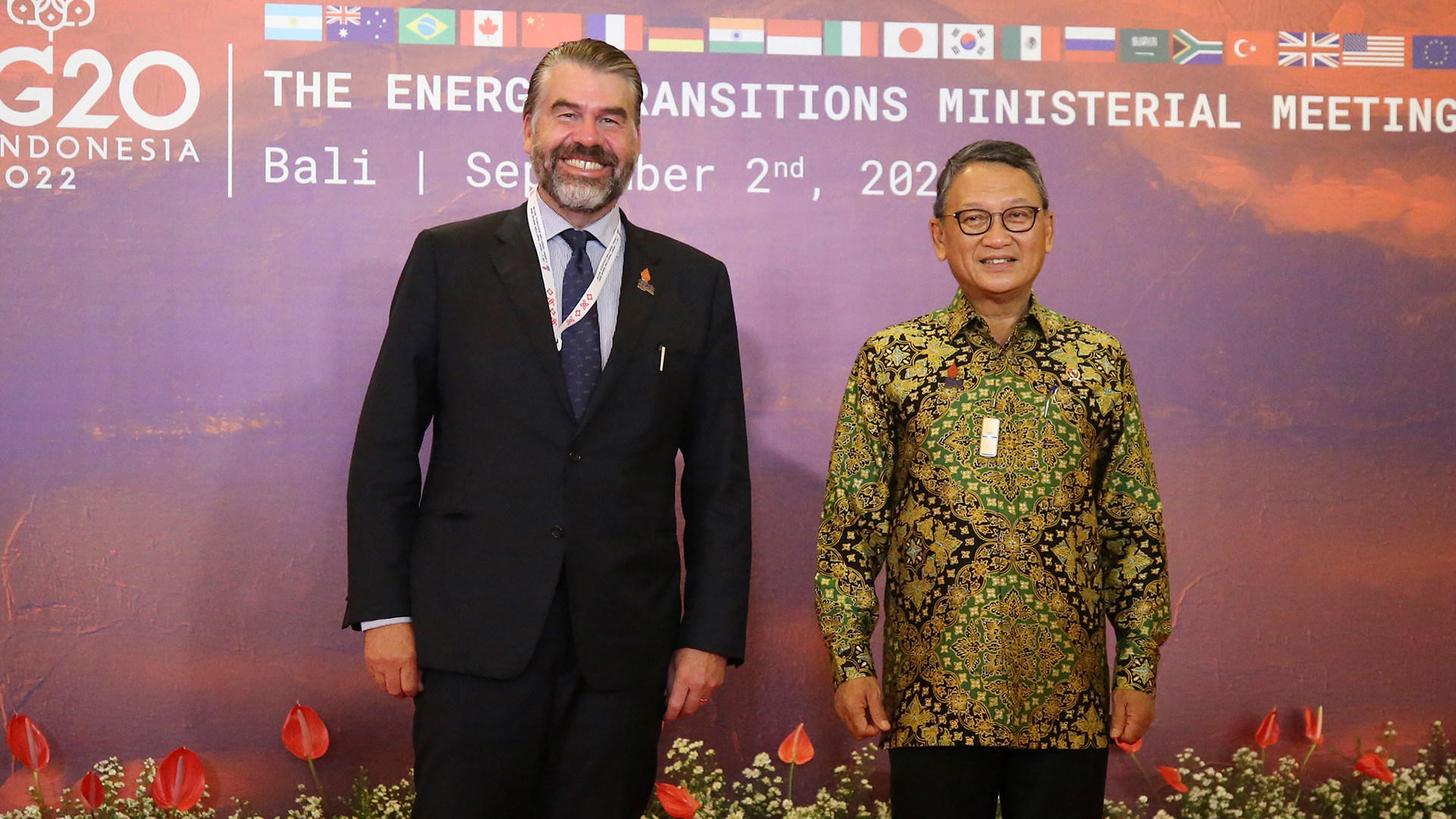Dans toute fédération, il est normal que des conflits surgissent entre les gouvernements en présence. Le plus important, c’est que ces désaccords ne deviennent pas systématiques et ne minent pas de façon irrémédiable l’esprit de collaboration qui définit et anime le fédéralisme.
Au cours du présent mandat, le gouvernement de Justin Trudeau a semblé vouloir se préoccuper des relations intergouvernementales. Il a tenu des rencontres fédérales-provinciales, chose qu’évitait autant que possible le gouvernement de Stephen Harper. Il a gardé grandes ouvertes les voies de communication avec les provinces sur maints enjeux, comme la négociation et la mise en œuvre du nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique, la gestion de la pandémie de COVID-19, les discussions avec l’Alberta sur la relance économique de cette province, l’allègement, par le gouvernement canadien, du déficit de Muskrat Falls à Terre-Neuve-et-Labrador, les ententes avec le Québec pour faciliter la venue et l’embauche de travailleurs étrangers temporaires ou l’entente Ottawa-Québec sur la nomination d’un juge à la Cour suprême du Canada. Il n’empêche qu’un certain nombre d’irritants ont dominé la scène politique et, dans certains cas, subsistent à ce jour. Les voici.
1. Le pouvoir fédéral de dépenser
Le pouvoir fédéral de dépenser n’est pas problématique lorsqu’il est exercé dans les champs de compétence fédéraux. Il le devient lorsqu’il touche des compétences constitutionnelles relevant essentiellement ou exclusivement des provinces. Les gouvernements libéraux à Ottawa ont toujours eu tendance à faire un usage provocant du pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétence provinciaux. Le gouvernement de Justin Trudeau n’a pas fait exception à la règle. Que ce soit les résidences pour personnes âgées, le logement, les garderies ou l’assurance-médicaments, on a vu le gouvernement canadien annoncer ses couleurs, c’est-à-dire son intention d’intervenir dans ces dossiers, d’en dicter les conditions ou d’y instaurer un programme national. Peu de provinces s’y opposent, cependant. Le Québec, pour sa part, s’objecte à ce que des conditions lui soient imposées et réclame une juste compensation financière pour ses programmes existants, comme cela s’est concrétisé avec l’entente conjointe sur la mise en place d’un programme national de garderies.
2. La législation du cannabis et l’aide médicale à mourir
Voilà deux dossiers à l’égard desquels la collaboration fédérale-provinciale aurait pu être plus soutenue. En ce qui concerne le cannabis, le gouvernement Trudeau a agi plutôt péremptoirement en fixant à 18 ans l’âge légal pour en posséder et en permettant, à certaines conditions, sa culture dans une résidence privée.
L’élaboration de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) s’est faite sans trop de consultation des provinces. Pourtant, dans l’arrêt Carter c. Canada, la Cour suprême n’a pas hésité à classer ce sujet parmi les compétences partagées puisque, si le Parlement fédéral jouit d’une compétence exclusive à l’égard du droit criminel, les provinces, elles, jouent un rôle essentiel en matière de santé.
3. La tarification du carbone
Le gouvernement de Justin Trudeau a voulu faire montre de leadership dans la lutte contre les changements climatiques, entre autres en imposant une taxe sur le carbone. Les initiatives fédérales ont fait l’objet de contestations judiciaires qui se sont rendues jusqu’en Cour suprême. Celle-ci a finalement donné raison à Ottawa et déclaré constitutionnelle la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Plus précisément, selon ce tribunal, l’imposition de normes pancanadiennes en matière de tarification du carbone constitue un enjeu d’intérêt national et la loi fédérale est à cet égard un « filet de sécurité ».
La Saskatchewan, l’Ontario et l’Alberta se sont dits frustrés par l’attitude et la ferme détermination du gouvernement canadien. Ces provinces n’ont cependant eu d’autre choix que de s’incliner face à la décision de la plus haute instance judiciaire du pays.
4. Les langues officielles
Le 15 juin 2021, la ministre Mélanie Joly a rendu public son projet de loi visant à moderniser et à renforcer la Loi sur les langues officielles. Ce travail bien accompli — qui n’en est toutefois qu’à ses balbutiements sur le plan de la procédure parlementaire — est fort prometteur. Dans ce projet de loi, le gouvernement du Canada s’engage entre autres à protéger et à promouvoir le français, y compris au Québec.
Cela n’a pas empêché le gouvernement Trudeau de procéder à la nomination d’une anglophone unilingue comme lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick (une province pourtant officiellement bilingue), d’une unilingue anglophone comme directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada et d’une gouverneure générale qui ne parle pas le français. Il songerait aussi à nommer un anglophone unilingue à la tête du Musée canadien de l’histoire et du Musée canadien de la guerre.
5. Les droits des peuples autochtones
Le 13 septembre 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, dont l’article 38 invite les États à prendre les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts poursuivis. Dans cette veine, le Parlement du Canada a adopté en 2021 la Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Elle découle de la volonté de ce gouvernement de prendre des mesures efficaces, d’ordre législatif, politique et administratif, afin de réaliser les objectifs de la Déclaration. Dans son préambule, la loi précise que le gouvernement du Canada reconnaît aux gouvernements provinciaux et territoriaux et aux administrations municipales le pouvoir d’établir leurs propres façons de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration. La loi spécifie aussi que pour atteindre les objectifs fixés, le gouvernement du Canada est prêt à collaborer tant avec ces gouvernements et ces administrations qu’avec les peuples autochtones et d’autres acteurs de la société.
Six provinces, dont le Québec, ont pourtant exprimé des inquiétudes par rapport à la loi susmentionnée, en raison notamment du fait qu’elle pourrait en venir à remplacer un cadre juridique connu par des décennies de contestations judiciaires éventuelles de la part des Autochtones eux-mêmes. Il faut dire que la loi fédérale en question force habilement la coopération, en créant chez les Autochtones des attentes que les provinces ne voudront sans doute pas décevoir dans l’avenir.
La Déclaration des Nations Unies elle-même fait partie intégrante du droit canadien et pourrait être utilisée par les tribunaux comme source d’interprétation du droit constitutionnel, autochtone, fédéral ou provincial. Elle rejoint d’ailleurs une foule de matières de compétence essentiellement provinciale, comme les terres et les territoires, les ressources, les soins de santé, l’éducation, l’emploi, la formation et la reconversion professionnelles, le logement ainsi que la sécurité sociale, en plus de reconnaître le droit des peuples autochtones à l’autodétermination, à l’autonomie et au développement conformément à leurs besoins, à leurs intérêts et à leurs aspirations.
La Déclaration va jusqu’à soumettre à l’approbation des Autochtones l’adoption de mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher ou tout projet ayant des incidences sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, afin de permettre l’expression d’un consentement « donné librement et en connaissance de cause ». Cela risque de se transformer un de ces jours en un droit de veto en faveur des Autochtones sur le développement des territoires et des ressources naturelles, au grand dam des provinces, qui devront en subir les conséquences.
Étant donné l’impact potentiel de la Déclaration sur les intérêts provinciaux, il aurait été sage que le gouvernement de Justin Trudeau s’assure que sa propre loi ne dépasse pas le cadre des compétences fédérales et ne déteigne pas sur les pouvoirs et les droits provinciaux. Plutôt que de se servir du principe du « fédéralisme coopératif » pour forcer la main des provinces sur des sujets qui les concernent directement, le gouvernement fédéral aurait mieux fait de les mettre à contribution pour élaborer sa loi, une loi qui aurait pu, si on l’avait voulu, renforcer l’unité nationale plutôt que d’être la source d’un autre différend fédéral-provincial.
Un bilan ambivalent
Faute d’espace, nous n’avons pas insisté sur la contestation par le gouvernement Trudeau (et le gouvernement Harper avant lui) — en tant que mis en cause — de la loi 99 du Québec. Nous n’avons pas discuté non plus de l’absence, jusqu’à présent, de contestation par le gouvernement du Canada de la Loi sur la laïcité de l’État, pas plus que de l’admission, par Justin Trudeau, du fait que le Québec peut modifier unilatéralement la Constitution canadienne conformément à ce que propose le projet de loi 96. Nous n’avons pas plus parlé du refus du gouvernement Trudeau de hausser sans conditions les transferts fédéraux en matière de santé.
Somme toute, force est de constater que le gouvernement Trudeau adopte une attitude ambivalente en matière de relations intergouvernementales. Les vieux réflexes fédéraux, allant dans le sens de l’interventionnisme et du paternalisme à l’égard des provinces, demeurent bien présents, mais ils se déploient quand même, selon nous, sur un fond de bonne volonté.
En dépit de tout, la centralisation du régime canadien se poursuit, cautionnée la plupart du temps par la Cour suprême du Canada elle-même. Le gouvernement Trudeau, comme bien d’autres gouvernements fédéraux avant lui, profite de cette tendance qui, osons-nous l’espérer, peut encore s’inverser.