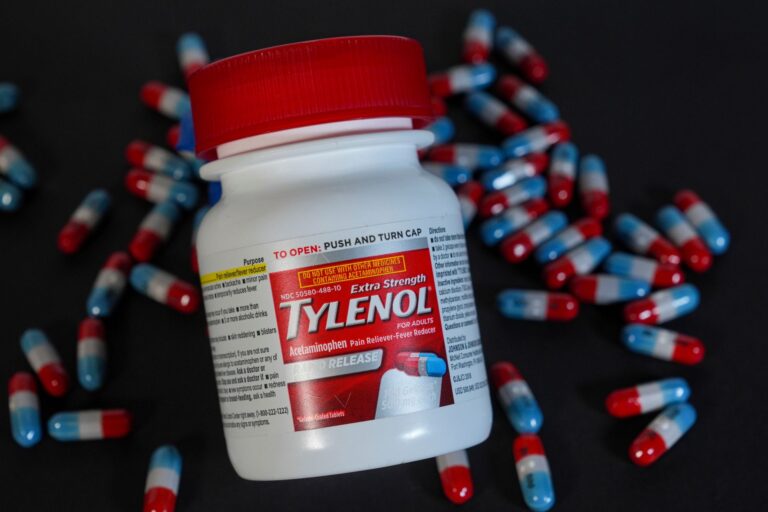(English version available here.)
Cet article est la deuxième partie d’un article publié précédemment et intitulé : Le système de santé a besoin d’être reconstruit.
Les systèmes de santé partout à travers le monde peinent à répondre aux besoins de leurs populations. Malgré les réformes successives et les promesses politiques répétées, les résultats demeurent insuffisants : l’amélioration de la qualité des soins est peu démontrée, l’accès reste inégal, les équipes sont épuisées et les coûts, toujours en hausse. Pourquoi tant d’efforts produisent-ils si peu de résultats tangibles?
Une partie de la réponse réside dans ce que j’appelle la « pensée magique ». Trop souvent, on croit qu’un plan rempli d’initiatives séduisantes suffira à transformer le système. On affiche de grandes ambitions, sans s’attarder aux causes profondes de la non-performance et sans vérifier si les solutions proposées auront réellement l’effet attendu. Cette approche, que l’on retrouve dans bien des juridictions, semble échouer invariablement.
Un horizon de dix ans
Pour bâtir un système de santé résilient, il faut rompre avec la pensée magique et adopter une méthode plus scientifique. Cela signifie identifier les causes réelles des problèmes, définir des cibles claires et réalistes, établir un modèle de cause à effet entre la situation actuelle et les résultats recherchés, tester les solutions et les ajuster en fonction des résultats. L’ambition est nécessaire, mais la discipline l’est encore davantage.
Transformer un système de santé ne se fait pas en deux ou trois ans. L’expérience internationale montre qu’un horizon de dix ans serait nécessaire. Cet horizon long permet de dépasser les cycles électoraux et de donner le temps aux équipes de stabiliser les changements. Il est illusoire de croire qu’une transformation numérique, une réorganisation clinique ou un virage vers les soins de proximité peuvent être menés à terme dans un seul mandat politique.
Le long terme est une condition de succès : il permet non seulement de réaliser la transformation, mais aussi de consolider les acquis pour qu’ils deviennent durables.
L’exécution avant tout
« La culture mange la stratégie au déjeuner », disait Peter Drucker. On pourrait ajouter que l’exécution mange la stratégie au souper. Même la meilleure vision échouera si elle n’est pas portée par une discipline d’exécution et par une culture organisationnelle alignée.
Exécuter une stratégie, c’est la traduire en gestes concrets, suivre leur mise en œuvre avec rigueur, apprendre des écarts entre les résultats attendus et obtenus, puis ajuster. En santé, cela suppose aussi de comprendre la science de l’implantation, qui vise à accélérer l’adoption des pratiques cliniques et des innovations. Car un modèle de soins efficace, prouvé dans un milieu, met encore souvent 15 à 20 ans avant de se généraliser.
Le cœur de la transformation, ce n’est donc pas la vision, mais la capacité de la réaliser dans le quotidien des équipes et des patients.
Une démarche en cinq étapes
Comment structurer une telle transformation? Je propose une démarche inspirée du principe d’exécution alignant la stratégie et les opérations proposé par les chercheurs Robert Kaplan et David Norton et que j’ai adaptée aux réalités des systèmes de santé. Cette démarche repose sur cinq étapes:
- Confirmer la raison de la transformation. On ne transforme pas un système pour introduire des technologies à la mode ou pour plaire à certaines parties prenantes. On le transforme pour répondre à quelques problèmes majeurs qui menacent directement la santé de la population, comme l’explosion des maladies chroniques ou l’accès insuffisant aux soins urgents.
- Définir une vision claire. Cette vision explique comment le système créera de la valeur pour la population, les équipes et l’ensemble des parties prenantes. Elle précise les objets ciblés, la finalité recherchée (inspirée du Quintuple Objectif), les principes directeurs, la gouvernance souhaitée et le scénario futur d’offre de services. Ce scénario est la pierre angulaire de la vision, on doit présenter à la population et aux équipes soignantes quels soins et services seront offerts dans le futur, et comment.
- Définir la stratégie. La stratégie décrit comment on passera de la situation actuelle à la vision, à travers des initiatives cohérentes et séquencées, fondées sur des relations de cause à effet. Elle doit être comprise et validée par les parties prenantes.
- Établir une feuille de route. Les initiatives sont traduites en jalons temporels et arrimées aux opérations courantes. La feuille de route est réaliste, progressive et accompagnée d’un plan de ressources.
- Réaliser et ajuster en continu. La mise en œuvre s’appuie sur un système de gestion robuste, qui permet de suivre les résultats, d’ajuster les actions et de maintenir l’alignement entre la stratégie et les opérations.
Cette démarche n’est pas linéaire. Il faut parfois revenir en arrière pour réajuster la vision ou la stratégie. Mais elle fournit une structure claire et disciplinée qui évite l’éparpillement.
Des principes pour guider la transformation
La démarche s’appuie sur des principes directeurs stables tout au long du processus. Parmi eux:
- La santé populationnelle et la création de valeur doivent rester l’intention première, et non le déploiement d’outils ou la réorganisation des institutions.
- Agir sur l’offre et la demande simultanément, en optimisant les ressources mais aussi en réduisant la consommation évitable, notamment grâce à la prévention et à la littératie en santé.
- Intégrer le numérique dans toutes les pratiques cliniques et de gestion.
- Transférer une partie significative des ressources de l’hôpital vers les soins de proximité et les milieux de vie.
- Fixer un horizon de dix ans pour dépasser les cycles politiques.
- Impliquer activement les leaders cliniques, administratifs et la population, afin d’ancrer la transformation dans la réalité du terrain.
Ces principes ne sont pas des détails techniques, mais des choix fondamentaux qui donnent une cohérence à l’ensemble.
La transformation d’un système de santé est avant tout une aventure collective. À chaque étape, la communication joue un rôle central : expliquer la raison d’agir, partager la vision, mobiliser autour de la stratégie, clarifier la feuille de route, célébrer les résultats.
Sans adhésion des citoyens, des patients, des équipes et des partenaires, même la meilleure stratégie reste lettre morte. La communication doit être constante, transparente et inclusive.
La colonne vertébrale de la transformation
Enfin, aucune transformation ne peut réussir sans un système de gestion solide. Celui-ci permet de suivre les résultats, d’aligner les équipes, d’assurer la continuité des opérations tout en exécutant la stratégie, et d’alimenter l’amélioration continue.
C’est la colonne vertébrale de la transformation. Sans lui, les initiatives s’accumulent, mais l’impact se dilue. Avec lui, la stratégie prend vie dans les actions quotidiennes et devient durable.
Transformer un système de santé est un défi immense, mais pas insurmontable. Pour réussir, il faut rompre avec la pensée magique, adopter une démarche scientifique et disciplinée, accepter le long terme, placer l’exécution au cœur du processus et ancrer la transformation dans un système de gestion robuste.
C’est à ce prix qu’un système de santé peut réellement évoluer, non pas par petites retouches, mais par une transformation qui améliore durablement la santé et le bien-être des populations.
Une version plus détaillée de cette démarche pour transformer le système de santé est disponible dans cet énoncé de position de l’auteur.