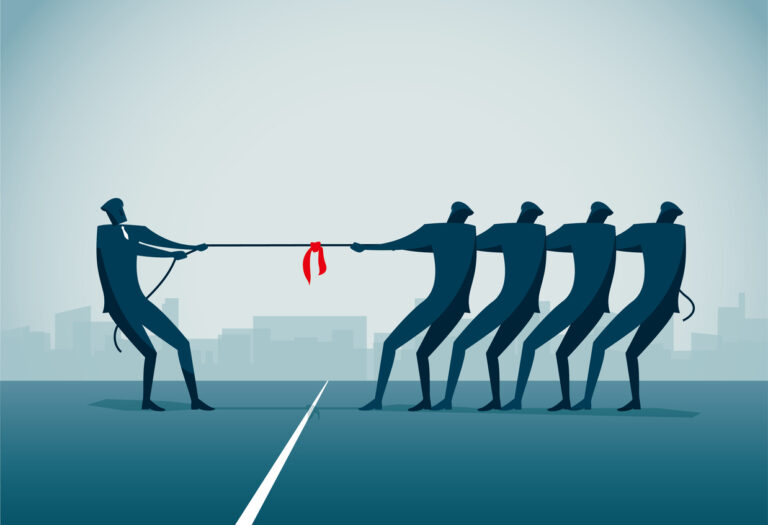La premié€re page du premier numéro d’Options politiques s’ouvrait sur ces mots : « Cette revue désire contribuer aÌ€ la réflexion sur tous les aspects des poli- tiques publiques canadiennes. Et cette note vise aÌ€ solliciter des appuis pour mener aÌ€ bien ce projet. » Je suis heureux de pouvoir dire que ces appuis, on nous les a bel et bien accordés, comme se propose de l’illustrer le présent article sur les grandes questions qui occupaient alors nos pages.
Rapidement, Options politiques a suscité un intéré‚t bien supérieur aÌ€ tous nos espoirs. Des spécialistes étroitement mé‚lés aux affaires publiques ont trouvé le temps de produire des textes adaptés aÌ€ notre tribune et portant sur les grands enjeux de l’époque. C’est graÌ‚ce aÌ€ eux que la revue a gagné la crédibilité indispensable aÌ€ son expansion.
Mais cette expansion reposait aussi sur d’autres exigences. La déclaration liminaire du premier numéro précisait la néces- sité « d’aller plus loin qu’un simple éclairage sur les questions d’intéré‚t immédiat ». Options politiques voulait proposer de nouvelles orientations et pressentir les questions dont l’im- portance se confirmerait aÌ€ long terme. Ce que nos collabora- teurs plus expérimentés ont su faire certes. Mais aussi et surtout les chercheurs moins connus, des jeunes souvent, impatients de faire valoir des idées qui sortaient parfois des sentiers battus.
AÌ€ propos du déficit démocratique, par exemple. Comme nous le verrons plus loin, des auteurs réputés ont préconisé d’élire les sénateurs et d’améliorer le processus parlementaire. Mais c’est un candidat au doctorat qui a le premier signalé la nécessité d’une réforme plus fondamentale. Eric Mintz a soumis un article clé sur le financement des courses aÌ€ la chef- ferie, qui rapportait que « plusieurs candidats aÌ€ la direction du Parti conservateur auraient dépensé plus d’un demi-million de dollars lors de la campagne de 1983 ». Un bond specta- culaire par rapport aÌ€ la génération précédente. Mais il a fallu que ces dépenses atteignent les sommets vertigineux de la dernié€re campagne pour qu’une loi vienne limiter « la dépen- dance de nos principaux partis aÌ€ l’égard des grandes entre- prises ». Le jeune auteur exhortait aussi les partis aÌ€ dénoyauter la sélection des délégués aux congré€s en mobilisant mieux leur base, de manié€re aÌ€ « freiner la tendance des chefs aÌ€ imposer leur domination ». Une mesure qui devrait aujour- d’hui encore figurer au programme des partis.
Du développement de la petite enfance au Nunavut, nos jeunes collaborateurs ont ainsi fait preuve de perspicacité sur plusieurs sujets. Et c’est aÌ€ un autre candidat au doctorat, Duncan Matheson, que l’on doit l’article le plus pénétrant sur les questions de politique sociale. Il y proposait de rem- placer le systé€me de partage des couÌ‚ts du Régime d’assistance publique du Canada par une division des fonctions, Ottawa fournissant directement tous les programmes de soutien du revenu et les provinces, aidées seulement de la péréquation pour les plus pauvres d’entre elles, s’occupant de la livraison des services.
Au début, les ambitions de la revue étaient inversement proportionnelles aÌ€ ses ressources. D’abord trimestrielle, sa parution est bientoÌ‚t devenue bimestrielle. Mais ses pages étaient moins nombreuses et sa présentation graphique beaucoup plus sommaire. C’est depuis 1985 seulement qu’elle paraiÌ‚t au rythme presque mensuel d’aujourd’hui. Ce bilan des années 1980 aÌ€ 1984 porte donc sur les 27 numéros des cinq premiers volumes.
La période s’ouvre alors que le fugitif gouvernement Clark vient d’é‚tre remplacé par ce qui sera le dernier gouverne- ment Trudeau, et s’aché€ve peu apré€s l’élection des conserva- teurs de Brian Mulroney. Entre-temps, la récession économique de 1981-1982 provoquera un choÌ‚mage jamais vu depuis la dépression des années 1930, accompagné d’une forte inflation toutefois moins marquée que dans la précé- dente décennie. Dans l’actualité internationale, il était surtout question de stagflation, de thatchérisme et de reaganisme.
Les questions économiques et sociales ne tenaient pour- tant pas le haut du pavé. C’est le référendum québécois de mai 1980 qui façonnait surtout la vie politique canadienne. Les Québécois avaient rejeté la sou- veraineté-association, mais le reste du pays était sorti de sa léthargie constitu- tionnelle. L’onde de choc perdura jusqu’en 1992 quand la population, lasse d’entendre parler de constitution, causa une certaine frayeur aÌ€ la classe politique en rejetant l’Accord de Charlottetown par voie de référendum.
Dirigés par Claude Ryan, les fédéralistes n’auraient pas obtenu un tel triomphe lors du référendum de 1980 s’ils avaient proposé le statu quo constitutionnel en échange de la sépa- ration. Aiguillonnés par Ottawa, ils avaient promis de renouveler le fédéra- lisme. Personne n’avait aÌ€ l’époque plus d’expérience des négociations constitu- tionnelles que Gordon Robertson, auteur du principal article de notre deuxié€me numéro. Il s’agissait d’un vibrant plaidoyer en faveur du renou- vellement du fédéralisme, un projet qui semblait encore réalisable.
Une fois réélu, Pierre Elliott Trudeau donnera ainsi priorité aÌ€ la réforme constitutionnelle. Sa proposi- tion initiale s’étant heurtée aÌ€ une vive opposition, et non seulement au Québec, il suggérera un temps d’aller de l’avant sans l’accord des provinces. Pour cela, mais aussi pour de nombreux autres aspects de cette proposition, il sera rudement pris aÌ€ partie par l’émi- nent juriste J. V. Clyne qui, dans notre premier numéro de 1981, préconisait de véritables délibérations dans le cadre d’une assemblée constitutionnelle. En guise de compromis, le premier mi- nistre tiendra des audiences parlemen- taires et entreprendra d’intenses négociations avec les provinces, qui donneront lieu aÌ€ un accord que le Québec ne signera pas.
Dans nos pages, Claude Morin exprimera avec force le point de vue indépendantiste sur cet accord : en trahissant le Québec, les neuf provinces signataires avaient confirmé que le Canada anglais n’accepterait jamais un projet de constitution qui soit accep- table aux Québécois. Moins furieux qu’attristé, Claude Ryan réaffirmera de son coÌ‚té que l’isolement du Québec ne cesserait qu’avec la pleine reconnaissance de son caracté€re distinct au sein de la dualité canadienne. Arthur Tremblay (l’un des discrets architectes de la Révolution tranquille) en appellera aÌ€ la réparation des torts et au colmatage de la bré€che constitution- nelle. Tout comme Robert Stanfield. Autant d’appels qui annonçaient les négociations subséquentes des accords du lac Meech et de Charlottetown visant aÌ€ réintégrer le Québec dans la constitution.
Comme en témoignent les numéros de l’époque, beaucoup soutenaient alors qu’un Sénat élu amoindrirait les tensions liées aÌ€ la diversité canadienne en donnant plus de poids aux régions. Dans un second article, J. V. Clyne avait formulé une proposition particulié€rement détaillée. Elle consistait aÌ€ élire presque tous les sénateurs pour six ans, par scrutin aÌ€ vote unique transférable et dans des circonscriptions provinciales pluri- nominales, la moitié de ces élus se reti- rant aÌ€ intervalles de trois ans. Chaque province pouvait en outre nommer un sénateur de son choix qui serait de fait son délégué aÌ€ Ottawa.
Pour Gordon Robertson, un Sénat élu était un moyen réaliste d’accom- plir le renouvellement promis en 1980, puis refusé deux ans plus tard. Il proposa cette mesure spéciale : toute loi d’importance en matié€re linguis- tique ou culturelle devait obtenir l’approbation d’une double majorité du Sénat, soit d’une majorité des séna- teurs aussi bien francophones qu’an- glophones. En lui conférant certains autres pouvoirs comme celui d’ap- prouver les nominations aÌ€ la Cour supré‚me, un Sénat élu réduirait aÌ€ la fois l’isolement du Québec et l’aliéna- tion de l’Ouest.
Royce Frith, alors sénateur désigné, se prononça pour la réforme et suggéra d’élire lors du scrutin initial la moitié des séna- teurs pour un mandat de cinq ans. Les sénateurs en poste qui ne souhaitaient pas se porter candi- dats resteraient en fonction jusqu’au deuxié€me scrutin, qui marquerait le début de leur retraite.
D’autres collaborateurs d’Options politiques préconisaient un Sénat élu, mais certains se montraient scep- tiques. Robert Stanfield les renvoya dos aÌ€ dos. Au Canada, la particularité de l’exercice des pouvoirs résidait selon lui dans la nécessité de concilier politiques nationales et préoccupations régionales. Nul doute qu’un Sénat élu favoriserait cet équilibre, aÌ€ condition que sa compo- sition et ses pouvoirs satisfassent le Québec autant que les provinces de l’Ouest. Cela étant peu probable, mieux valait tenter une conciliation aÌ€ partir des institutions existantes. Un roÌ‚le tout désigné pour les partis politiques nationaux, que le Parti libéral avait d’ailleurs rempli jusqu’aÌ€ ce Pierre Elliott Trudeau s’alié€ne l’ouest du pays. Quant au Parti conservateur, il lui manquait encore une véritable influence au Québec. C’est ainsi que nos lecteurs ont eu droit aÌ€ une analyse limpide de la stratégie qui allait bientoÌ‚t valoir au parti de Brian Mulroney ses deux mandates consécutifs.
Mais c’est un éminent libéral terre- neuvien qui assignera le plus ferme- ment aux partis politiques la responsabilité de concilier politique nationale et diversité régionale. Réputé pour son sens historique, Ed Roberts les enjoindra de démanteler les belles machines centralisatrices qu’ils avaient mises au point pour décourager leurs militants soucieux d’intéré‚ts aÌ€ la fois nationaux et régionaux.
DéjaÌ€, les observateurs s’inquiétaient de la coupure entre la population et les partis. Alec Corry, sans doute le politologue le plus réputé de l’époque, parlait dans notre premier numéro de « la confiance en chute libre de la po- pulation aÌ€ l’endroit du gouverne- ment ». Dans le suivant, sept politiciens et commentateurs dressaient le bilan de l’élection de 1980. Résumant le senti- ment général, le conservateur Michael Meighen y estimait qu’elle n’avait fait qu’enliser le pays. David MacDonald écrivait, lui, que les subterfuges avaient triomphé de la substance parce que « nos pratiques gouvernementales sus- citent désespoir et aliénation » parmi la population. Sa conclusion, toujours d’actualité : « La leçon aÌ€ en tirer réside dans une réforme parlementaire. »
D’autres textes ont souligné l’inca- pacité grandissante des partis de s’ouvrir aÌ€ la population. Pour remédier au pro- blé€me, on proposait notamment de modifier la procédure parlementaire afin d’étoffer le roÌ‚le des députés face aÌ€ leurs patrons. Trois articles de Paul Thomas, de l’Université du Manitoba, préconisaient des mesures singulié€rement énergiques. Gordon Gibson saluait pour sa part la montée des groupes d’intéré‚t particulier, attribuée aÌ€ la nécessité pour les gens de se rassembler quand le systé€me poli- tique leur déniait toute influence, et que, de mon coÌ‚té, je l’attribuais plutoÌ‚t au délabrement des partis. Je préconi- sais de réduire la taille des cabinets, de renforcer le roÌ‚le des simples députés, d’abréger les campagnes électorales et d’amorcer aÌ€ tout le moins une réforme du mode de scrutin en adoptant le vote unique transférable sous un régime de circonscription uninominale.
Sur certaines questions de l’actua- lité d’aujourd’hui, Options poli- tiques trouvait peu aÌ€ dire aÌ€ ses débuts. Un silence particulié€rement éloquent au chapitre des politiques sociales. Selon toute vraisemblance, les pro- grammes des années 1960 recueil- laient toujours l’assentiment général au tournant des années 1980. On n’y trouvait aÌ€ peu pré€s rien non plus sur les régimes de retraite. Sous la plume de Claude Castonguay et de Nicole Schwartz-Morgan, la solution au problé€me du vieillissement se limitait aÌ€ assouplir l’aÌ‚ge de la retraite et aÌ€ va- rier les activités offertes aux retraités.
De mé‚me, les articles sur la santé n’avaient rien d’alarmiste et traitaient surtout de questions immédiates. On préconisait de modifier la rémunéra- tion aÌ€ l’acte de manié€re aÌ€ favoriser une médecine de groupe. Ou de briser le monopole des médecins sur les soins de premié€re ligne afin d’élargir le roÌ‚le du personnel infirmier. On y documentait le lien entre faibles revenus et problé€mes de santé, ainsi que l’effet sur la santé de la pollution et des mauvaises conditions de tra- vail. Daniel Cappon dénonça plus vivement les politiques de santé axées sur la guérison plutoÌ‚t que la préven- tion, tandis que Shirley Post se prononça clairement pour des pro- grammes de santé de l’enfant centrés sur les soins préventifs.
Un texte solide plaidait en faveur d’un programme en santé et en éduca- tion aupré€s de la petite enfance et exhortait Ottawa aÌ€ en planifier le financement sans plus tergiverser. Certains articles comme celui de Florence Bird annonçaient des progré€s sociaux aÌ€ venir. Deux articles portaient sur l’acceptation de la nouvelle diversité des rapports familiaux. Plusieurs évo- quaient avant l’heure la nécessité d’étendre la portée de l’action des organisations bénévoles. Un autre prévoyait la montée du « pouvoir gris » dans une société vieillissante. Témoignant de l’influence de la jeunesse, une analyse de la dépénalisa- tion des drogues douces jugeait possible une réforme ne retenant que l’accusa- tion de possession, passible d’une amende et non d’une peine de prison.
Les textes porteurs des attentes les plus élevées traitaient de la question autochtone. Des attentes malheureuse- ment déçues, bien que l’article de Peter Jull, intitulé « Next Steps for Nunavut » et publié en 1982, fasse figure d’exception.
Le contenu d’Options politiques traduisait clairement les répercus- sions de la mise en commun opérée en 1977 des transferts fédéraux en santé et en éducation postsecondaire. Tré€s vite, les provinces ont privilégié les services de santé plutoÌ‚t que les universités. De sorte que, pour une bré€ve période, l’é- ducation a constitué l’aspect le plus litigieux des relations financié€res fédérales-provinciales. Les universités « sont aÌ€ la fois assiégées et démora- lisées », disait un article. Plus optimiste, John Graham soutenait qu’elles se porteraient mieux sans subventions de fonctionnement, avec des droits de sco- larité plus élevés mais aÌ€ condition qu’ils soient compensés par une aide finan- cié€re assurant aux étudiants un accé€s correspondant aÌ€ leur capacité de payer.
Nos premiers numéros ne trahissent aucune inquiétude parti- culié€re aÌ€ propos du fédéralisme exécutif. Au contraire, plusieurs auteurs y sug- géraient la création d’agences mixtes. L’un d’eux a mé‚me anticipé le Conseil de la fédération en proposant une « Chambre des provinces » ayant son propre secrétariat. Le député libéral Herb Breau voulait assortir de conditions plus strictes le financement fédéral des pro- grammes provinciaux, ce qui fut fait. Donald Savoie rappelait pour sa part la nature fondamentalement politique des relations fédérales-provinciales. Un col- laborateur au moins, Edward McWhin- ney, recommandait d’accroiÌ‚tre le roÌ‚le des municipalités dans le systé€me fédéral, envisageant mé‚me un statut provincial pour les grandes villes.
Huit importants collaborateurs ont affiché leurs différends sur un thé€me aujourd’hui moins débattu, celui de la bureaucratie. Flora MacDonald, ministre des Affaires étrangé€res du gou- vernement Clark, ouvrit le bal avec une critique des manœuvres servant aux hauts fonctionnaires aÌ€ monopoliser le roÌ‚le de conseiller. Elle leur reprochait moins leur partialité que leur résistance au changement quand il était question de modifier les politiques qu’ils avaient contribué aÌ€ façonner. C’est ainsi que pour un nouveau gouvernement, la bureaucratie venait selon elle affaiblir la démocratie.
Mitchell Sharp soutenait au con- traire que tout gouvernement devait pouvoir compter sur une continuité assurée par des spécialistes familiers des questions courantes et de l’administra- tion. Dans cet esprit, Kenneth Kernaghan exhorta en 1984 le nou- veau gouvernement Mulroney aÌ€ préserver une fonction publique impartiale et indépendante. Mais Hugh Segal estimait qu’on subvertis- sait la démocratie en maintenant aÌ€ un sommet d’influence et de pouvoir une élite de fonctionnaires indélogeables. Il proposait que les sous-ministres soient tenus d’offrir leur démission lors de l’élection d’un nouveau gou- vernement, aÌ€ qui il reviendrait d’en disposer. Enfin, Tom d’Aquino formula un compromis consistant aÌ€ protéger les postes des fonctionnaires tout en permettant aux ministres de s’entourer d’un important personnel de leur choix. Pour le meilleur ou pour le pire, c’est la formule appliquée de nos jours.
Ted Hodgetts livra une pénétrante analyse du dilemme des sous-ministres. Gordon Robertson insista sur le devoir d’anonymat. Mais c’est aÌ€ J. L. Granatstein que revient la palme de l’intuition, son texte intitulé «Once but not Future Kings » expliquant pourquoi la question retiendrait moins l’attention vingt ans plus tard. Pendant la guerre et les décen- nies suivantes, observait-il, un petit « mandarinat » avait régné sur la forte expansion des affaires gouvernementales. Puis on avait assisté aÌ€ « une explosion massive de l’appareil gouvernemental ». Or, lorsqu’ils sont en tré€s grand nombre, les hauts fonctionnaires voient inévitablement s’affaiblir leur influence individuelle. C’est ce qui explique, du moins en partie, que leurs liens avec les ministres n’attirent aujourd’hui l’atten- tion qu’en cas d’abus flagrants.
Pendant les dix années du that- chérisme, Options politiques a réservé une attention soutenue au rapport entre gouvernement et économie de marché. Maurice Strong en a fait un judicieux compte rendu. Toutes les économies, notait-il, combinent secteurs public et privé de diverses manié€res. Les politiques budgétaires et monétaires étaient déci- sives dans l’établissement du contexte commercial ; aux EÌtats-Unis surtout, les dépenses des secteurs militaire et spatial déterminaient grandement l’activité industrielle. Et « dans la Chine d’aujour- d’hui [il y a donc 21 ans], un vaste débat est en cours sur le roÌ‚le de l’investissement privé dans la modernisation du pays ». Au Canada, l’« orientation stratégique de l’économie » devait privilégier l’apport de fonds propres en cas d’insuffisance du capital privé, ce qui nous permettrait de créer « une combinaison public-privé dynamique et pragmatique offrant au monde l’exemple d’une société pluraliste prospé€re ».
Nous avons publié sur ce thé€me des analyses de gauche comme de droite. Deux articles ont traité de l’opportunité de privatiser les sociétés d’EÌtat. Tirant les leçons de l’expérience britannique, Tom Kierans concluait que les privatisa- tions sont globalement avantageuses mais qu’elles doivent donner lieu aÌ€ une véritable concurrence.
L’autre article refusait tout compro- mis, qualifiant mé‚me le mot privatisa- tion d’impropre. Le démanté€lement des sociétés d’EÌtat consistait en réalité aÌ€ « émettre des titres dans le public » en transférant des actions des « mains privées du gouvernement » aÌ€ celles d’un « investisseur public national ». Dans les transports et d’autres secteurs commer- ciaux, certaines expansions de sociétés d’EÌtat fédérales et provinciales s’étaient d’ailleurs révélées « injustifiées ». Elles fai- saient une concurrence déloyale aÌ€ l’en- treprise privée au risque de créer un « impérialisme du secteur public ». L’auteur, PDG d’une société de transport maritime, ferait le saut en politique en 1988. C’était Paul Martin.
Les analyses de politique macro- économique traduisaient une confusion propre aÌ€ l’époque. Malgré la récession, le taux d’inflation n’at- teignit 12 p. 100 qu’en 1981 et dépas- sait toujours les 4 p. 100 en 1984. Les déficits gouvernementaux étaient en hausse constante, mais leurs répercus- sions sur l’économie étaient contrecar- rées par une gestion monétaire serrée et l’incertitude qui s’ensuivait en matié€re d’investissement.
C’est ce phénomé€ne de stagflation qui mobilisa surtout les économistes col- laborant aÌ€ la revue, soucieux de concilier création d’emplois et stabilisation des prix. Aucun ne souhaitait vraiment renouer avec l’expérience du controÌ‚le des prix et des salaires de Pierre Elliott Trudeau. La solution avancée le plus sou- vent consistait aÌ€ établir une politique de revenus prévoyant des incitations fis- cales. Les prix resteraient l’affaire du marché, les salaires relevant de la négo- ciation collective. Mais au-delaÌ€ d’un niveau préétabli, les augmentations de salaires seraient soumises aÌ€ un impoÌ‚t spé- cial versé par les entreprises qui les accor- dent, les salariés eux-mé‚mes ou les deux. Et pour plus d’équité, les hausses de ren- dement du capital seraient imposées de façon correspondante. Parmi les adeptes d’une telle politique de revenus, c’est Walter Gordon et John McCallum (alors professeur d’économie et non homme politique), qui ont le plus vivement cri- tiqué le monétarisme de l’époque.
Comme en témoigne le contenu d’Options politiques, les Canadiens étaient moins préoccupés de la situa- tion mondiale. L’aide aux pays en voie de développement était le seul domaine de politique étrangé€re aÌ€ recevoir plus d’attention que dans la période récente. Sur ce thé€me, le texte le plus convain- cant soutenait qu’il était de l’intéré‚t des pays industrialisés d’accroiÌ‚tre leur aide au Tiers-monde mais aussi d’ouvrir leur marché aÌ€ ses produits, de manié€re aÌ€ mieux protéger le cours des denrées et aÌ€ étendre l’accé€s aux technologies et aux capitaux d’investissement. L’article était signé Pierre Elliott Trudeau.
Certains articles présageaient l’importance que prendraient aÌ€ l’échelle mon- diale la protection de l’environnement et la conservation des ressources, l’immi- nente transformation des économies d’Asie et la croissance du secteur des ser- vices comme moteur de la mondialisa- tion. Il suffirait par ailleurs de remplacer un n par un k pour actualiser cette phrase d’un article de George Ignatieff publié en 1981 : « Comme nous l’avons vu (…) surtout en Iran, l’usage de la force militaire aÌ€ des fins politiques est tou- jours inefficace. »
Pour ce qui est de nos liens avec les EÌtats-Unis, les numéros de l’époque indiquent bien qu’ils portaient sur le commerce et l’investissement, loin devant la diplomatie et la défense. Nos collaborateurs partageaient trois points de vue. Ils étaient en principe favorables au libre-échange multilatéral, ils s’inquié- taient de la compétitivité du Canada et se montraient impressionnés par le marché commun européen. Ted English étudia en 1980 différents regroupements com- merciaux, soulevant la possibilité d’une zone de libre-échange canado-américaine mais reconnaissant qu’il serait préférable d’y intégrer d’autres partenaires, tout en spéculant avec audace sur une « zone du Pacifique » qui engloberait le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée et le Mexique.
L’étude de ce grand concept s’arré‚- ta laÌ€, les articles subséquents portant surtout sur une entente avec les EÌtats- Unis. Sans toutefois prévoir ce qui s’annonçait. Rares étaient en effet les propositions d’accord général. Mais Darcy McKeough, fort de ses anciennes fonctions de trésorier et de ministre de l’EÌconomie de l’Ontario, affirma sans détour : « Passons aux choses sérieuses aÌ€ propos du libre-échange sectoriel. Déterminons dans quels secteurs réduire ou éliminer les barrié€res aÌ€ l’a- vantage réciproque du Canada et des EÌtats-Unis. » Dans la foulée, Pierre- Paul Proulx (l’un des rédacteurs du fameux « Livre beige » des fédéralistes québécois) préconisa « une intégration et une harmonisation » sectorielles, mé‚me si le libre-échange comme tel « n’est pas une option aÌ€ envisager du point de vue canadien ».
Irving Brecher proposa bien « un espace de libre-échange avec les EÌtats- Unis pour les biens et services », aÌ€ met- tre en place « aussi rapidement que possible ». Mais personne n’imaginait qu’en désespoir de cause, on négocierait un jour une entente globale sur les importations canadiennes qui laisserait aux EÌtats-Unis la liberté d’imposer les restrictions protectionnistes exigées par un groupe de pression… Celui du bois d’œuvre, par exemple.
Dé€s le départ, nos propositions différaient sur un autre aspect clé. Elles portaient sur le commerce sans prévoir une pleine libéralisation des investissements. Plusieurs articles cri- tiquaient en fait le processus qui soumettait alors les investissements étrangers aÌ€ un controÌ‚le aussi tatillon qu’inefficace. Roy Davidson, notam- ment, réclamait l’abolition de toute restriction de nouvelles entreprises étrangé€res mais un controÌ‚le sur les reprises de sociétés canadiennes. D’autres, Tom Kierans en particulier, allaient plus loin en rejetant tout nationalisme économique. Mais les numéros de la premié€re période ne laissent rien entrevoir de la forte inté- gration des investissements trans- frontaliers qui se produirait bientoÌ‚t.
Malgré leur myopie en certains domaines, ce compte rendu aura montré que nos collaborateurs ont dé€s le début traité la plupart des questions d’actualité dans une perspective aÌ€ long terme. Cette capacité de l’IRPP de leur offrir cette tribune fait justement foi de sa riche contribution aÌ€ l’identité démo- cratique du Canada. Car un pays dont la population se répartit sur un continent aussi immense, et dont le voisin immé- diat est le géant que l’on sait, a peu de chances d’é‚tre aussi bien servi par ses médias privés que ne le sont par exem- ple les pays d’Europe occidentale.
Cet élément majeur de notre déficit démocratique a fait l’objet de plusieurs articles signés par des représentants de la presse écrite et électronique. Mais c’est aÌ€ l’avocat Gordon Fairweather, ancien politicien conservateur devenu commis- saire en chef de la Commission cana- dienne des droits de la personne, que l’on doit la contribution la plus impor- tante aÌ€ cet égard. Il croyait la liberté d’opinion entravée par l’indif- férence des grands propriétaires de médias aÌ€ l’égard de leurs respon- sabilités publiques. Notre nouvelle constitution ayant consacré des précédents juridiques qui donnent toute compétence au Parlement fédéral, ajoutait-il, celui-ci devrait légiférer pour assurer la diversité des sources d’information et d’opinion.
Si jamais ce conseil était mis en pratique, Options politiques pourrait se spécialiser franchement en analyse et en conception de politiques publiques. Comme toute société fondamentalement libre devrait le per- mettre. Mais notre tribune doit plutoÌ‚t s’enrichir d’une variété de contributions. Elle doit servir aÌ€ tous, avant tout aux médias et aux partis, aÌ€ transmettre une information de premier plan de mé‚me qu’aÌ€ diversifier les points de vue sur les affaires publiques par rapport aÌ€ ce que les gens ont l’habitude de voir, de lire et d’entendre. Moins les médias jouent leur roÌ‚le et moins les partis suivent une ligne de conduite claire, plus l’importance d’Options politiques est décisive pour éclairer et dynamiser le débat politique. (Article traduit de l’anglais)