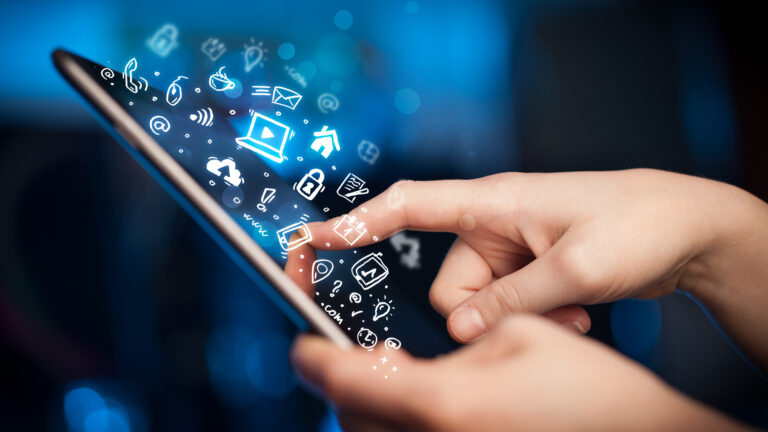Cet article fait partie de notre série Réfléchir ensemble à l’unité nationale, réalisée dans le cadre des 30 ans du référendum québécois.
Qui aurait cru il y a dix ans que la question de la souveraineté reviendrait au-devant de la scène politique québécoise ? À ce moment, le Parti québécois (PQ) ne faisait que décliner progressivement dans les sondages depuis le second référendum de 1995.
En 1998, il obtenait l’appui de 43 % des électeurs. En 2008, cet appui était de 35 % et, en 2018, il n’était que de 17 %. Aux élections générales de 2022, le PQ a recueilli 15 % des voix et seulement trois sièges, le pire score de son histoire. La menace à l’unité canadienne s’est alors dissipée. Le projet d’un nouveau référendum a disparu de l’écran radar et le dossier constitutionnel semblait clos.
Une cause dissociée de son véhicule
Or, depuis presque deux ans, le PQ est à nouveau premier dans les sondages — à 35 %, une avance de 9 points de pourcentage sur les libéraux — et un nouveau référendum est à l’agenda ! Et le projet souverainiste semble avoir à nouveau le vent dans les voiles.
Ce qui est fascinant, c’est que, malgré les hauts et les bas du PQ, l’appui à la souveraineté (36 %) est resté relativement stable depuis 20 ans, comme si le véhicule et la cause s’étaient peu à peu distingués l’un de l’autre.
Entre les irréductibles souverainistes et les fédéralistes convaincus, il y a le camp des ambivalents. Ils penchent tantôt du côté des souverainistes, comme lors du scandale des commandites, en 2005, et tantôt du côté des fédéralistes. Ce sont eux qui ont formé la base électorale de la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault au cours des dix dernières années.
A la fois souverainistes et fédéralistes, ces ambivalents sont « quantiques », pourrions-nous dire. Voilà qui peut expliquer le fait que les Québécois étaient nombreux à admirer à la fois René Lévesque et Pierre Trudeau, pourtant antinomiques. Cette même ambivalence justifiait qu’on propose des formules hybrides, voire ambiguës de statut pour le Québec. En 1980, ce fut la souveraineté-association et, en 1995, la souveraineté-partenariat.
Les fondements tiennent toujours
C’est encore la réaction des ambivalents qui explique les fluctuations de la souveraineté depuis 1960, notamment après et en réaction à l’échec de Meech. Puis, à la suite de l’échec référendaire de 1995, ils ont seulement mis leur nationalisme en dormance. Le Canada anglais aurait tort de croire qu’ils sont devenus de fervents fédéralistes.
La conviction souverainiste s’appuie sur des arguments fondamentaux et intemporels. Il suffit de regarder une carte pour constater que le Québec pourrait devenir un pays. Les ressources de son territoire, sa population et son économie lui permettraient de devenir indépendant.
Des fédéralistes, comme Jean Charest et Philippe Couillard l’ont reconnu. Le droit international et de nombreux exemples valident cette possibilité. La Cour suprême a reconnu ce droit. Et Robert Bourassa a été éloquent à ce sujet dans son discours qui a fait histoire lors du rejet de l’Accord du lac Meech, le 22 juin 1990 :
« Le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que, quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement. »
Après tout, le Québec est une nation, avec une langue, une culture, une identité distincte, ce que le Parlement fédéral a lui-même aussi reconnu.
D’un idéal à un désir majoritaire
La question qui doit maintenant habiter les stratèges du PQ est la suivante : comment transformer cet idéal légitime et possible en un désir majoritaire et une volonté ferme et partagée ? Comment faire basculer les ambivalents ?
Car l’avance du PQ ne doit pas faire illusion. Sa remontée s’explique surtout par l’usure du pouvoir de François Legault, les fiascos de certains dossiers, la lente et difficile reconstruction du Parti libéral et la chute de Québec solidaire, miné par des conflits internes. Ce n’est pas son projet qui a provoqué sa résurrection.
Dans un horizon de quelques années, soit celui d’un prochain mandat, le PQ peut-il faire avancer son projet de souveraineté suffisamment pour gagner un troisième référendum ? Rien n’est moins sûr! Cinq défis d’envergure se dressent sur son chemin :
1. Les enjeux du présent. Comment rattacher la question constitutionnelle aux préoccupations actuelles des Québécois ? Plus concrètement, que changerait la souveraineté en matière d’environnement, d’inflation ou d’intelligence artificielle ?
La preuve n’est pas impossible, mais elle reste à faire. Parmi les enjeux les plus importants de l’heure, plusieurs relèvent exclusivement, ou du moins largement, des compétences provinciales, comme la santé, le logement ou l’éducation. Comment démontrer que la souveraineté, sans être une « baguette magique », changera la donne dans ces dossiers ? C’est un défi majeur pour le PQ.
2. La crise du modèle québécois. Le socle de la souveraineté, fondé sur un État très interventionniste, est fragilisé. Or comme l’a écrit l’économiste Pierre Fortin en 2011 : « Nos sentiments envers l’État québécois se sont considérablement refroidis avec le temps. En 1960, l’État était porteur de tous nos espoirs. Aujourd’hui, devenu omniprésent, il est source de beaucoup de frustrations. »
Augmenter les pouvoirs de l’État québécois ne fait plus rêver. En 1995, il semblait encore un levier positif. Ce n’est plus le cas : l’État québécois est aujourd’hui sur la sellette : déficit, dette publique, services publics défaillants, lenteurs bureaucratiques, gestion catastrophique de certains dossiers.
Les Québécois ne sont plus sûrs d’être bien gouvernés par eux-mêmes. « À quoi bon avoir tous les pouvoirs ? », diront certains. Le deuxième grand défi pour les indépendantistes sera de contrer cette méfiance fondamentale, qui représente une tendance lourde. Là encore, rien n’est évident.
3. Les racines de la cause souverainiste. Pendant les années 1960 et 1970, quand les baby-boomers sont devenus adultes, les Québécois francophones étaient encore manifestement défavorisés. Plus pauvres, moins scolarisés, absents des conseils d’administration, locataires.
Félix Leclerc le chantait en 1972 :
J’ai un fils dépouillé / Comme le fut son père / Porteur d’eau, scieur de bois / Locataire et chômeur / Dans son propre pays / Il ne lui reste plus / Qu’la belle vue sur le fleuve.
Cet état poétiquement résumé n’est plus là. À l’intérieur du cadre canadien, en utilisant les compétences provinciales qu’il s’était refusé à utiliser pendant la première moitié du XXe siècle, le Québec a quasi fait disparaître l’infériorité économique des francophones. Les « raisins de la colère », qui alimentaient la volonté de changement, ne sont plus là.
4. Les assises du nationalisme québécois. L’identité, la culture et la langue française sont en péril : la chanson, le cinéma et les séries québécoises sont ignorés ou boudés. L’histoire nationale apparaît suspecte envers les Premières Nations et certaines minorités. Plusieurs estiment que le territoire leur a été « volé ». Certains croient même que, collectivement, les Québécois devraient avoir honte de leur passé colonial.
Plusieurs voient du « racisme systémique » au cœur des institutions. Pour eux, les minorités sont les nouveaux « porteurs d’eau » et sont plus vulnérables que la majorité blanche. Mais il y a plus. Des francophones n’hésitent pas à parler en anglais au quotidien. Aussi, leur poids démographique ne cesse de diminuer.
Comment le PQ parviendra-t-il, en quelques années, à contrer ces tendances lourdes et endogènes, créer une fierté nationale et nourrir une volonté ferme de bâtir un Québec indépendant ?
5. Les enjeux géopolitiques. Le dernier défi concerne les secousses géopolitiques causées par la réélection de Donald Trump. Même si le mandat du président américain doit se terminer en janvier 2029, les tarifs qu’il a imposés et le repli commercial des États-Unis pourraient perdurer. La montée du protectionnisme est manifeste également ailleurs.
Cette question n’est pas négligeable. Si Bernard Landry et Jacques Parizeau défendaient avec ardeur le libre-échange et l’ouverture des marchés, c’est qu’ils estimaient qu’un territoire politique plus restreint ne limiterait aucunement les échanges et l’accès aux marchés.
Il en découle que bon nombre de Québécois, dans le contexte international actuel, préféreront demeurer au sein du Canada. Une fois de plus, seul le temps dira si cette reconfiguration s’installera durablement.
Les risques de promettre un référendum
Gagner un de ces paris n’est pas impossible, mais en gagner plusieurs en vue de créer un mouvement semble audacieux, téméraire, voire casse-gueule diront certains… même chez les souverainistes.
Maintenir la promesse de tenir un référendum dans le prochain mandat pourrait se retourner contre le PQ. Sans compter que le leader du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, parle d’indépendance, sans y accoler la notion d’association ou de partenariat. Si l’objectif a le mérite d’être clair, il est d’autant plus exigeant!
Une fois élu, le PQ serait-il capable de changer le cours de ces tendances globales afin de gagner les cœurs et les esprits ? Difficilement. De nos jours, les lunes de miel sont courtes et le pouvoir use terriblement. Convaincre, forger des consensus, ou même des majorités, est particulièrement difficile à notre époque. Les références collectives sont en recul, l’espace public est fragmenté et les autorités sont considérées avec suspicion.
Opportunités risquées et choix cornélien
La montée des nationalismes en Europe et aux États-Unis pourrait offrir de nouvelles opportunités aux leaders nationalistes québécois. Cependant, pour emprunter cette voie, plutôt marquée à droite, le PQ devrait s’aventurer sur des terrains risqués, en rupture avec une bonne part de ses supporteurs du centre-gauche.
Bien sûr, il pourrait aussi compter sur les velléités indépendantistes de l’Alberta ou sur les maladresses d’Ottawa pour voir l’échiquier canadien bouleversé. Or c’est un pari incontrôlable, d’autant que le PQ ne peut compter cette fois sur l’échec patent des réformes du fédéralisme canadien, comme Meech en 1990 et Charlottetown en 1992!
Comment Paul St-Pierre Plamondon, qui a promis un référendum et construit son image sur l’honnêteté, la franchise et la cohérence, pourrait-il abandonner sa promesse sans passer pour un politicien comme les autres ? C’est un choix cornélien.
Démocratiser l’outil référendaire
Il existe peut-être une autre voie, longtemps rejetée par les nationalistes : le référendum d’initiative populaire (RIP). Adopté depuis longtemps en Suisse, présent en Allemagne, en Italie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique et dans la plupart des États américains, ce mécanisme permet à la population de déclencher elle-même un référendum. En Alberta, cette procédure existe également. Mario Dumont l’avait proposée en 2000 dans un projet de loi qui n’a pas eu de suite.
En adoptant une telle procédure, le PQ dissocierait l’enjeu référendaire de l’enjeu partisan. Il se donnerait surtout l’assurance d’une mobilisation préalable. Ainsi, le chef du PQ pourrait rapidement se libérer de la promesse de tenir un référendum tout en promettant de démocratiser l’outil référendaire pour lui donner une portée plus générale. Redéfinie, l’option indépendantiste resterait alors possible, disponible et susceptible d’être utilisée à court, moyen ou long terme.