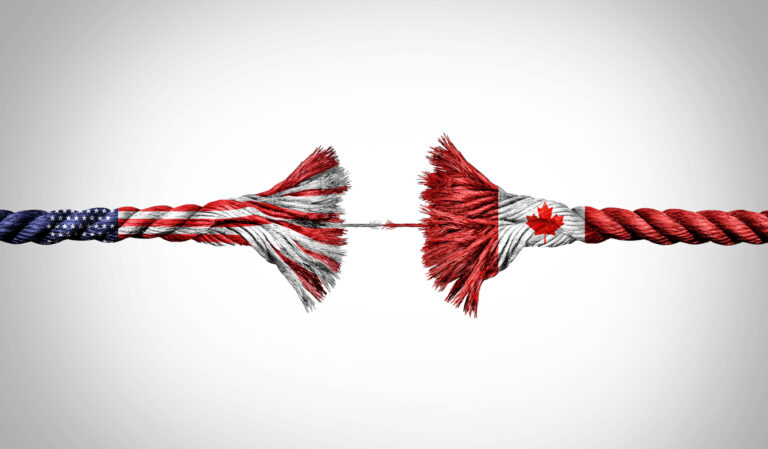(English version available here)
L’économie mondiale est en pleine mutation et les enjeux sont importants pour le Canada. Au fil des décennies, nous avons bâti une économie prospère, principalement grâce à l’exportation de produits de grande valeur comme le gaz, le pétrole, les métaux et les minéraux, ainsi que les automobiles. Tous ces produits étant principalement destinés au marché américain.
Les prochaines décennies seront toutefois marquées par l’incertitude pour tous ces secteurs et pour l’ensemble de nos relations commerciales avec les États-Unis. Les corridors d’échanges commerciaux se réorganisent et les marchés se repositionnent pour faire face à l’essor de l’intelligence artificielle (IA), aux changements climatiques, à la transition énergétique et aux droits de douane américains.
Le sort du Canada dépendra en grande partie des entreprises privées. Celles qui sauront anticiper, innover, s’adapter et se préparer adéquatement à ce qui s’en vient connaîtront la prospérité, tandis que celles qui stagnent éprouveront des difficultés.
Les gouvernements peuvent les soutenir en encourageant les choix qui sont dans notre intérêt stratégique national collectif. La politique industrielle, qui consiste pour l’État à cibler et soutenir délibérément certains secteurs d’activités pour atteindre les résultats souhaités, est un outil de plus en plus important.
Toutefois, pour remplir ses objectifs et conserver la confiance du public, la politique industrielle doit être conçue et mise en œuvre selon des normes rigoureuses. Heureusement, nous disposons d’un corpus important et croissant de recherches réalisées depuis de nombreuses d’années pour orienter les décisions. C’est primordial, car pour chaque réussite, on peut citer un exemple où la politique industrielle a mal tourné.
D’importants changements structurels
L’essor de l’IA redéfinit la compétitivité mondiale, autant pour les entreprises que pour les États. Si la création de nouveaux produits d’IA ouvre un champ de nouvelles opportunités, leur adoption à grande échelle est tout aussi cruciale, notamment dans des piliers de l’économie canadienne comme l’agriculture, le pétrole et le gaz, ou encore la construction automobile.
Comme l’a déclaré Evan Solomon, ministre canadien de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, lors d’un événement organisé à Montréal cet été, « Countries that master AI will dominate the future, you’re either part of the bulldozer or you’re part of the road. »
L’IA n’est pas le seul enjeu qui perturbera l’économie. Les changements climatiques bouleverseront les chaînes d’approvisionnement et la production de biens. Les entreprises, qui verront leurs opérations perturbées par les sécheresses, inondations, incendies et autres tempêtes extrêmes, devront veiller à sécuriser leur approvisionnement en matières premières, en eau et autres ressources.
La sylviculture, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et l’exploitation minière sont les secteurs les plus exposés aux risques climatiques matériels. Si l’on n’accélère pas l’adoption de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), les pertes pourraient atteindre 8 % du PIB mondial d’ici à 2050. Les entreprises et les pays dotés de solides stratégies d’adaptation s’en sortiront mieux que les autres.
La transition énergétique mondiale se poursuit, malgré le recul des États-Unis. Même si le rythme auquel la demande baisse ne fait pas l’unanimité, tout le monde s’accorde pour dire qu’elle suivra une trajectoire descendante jusqu’à la fin de ce siècle.
La transition pourrait se faire sans baisse progressive des prix, comme certains l’envisagent. Au contraire, elle pourrait être accompagnée d’une période prolongée de volatilité, les déséquilibres entre l’offre et la demande entraînant des hausses et des baisses de prix soudaines, qui perturberaient les producteurs de pétrole et de gaz ainsi que les consommateurs.
La vente d’énergies propres et de véhicules électriques pourraient également connaître des périodes de volatilité, les entreprises s’efforçant de prévoir la demande dans un contexte de politiques gouvernementales changeantes.
La transition énergétique entraîne des hausses de la demande dans d’autres marchés, comme celui des minéraux essentiels pour les batteries et les énergies renouvelables. Il faudra user de stratégie, compte tenu du rôle prédominant des secteurs de l’énergie et des minéraux dans notre économie.
Le coût du sous-investissement
Comprendre les tendances en cours est une chose, mais agir en conséquence en est une autre. Malheureusement, au Canada, les investissements du secteur privé dans des domaines cruciaux comme l’adoption de l’IA, l’adoption de technologies propres, la commercialisation des technologies, l’adaptation aux changements climatiques et l’exploitation des minéraux essentiels sont peu nombreux.
Sans action significative, le Canada pourrait sortir du Top 10 des économies mondiales et voir le niveau de vie de sa population décliner dans les décennies à venir.
Il serait facile de blâmer le secteur privé, mais les entreprises ont souvent de bonnes raisons de retarder leurs investissements. Celles qui sont confrontées à une relation commerciale incertaine avec les États-Unis ont peut-être raison de reporter leurs investissements dans l’automatisation ou l’adoption de l’IA. La domination de la Chine sur les marchés des minéraux essentiels maintient les prix à un niveau trop bas ou trop incertain pour stimuler des investissements majeurs dans l’exploitation minière ou la transformation.
Que peut-on faire pour surmonter les obstacles à court terme aux investissements privés qui sont dans l’intérêt national à long terme du Canada ? C’est là qu’une politique industrielle intelligente peut jouer un rôle clé.
Orienter les décisions dans l’intérêt national
Les gouvernements canadiens utilisent déjà activement la politique industrielle pour orienter les investissements privés vers certaines activités, telles que l’infrastructure commerciale, la commercialisation des technologies, le développement des minéraux essentiels ou l’adoption de technologies agricoles.
Les gouvernements utilisent des outils tels que les crédits d’impôt à l’investissement, les marchés publics ciblés, les contrats de différence, les accords d’exploitation, les prêts inférieurs au marché et bien d’autres encore. L’objectif est de réduire les obstacles qui freinent l’investissement privé dans des domaines stratégiques et de concevoir une politique qui fonctionne au moindre coût pour le contribuable.
Le recours à la politique industrielle est susceptible d’augmenter à mesure que les gouvernements cherchent à s’implanter sur les nouveaux marchés mondiaux, à retenir les entreprises à fort potentiel et à améliorer leur productivité. Mais compte tenu des enjeux, il sera essentiel que les gouvernements fassent davantage d’efforts pour s’assurer que leur politique industrielle est la bonne.
Les gouvernements canadiens pourraient s’inspirer de l’approche australienne.
Par exemple, lorsqu’il a introduit son incitation fiscale à la production de minéraux critiques, en 2024, le gouvernement a publié une étude d’impact qui a analysé le problème politique que la taxe visait à résoudre, les obstacles auxquels le secteur privé était confronté, la suffisance de l’intervention gouvernementale et la nécessité d’une intervention gouvernementale supplémentaire, ainsi qu’une analyse coûts-bénéfices de trois options politiques.
Il a également énuméré une série de paramètres pour s’assurer du succès de la politique à long terme.
Ce type de rigueur analytique et de transparence pourrait grandement contribuer à l’excellence de la politique industrielle et à l’amélioration de la confiance du public dans la capacité des gouvernements canadiens à obtenir des résultats tangibles.
Il faut une stratégie audacieuse et réfléchie
L’économie mondiale va connaître des changements structurels. Si le Canada veut conserver sa place dans le Top 10 des économies mondiales, les gouvernements deront recourir à des politiques industrielles audacieuses pour permettre aux entreprises canadiennes de saisir les occasions d’affaires.
Ces politiques doivent être réfléchies, conçues et mises en œuvre de manière rigoureuse pour atteindre leurs objectifs sans dilapider les fonds publics. L’heure n’est pas aux grandes promesses sans suite. Le Canada a besoin d’interventions politiques judicieuses et délibérées, soutenues par des analyses et des équipes compétentes pour assurer leur déploiement de manière harmonieuse.