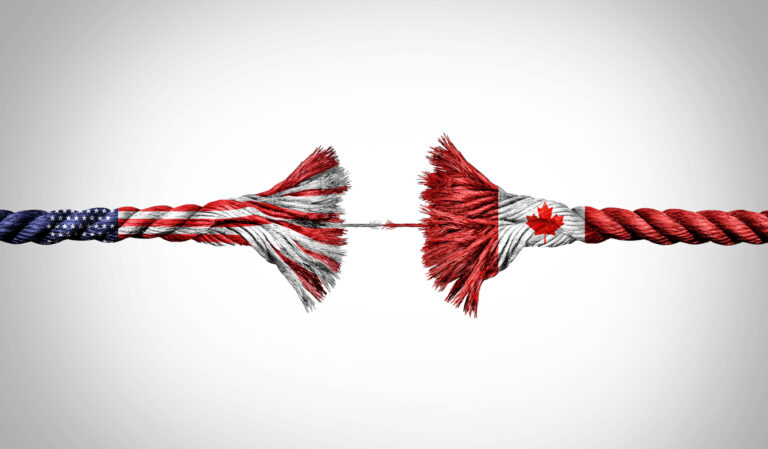Les élections québécoises de 2007 ont illustré la ten- dance aÌ€ la négativité qui s’est imposée dans les stratégies de communication depuis une dizaine d’années au Québec et au Canada. Certes, la critique de l’adversaire a toujours fait partie de la stratégie des partis politiques. Cette logique promotionnelle est inhérente au choix démocra- tique qui suppose une comparaison entre au moins deux candidats, deux partis ou deux visions du monde. Ce qui est nouveau, toutefois, c’est le dosage, l’intensité des cam- pagnes négatives.
Nous caractérisons ce phénomé€ne de spirale, parce qu’il affecte tous les protagonistes du jeu électoral. S’il est normal pour un parti d’opposition de critiquer les politiques du parti au pouvoir et de montrer tous les dangers que représenterait sa réélection, il est plus étonnant de constater que le parti gouvernemental a tendance, lui aussi, aÌ€ privilégier les attaques contre ses adversaires plutoÌ‚t que de défendre ses réalisations et de miser sur les avantages que les citoyens retireraient de sa réélection. Puisqu’un parti qui est attaqué doit riposter pour ne pas laisser s’accréditer les thé€ses des adversaires, cette dynamique engendre une spirale.
Dans Votez pour moi (1998), nous avons observé ce phénomé€ne dans les publicités télévisées des partis au Québec et au Canada. Jusqu’au début des années 1990, le discours publicitaire des partis au pouvoir privilégiait un contenu positif, alors que les partis d’opposition, conformé- ment aÌ€ leur roÌ‚le, accordaient plus d’importance aÌ€ la com- posante critique mais privilégiaient néanmoins la dimension positive pour obtenir le soutien des électeurs. Depuis, cependant, les partis gouvernementaux misent de moins en moins sur leurs réalisations pour se faire réélire et participent, eux aussi, aÌ€ la spirale de la négativité.
Les campagnes électorales récentes au Canada confirment cette tendance. Aux élections fédérales de 2004, le Parti libéral du Canada, qui était affaibli par des scandales, eut recours aÌ€ une stratégie de dénigrement dénonçant dans tous ses discours l’intolérance et l’extrémisme de son adversaire conservateur. Cette virulence fut payante, puisqu’elle permit aux libéraux d’é‚tre reportés au pouvoir. En 2006, les libéraux utilisé€rent la mé‚me recette en diffusant en anglais et en français une série de messages extré‚mement négatifs dont l’un sur fond sonore de bottes accusait les conservateurs de vouloir déployer l’ar- mée dans les villes canadiennes. Mais la redondance du procédé en réduisit l’effi- cacité, et les conservateurs réussirent aÌ€ leur tour aÌ€ former un gou- vernement minoritaire.
Pour vérifier si cette thé€se s’applique aux élections québécoises de mars 2007, nous avons analysé la stratégie discursive des trois principaux partis. Afin d’obtenir une information fiable sur la dynamique de la campagne, les enjeux traités et le contenu négatif, nous avons choisi comme indicateur les communiqués de presse émis par les partis et diffusés sur leurs sites Internet.
Une élection est avant tout une bataille pour le controÌ‚le de l’ordre du jour. Chaque parti cherche aÌ€ occu- per l’espace médiatique et aÌ€ imposer les enjeux les plus susceptibles de lui atti- rer le plus grand nombre d’électeurs. Il construit un plan de communication pour alimenter chaque jour les médias en informations qui établiront les crité€res de jugement utilisés par les électeurs pour évaluer les partis en compétition. Les communiqués con- stituent la charpente de cette opération de persuasion. Ils définissent de façon synthétique les thé€mes sur lesquels seront centrées les interventions des porte-parole des partis et sont ainsi révélateurs de leurs positionnements stratégiques. AÌ€ cet égard, le nombre moyen de communiqués émis chaque jour est un indice de l’intensité de la communication des partis.
Si on en juge par cet indicateur, le PLQ et le PQ ont mené des campagnes plus intenses que l’ADQ, puisqu’ils ont diffusé en moyenne respectivement 2,7 et 2,5 communiqués par jour com- parativement aÌ€ seulement 1,3 pour ce dernier parti. L’intensité de la commu- nication a aussi varié durant la cam- pagne, car les trois partis ont diffusé un plus grand nombre quotidien de messages avant le débat des chefs du 13 mars (PLQ: 3,0; PQ: 2,9; et ADQ: 1,6)qu’apré€s(PLQ:1,9;PQ:1,7;et ADQ : 0,7).
Pour évaluer les dimensions positives et négatives des communiqués émis par les partis, nous y avons recensé le nombre de références aux réalisations, aux offres de politiques, aux critiques des adversaires et aux annonces de candida- tures ou d’événements, un mé‚me com- muniqué pouvant contenir plusieurs types de références.
Le tableau 1 indique que les partis critiquent aussi souvent leurs adver- saires qu’ils parlent de leurs propres offres de politiques, si on tient compte des références aux réalisations passées pour les partis qui ont exercé le pouvoir. Ainsi, en exposant leur position sur un enjeu, les partis en profitent pour dénoncer l’incurie de leurs adversaires. La palme de la positivité revient aÌ€ l’ADQ, qui a plus insisté sur ses engage- ments que ne l’ont fait ses adversaires.
Le PLQ a mené sa campagne sur deux fronts en dirigeant ses attaques aÌ€ la fois contre le PQ (24) et l’ADQ (29), alors que le PQ a surtout ciblé le PLQ (31), lui réservant la presque totalité de ses cri- tiques. On pourrait en déduire que le PQ a commis une erreur stratégique en ne s’attaquant pas aux thé€ses de cet adver- saire et en ignorant la popularité crois- sante de l’ADQ dans les sondages tout au long de la campagne. L’ADQ, pour sa part, a aussi concentré ses tirs sur le PLQ (23) et s’est peu préoccupée du PQ (4).
Les libéraux ont accusé le PQ de pratiquer la désinformation, d’avoir un agenda caché, d’é‚tre hypocrite quant au gel des frais de scolarité, de présen- ter un programme truffé d’erreurs et de sombrer dans la supercherie. Ils ont attaqué l’ADQ sur le terrain de sa crédi- bilité en éducation et en santé (« Zéro priorité, zéro crédibilité »), ont qualifié ses propositions de « mal ficelées » et lui ont reproché de ne pas proposer de cadre financier(« Dumont trompe les familles québécoises »).
Le Parti québécois a dénoncé pour sa part le bilan désastreux du gouvernement Charest, son manque de courage, ses mauvaises décisions et ses promesses non tenues. Le choix du slogan « Reconstruire notre Québec » était révélateur de cette stratégie de dénonciation.
Quant aÌ€ l’ADQ, le PQ l’accuse d’entretenir des illusions sur l’au- tonomisme et dénonce le manque de réalisme de ses engagements.
Aux dires de l’ADQ, le bilan de Jean Charest et des libéraux est lamentable : le PLQ a renié ses engagements et trahi les familles. Inaction, échec, fiasco sont les mots utilisés pour caractériser le gou- vernement libéral. L’ADQ associe le PQ au PLQ dans la gestion des politiques publiques et dénonce « la langue de bois » de son programme.
On peut compléter l’analyse de la négativité de cette campagne en recen- sant le nombre de références aux partis adverses, qui sont révélateurs du niveau de conflit durant la campagne électorale (voir tableau 2).
Cet indicateur lexicométrique confirme l’analyse du contenu des communiqués et montre que la palme de la négativité revient au Parti libéral qui a surtout ciblé l’Action démocra- tique. Le Parti québécois, quant aÌ€ lui, s’est davantage attaqué au Parti libéral négligeant l’ADQ. Ce dernier a moins valorisé les attaques que ses adversaires et s’en est surtout pris au Parti libéral.
Comme l’efficacité de la communi- cation exige un message simple, les partis traitent habituellement d’un seul enjeu dans leurs communiqués de presse. Le thé€me développé est repris dans les discours du chef du parti et de ses porte-parole. L’analyse des sujets abordés dans les communiqués nous indique quels enjeux les partis ont privilégié. Pour établir cette hiérarchi- sation, nous utilisons deux indica- teurs : le nombre de communiqués traitant d’un thé€me et la fréquence des vocables clés (voir tableau 3).
Les trois partis ont privilégié les mé‚mes thé€mes avec des modulations d’intensité différentes. Le PLQ a misé sur le bilan de ses réalisations et a demandé aux électeurs de lui laisser continuer son œuvre. En santé, les libéraux ont promis d’augmenter de 1 500 le nombre de médecins et de 2 000 celui des infirmié€res ; en éduca- tion, ils ont promis de dégeler les frais de scolarité et d’injecter 200 millions de dollars par année dans les universités. Ils ont aussi annoncé des investisse- ments dans le développement des régions. Au total, les promesses libérales couÌ‚teront 4,5 milliards de dollars.
Les mesures phares de l’ADQ furent la création d’un systé€me de santé mixte, l’abolition des commis- sions scolaires, une allocation de 100 dollars par semaine pour chaque enfant en aÌ‚ge préscolaire, la récupéra- tion de tous les pouvoirs de taxation et l’instauration d’une constitution québécoise. Mario Dumont a refusé de dévoiler son cadre financier avant la présentation du budget fédéral.
Le PQ a proposé un plan d’accé€s aÌ€ la propriété pour les jeunes familles, le maintien du gel des frais de scolarité, la création de 20 000 nouvelles places en garderie et le gel des frais de garde, ainsi que l’accé€s garanti aÌ€ un médecin de famille. Il s’est engagé aÌ€ tenir une con- sultation populaire sur la souveraineté. Le couÌ‚t total de ses engagements est estimé aÌ€ 3,5 milliards de dollars.
Somme toute, une campagne au ras des paÌ‚querettes, sans débat sur les orientations fondamentales de la société québécoise, les trois partis se limitant aÌ€ proposer des mesures terre aÌ€ terre pour répondre aux aspirations de clienté€les particulié€res.
Il semble y avoir une corrélation entre la croissance de la désaffection et du cynisme des citoyens envers la politique et le recours aÌ€ des arguments négatifs dans les discours des politi- ciens. Comme les citoyens ne croient plus aÌ€ l’efficacité de l’action politique et aux engagements des partis, ils sont moins sensibles aux offres de poli- tiques et aux débats d’idées. Leurs crité€res de choix se fondent plus sur des perceptions affectives que sur des motifs rationnels.
Cette tendance est amplifiée par les médias qui, toujours aÌ€ la recherche de sensationnalisme, sont plus portés aÌ€ valoriser ce qui va mal que ce qui va bien, créant ainsi un climat favorable aux attaques et aux dénonciations. Le succé€s des campagnes négatives est relié au fait que les électeurs accordent plus d’attention aux messages néga- tifs ; ils les assimilent plus facilement et s’en rappellent plus longtemps. Cet effet de rétention affecterait surtout les électeurs qui ont un faible niveau d’in- formation politique et emploient des crité€res affectifs pour effectuer leur choix électoral. Les partis suivent donc cette logique dans l’élaboration de leur stratégie de communication. Il s’agit d’obtenir le vote des électeurs en susci- tant une réaction de rejet plutoÌ‚t qu’une réaction d’adhésion. Il semble bien que cette tendance aÌ€ la négativité s’amplifie avec le fractionnement et la dispersion de l’électorat entre plusieurs partis. Lorsque la concurrence est vive et que plusieurs partis sont suscepti- bles de former le gouvernement, le niveau d’agressivité s’accroiÌ‚t. L’élection québécoise de 2007 con- firme cette hypothé€se.