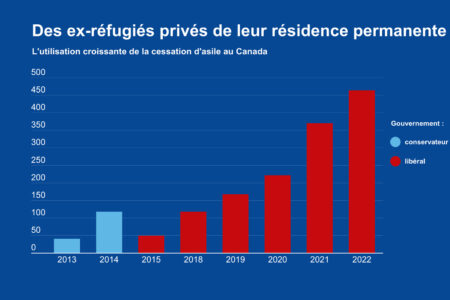
L’objectif du gouvernement canadien d’accueillir 25 000 réfugiés syriens dès l’automne 2015 a fait les manchettes, l’an dernier, suscitant à la fois fierté et craintes. Au 1er mai 2016, le Canada avait déjà dépassé ce nombre, ayant accueilli 15 244 réfugiés parrainés par le gouvernement, 2 307 grâce au Programme mixte (engagement public et privé) et 9 308 en parrainage privé. Au Québec, contrairement à ce qui se passe dans les autres provinces, les réfugiés parrainés par le privé sont plus nombreux : on en compte 4 574, contre 928 pris en charge par l’État. Ces derniers constituent souvent une population plus vulnérable que les réfugiés parrainés par le privé, et ce sont fréquemment des familles plus nombreuses et moins instruites. Ces réfugiés sont aussi majoritairement installés en région, dans les 13 villes pôles d’accueil en dehors de Montréal.
En matière de cours de langue et d’éducation, les mêmes mesures s’appliquent aux réfugiés de toutes les catégories. Et que ceux-ci soient syriens, congolais, afghans, colombiens, irakiens, bhoutanais ou birmans, ils partagent surtout les mêmes difficultés, le même parcours à obstacles en vue de leur intégration, et souvent les mêmes caractéristiques et trajectoires pré-migratoires. Ce sont de grandes familles, parfois monoparentales, avec de jeunes enfants, qui ont passé de longues années dans des camps de réfugiés où ils ont vécu la promiscuité, la précarité, l’insécurité, la violence et le deuil.
Leur parcours d’intégration ne peut être dissocié du fait que ce sont des exilés. Dans ce contexte bien particulier, l’école devient le pilier de la résilience des familles réfugiées, qui font reposer tous leurs espoirs sur la scolarisation des enfants dans le pays d’accueil. Une majorité de parents ne connaissent ni l’anglais ni le français à leur arrivée ; si certains sont instruits, plusieurs sont peu scolarisés et leurs enfants ont également été privés d’école. En juillet 2015, 53 % des enfants syriens d’âge scolaire qui vivaient soit en Syrie, soit dans des camps à l’extérieur du pays, soit sur la route avec leur famille n’étaient pas scolarisés, selon une étude du Migration Policy Institute (résumé par Ray Aoun, novembre 2015). À leur arrivée au Canada, ces enfants ont au moins une ou deux années de retard par rapport aux enfants canadiens de leur âge. Et cela sans compter que la majorité des adultes et plus de 50 % des enfants souffrent d’un stress post-traumatique lié à la violence qu’ils ont subie ou dont ils ont été témoins.
Par conséquent, l’arrivée de ces jeunes particulièrement vulnérables, qui portent un fardeau lourd d’expériences difficiles, pose de grands défis à nos écoles. La scolarisation en français, imposée par la loi 101, est souvent la première expérience familiale de « frottement » avec la société québécoise, c’est-à-dire d’interculturation, comme l’explique le chercheur Altay Manço de l’IRFAM. Quelques semaines, voire seulement quelques jours après leur arrivée au Québec, les enfants de 4 à 16 ans commencent l’école en français. Pour les familles commence alors un nouveau parcours dans un système et dans une langue qu’elles ne connaissent pas. Dans les classes d’accueil, les enfants sont accompagnés dans leur apprentissage du français afin qu’ils intègrent le plus rapidement possible les classes régulières correspondant à leur âge et à leur niveau. À Montréal, le système des classes d’accueil est généralisé, tant au primaire qu’au secondaire, mais les petites localités n’ont souvent pas suffisamment d’élèves pour ouvrir de telles classes.
Dans ces localités, selon le nombre de jeunes accueillis et selon leur niveau scolaire, les commissions scolaires ont recours à divers autres moyens : retrait des élèves de leur classe durant les périodes d’apprentissage du français ; périodes de francisation liées à l’enseignement de plusieurs matières ; intégration dans des classes de cheminement particulier si les élèves accusent des retards scolaires (par ailleurs toujours difficiles à évaluer du fait du parcours des réfugiés) ; recours à des services de psychopédagogie et d’orthophonie ; passage à l’éducation des adultes sans scolarisation pour les jeunes de 16 ans, etc. On voit aussi souvent une combinaison de ces différentes mesures.
La subvention que le gouvernement verse pour chaque enfant allophone donne une certaine souplesse aux commissions scolaires. En plus de la mise en place de mesures de francisation ou de la création de classes d’accueil, une allocation spécifique, qu’elles gèrent seules ou conjointement avec les organismes d’accueil, permet de rémunérer des intervenants qui établissent des liens souvent cruciaux entre les parents, les enseignants et l’école. Les commissions scolaires disposent ainsi d’une marge de manœuvre et peuvent adopter les mesures les plus appropriées dans leur situation, tant en fonction des groupes d’enfants – de leur histoire, de leurs capacités et de leur niveau de scolarité – qu’en fonction des écoles, de même que des quartiers ou des régions et des familles qui les composent.
Par ailleurs, cette gestion locale et spécifique peut poser des défis importants. Comment mettre en place des mesures réellement adaptées aux enfants réfugiés si l’on n’a pas le nombre d’élèves nécessaire pour ouvrir une classe d’accueil ? Comment gérer les arrivées non planifiées de jeunes réfugiés, et à divers moments de l’année scolaire ? Comment enseigner à des jeunes dont les langues d’origine sont totalement inconnues dans la localité où ils sont accueillis ? Quels liens construire entre l’école et les familles ? Comment tenir compte de l’histoire de ces jeunes réfugiés dans l’évaluation de leurs compétences scolaires ? Comment favoriser leur réussite scolaire ? Comment concevoir et créer une école inclusive ouverte sur toute la collectivité ?
Ces questions sont particulièrement importantes en région. À Sherbrooke, par exemple, on a opté pour des classes d’accueil au primaire et au secondaire, en plus de mesures de francisation pour certains élèves plus avancés. À Québec, quelques commissions scolaires privilégient les classes d’accueil, tandis que d’autres, où les réfugiés sont moins nombreux et arrivent de façon plus irrégulière, choisissent de n’offrir que de la francisation. Dans ce second cas, les enfants, s’ils ont été longtemps non scolarisés, risquent d’éprouver de plus grandes difficultés d’intégration, de vivre un échec scolaire ou de se retrouver dans des classes de cheminement particulier qui ne correspondent pas à leurs besoins et constituent donc des impasses. Autrement dit, si l’injection de fonds supplémentaires en fonction du nombre d’élèves nouvellement arrivés est nécessaire, il est également important que les commissions scolaires gèrent leur budget de façon à répondre aux besoins souvent très particuliers des jeunes réfugiés qui s’installent sur leur territoire.
Mais quels que soient les moyens mis en œuvre, l’école et son personnel – et particulièrement les enseignants qui s’occupent des jeunes pendant la première année qu’ils passent au Québec – sont des éléments clés non seulement pour la réussite scolaire des enfants, mais aussi pour le processus d’intégration des familles. Par conséquent, il faut bien sûr des enseignants formés pour enseigner le français langue seconde et pour bien accueillir de jeunes réfugiés, mais aussi des mesures scolaires qui assurent une continuité pour les jeunes et qui permettent de rassurer et d’intégrer leur famille. On doit assurer la permanence des enseignants, et leur permettre de connaître le parcours de ces jeunes et de reconnaître leurs compétences. La gestion des fonds qui sont consacrés à l’enseignement doit donc se faire selon un plan à moyen terme afin d’éviter la mise en place de mesures précaires et discontinues, par exemple des projets pilotes qui n’ont pas de suite.
Les défis politiques et pratiques que pose ce processus concernent non seulement le milieu de l’éducation, mais aussi les municipalités, les secteurs de la santé et des services sociaux, les ONG d’accueil et interculturels, et les communautés culturelles et religieuses. La concertation, la gouvernance démocratique et la prise en compte des intérêts et des compétences de tous les acteurs s’avèrent indispensables à une bonne intégration des réfugiés. Et, pour cela, les mesures intersectorielles doivent être pensées localement, avec la participation active des acteurs principaux comme les écoles et les organismes d’accueil, et soutenues par les différents ministères. À Granby, par exemple, l’articulation entre la commission scolaire et ses écoles, l’organisme d’accueil, la municipalité et le Centre de santé et de services sociaux permet un bon suivi des familles et la mise en œuvre des mesures les mieux adaptées pour assurer la réussite scolaire des jeunes. Des enseignants qui sont formés pour accueillir des enfants immigrants et réfugiés – et qui peuvent le faire pendant des périodes suffisamment longues –, en lien avec les enseignants des classes régulières et avec les intervenants communautaires scolaires interculturels, proches des familles, représentent la garantie de la continuité nécessaire au suivi et à la réussite du plus grand nombre de ces jeunes.
Photo: Shutterstock.com
Cet article fait partie du dossier L’intégration des réfugiés.
Souhaitez-vous réagir à cet article ? Joignez-vous aux débats d’Options politiques et soumettez-nous votre texte en suivant ces directives. Do you have something to say about the article you just read? Be part of the Policy Options discussion, and send in your own submission. Here is a link on how to do it. |






