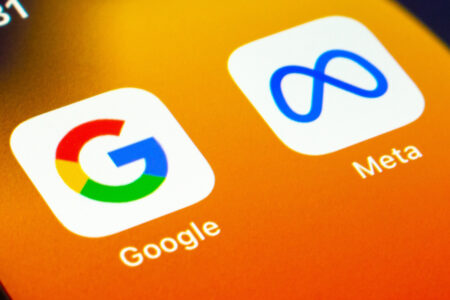Quel avenir pour le journalisme ? Voilà ce qu’on demande à une recrue toute verte, qui, il y a un an à peine, était encore assise sur les bancs de son alma mater.
Je débute dans mon métier alors qu’il entame une transformation profonde, provoquée par l’essor d’Internet. J’aimerais croire que, ayant grandi en même temps que la Toile se développait, je serai mieux outillée pour faire face aux défis du journalisme au 21e siècle, mais j’ai tout de même de grandes réserves.
J’ai étudié dans un programme où l’on a appris à faire de la vidéo et de la radio comme à Radio-Canada, et à écrire et mettre en page comme dans Le Devoir. Ce sont certes d’excellents modèles, mais ils demeurent traditionnels. Quant au Web, je n’ai eu la chance de l’aborder que dans un seul cours.
C’est tout de même un message qui entre en contradiction avec le fait qu’on nous ait répété sans relâche que la presse papier était en déclin, qu’on serait constamment appelés à présenter l’information dans de nouveaux formats.
C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai voulu commencer ma carrière à Vice, un jeune média qui n’hésite pas à prendre des risques. J’ai fait le pari d’essayer de développer ce que mon programme d’études a laissé tomber à plat. Souhaitez-moi bonne chance !
En tant que nouvelle arrivante sur le marché du travail, je me pose également beaucoup de questions par rapport au métier de journaliste même, qui figure régulièrement en tête du palmarès des pires emplois à occuper.
Outre le fait qu’il s’agit d’une profession stressante, où le rythme de production infernal se déploie sur toutes les plateformes à la fois, les conditions d’emploi sont loin d’être idéales. Essayez de décrocher autre chose qu’un poste temporaire ou de surnuméraire en sortant de l’université, un statut qui ne rime pas avec « précaire » ou encore de toucher un salaire décent à la pige. Et ce, sans compter l’épée de Damoclès qui pend au-dessus de toutes les salles de rédaction : ces suppressions de postes qui peuvent survenir à tout moment.
Pas de doute que la pérennité de la profession préoccupe tout le milieu journalistique.
Adieu papier
Quand je projette le journalisme dans un avenir plus ou moins rapproché, j’ai des centaines de questions et seulement une certitude : le papier a presque autant de chances de survie face au Web que Marie-Antoinette en avait face à la guillotine.
Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres.
Les statistiques les plus récentes du Pew Research Center sont sans équivoque : seulement 5 % des jeunes Américains (18 à 29 ans) s’informent fréquemment dans les journaux, contre la moitié des 65 ans et plus.
Je serais d’ailleurs curieuse de voir qui, parmi ce 5 %, est réellement abonné à un journal et ne fait pas que feuilleter l’exemplaire de ses parents ou le quotidien gratuit offert à l’entrée du métro. Dans tous les cas, il paraît évident que le papier ne fera pas long feu avec un degré de popularité aussi restreint chez les jeunes.
À l’inverse du papier, le Web est beaucoup plus prisé par les 18 à 29 ans : la moitié d’entre eux s’y informent sur une base régulière, d’après les statistiques du Pew Research Center. Tous âges confondus, les adultes qui le consultent régulièrement pour obtenir des nouvelles sont deux fois plus nombreux que ceux qui lisent un journal papier. Au total, que ce soit sur une base très occasionnelle ou alors régulière, 81 % des adultes s’informent en ligne.
Dans le monde numérique, l’utilisation du téléphone pour obtenir de l’information est très répandue aussi, et augmente rapidement. La proportion d’Américains qui lisent les nouvelles sur leur appareil mobile est passée de 54 % en 2013 à 72 % en 2016, un bond de 18 %. Ces statistiques prévalent aux États-Unis, mais on peut supposer qu’elles seraient semblables au Canada.
J’ai discuté de cette situation avec ma colocataire, une jeune femme politisée et bien informée. « J’aime bien les journaux, mais pourquoi payer pour, quand j’ai accès à toute l’information dont j’ai besoin sur Internet ? C’est une dépense inutile », m’a-t-elle lancé.
J’ai ri, parce que j’ai trouvé que cette déclaration spontanée résumait avec simplicité la situation actuelle. Les gens veulent du contenu de qualité sans débourser un sou, et qui pourrait leur en vouloir ? Avec la quantité de balados, de sites Web et d’applications entièrement gratuites, l’information n’a jamais été aussi facile d’accès.
Lorsque le coût de la vie grimpe beaucoup plus rapidement que les salaires, l’information payante devient un luxe. Demander aux gens de payer pour la nouvelle devient à leurs yeux une « dépense inutile », qui relève presque du mécénat.
Notre retard
Même si le visage du journalisme se transforme, à l’image du lapin blanc d’Alice au pays des merveilles, le journalisme québécois est en retard.
En 2015, le congrès annuel de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec avait choisi pour thème le virage numérique et offrait des ateliers du style « Comment faire face aux trolls sur le Web ? », « L’explosion du journalisme vidéo » ou « Facebook est-il votre ami ? »
C’était le premier rendez-vous auquel j’assistais et, bien que j’aie apprécié l’expérience, je suis restée songeuse. Les sujets débattus étaient certes ancrés dans la situation actuelle, intrinsèquement liés à l’essor du journalisme en ligne, mais fallait-il attendre 2015 pour les aborder ? Le virage numérique a déjà eu lieu et, forcément, ces questions devaient déjà faire partie de la réalité des artisans du métier. Ces panels, n’aurait-il pas fallu les tenir des années plus tôt ?
J’ai en outre eu l’impression qu’on s’attardait à des détails futiles. J’avais de la difficulté à voir pourquoi, en 2015, on en était encore à se demander comment gérer les commentaires haineux sous les articles. Il existe juste trois options : supprimer le commentaire offensant, ignorer le commentaire offensant ou bloquer l’utilisateur abusif. Voilà, on vient de se sauver une heure de conférence.
Il y a des points beaucoup plus urgents à soulever : les modèles d’affaires, par exemple, et toutes les questions éthiques qui en découlent. Comment concilier la quête de profits avec la mission de l’information, quand les revenus publicitaires ne suffisent plus ? Est-il possible d’accorder une place aux publireportages ou aux contenus commandités tout en poursuivant sans tache la mission d’information ? Si la réponse est non, vers quoi peut-on se tourner ?
Voilà des questions qui déclencheraient des débats plus riches, tout en étant en lien avec le virage numérique.
L’avenir des salles de nouvelles
Je présume que pour offrir du contenu gratuit, la publicité est la clé, même si les annonceurs qui désertent les journaux ne migrent pas forcément vers leur site Web ; ils se tournent plutôt vers les Google et Facebook, ces entreprises qui rapportent de l’argent.
Vient alors la guerre de clics sur les réseaux sociaux. Ou, autrement dit, l’écueil de l’information d’intérêt public. C’est ce que je crains le plus pour l’avenir des médias : que le contenu léger devienne la clé de la survie financière.
En m’informant quotidiennement depuis plusieurs années, je perçois comme bien d’autres un changement dans la teneur de l’information. C’est une machine qui s’est mise en marche il y a un moment déjà, lorsque le soft news, le sujet léger ou traité superficiellement, a commencé à prendre une place plus importante dans les médias. Tout bonnement, la technologie semble avoir fait bondir la popularité de ce type de contenu en introduisant le concept de « viral ».
Aujourd’hui, les sujets légers sont partout, dans La Presse, le Huffington Post, Le Journal de Montréal avec sa section Le sac de chips… Même la société d’État s’y risque parfois. Des sujets populaires, séduisants, divertissants, qui attirent les lecteurs et spectateurs, et qui, je présume, renflouent les coffres.
Si ces revenus permettent de financer le hard news, le journalisme d’enquête, le reportage rigoureux, tant mieux. Mais cette façon de faire n’est pas sans conséquences.
Dans les salles de nouvelles, il faut bien des gens pour alimenter le contenu viral. Des personnes qui utiliseront des compétences connexes au journalisme, sans faire réellement du journalisme. Si c’est là le modèle gagnant, il faudra plus d’effectifs pour générer ce type de contenu, faire de la réécriture, mettre en ligne des textes d’agence et faire de l’agrégation de contenu. Dans les médias, tout est régurgité et remâché à plus grande échelle qu’avant.
Je pense à regret que l’avenir nous réserve de plus en plus de postes campés devant un ordinateur et accorde de moins en moins de place aux reporters sur le terrain, qui seront toujours appelés à faire plus avec le peu de temps et de moyens qui leur sont impartis.
Mais je demeure optimiste, en ce sens où je suis persuadée que peu importe ce que l’avenir nous réserve réellement, il restera un noyau dur d’information de qualité. Peu importe la plateforme sur laquelle elle sera présentée : un article instantané sur Facebook, une story Snapchat, un hologramme ou une serviette de table volée dans un McDonald’s.
Je rêve du jour où il sera viable pour les médias du Québec d’adopter des stratégies de la trempe de celle détaillée par le groupe 2020 du New York Times. Des stratégies numériques ambitieuses, basées sur l’excellence journalistique et qui rejettent la guerre de clics. Des stratégies qui laissent entrevoir un avenir grandiose à la profession.
Parce que des journalistes qui croient en leur métier et qui veulent lui rendre justice, il y en aura toujours. Il suffit de leur donner les moyens de leurs ambitions.
Cet article fait partie du dossier L’avenir du journalisme canadien.
Photo: Shutterstock.com
Souhaitez-vous réagir à cet article ? Joignez-vous aux débats d’Options politiques et soumettez-nous votre texte en suivant ces directives. | Do you have something to say about the article you just read? Be part of the Policy Options discussion, and send in your own submission. Here is a link on how to do it.